Évaluation du Programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques
Juin 2015
Numéro du projet : 1570-7/14091
Format PDF (1 401 Ko, 111 pages)
Table des matières
- Liste des sigles et acronymes
- Sommaire
- Réponse de la direction et plan d’action
- 1. Introduction
- 2. Méthode d’évaluation
- 3. Constatations de l’évaluation – Pertinence
- 4. Conclusions et recommandations
- Annexe A – Programmes complémentaires du gouvernement et possibilités d’aller chercher d’autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
- Annexe B : Activités de recherche universitaire connexes
- Annexe C : Coûts et avantages des technologies liées à l’énergie renouvelable
Liste des sigles et acronymes
| AADNC |
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada |
|---|---|
| CEMRE |
Comité de l’évaluation, de la mesure du rendement et de l’examen |
| DGEMRE |
Direction générale de l’évaluation, de la mesure du rendement et de l’examen |
| DGIC |
Direction générale des infrastructures communautaires, AADNC |
| GES |
Gaz à effet de serre |
| kW |
Kilowatt |
| Mt |
Mégatonne |
| MW |
Mégawatt |
| SCREA |
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique |
Sommaire
La présente évaluation du programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques (ci-après « le programme écoÉNERGIE ») a été réalisée conformément à la Politique sur l'évaluation du Conseil du Trésor et à temps pour être prise en considération pour le renouvellement du programme en 2014-2015. L'évaluation complète celle de 2010 concernant l'incidence du programme, et examine la pertinence du programme écoÉNERGIE (besoin continu) ainsi que son rendement (efficacité, économie, conception et exécution du programme) pour la période allant d'avril 2011 à décembre 2014. Elle a été réalisée par la Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC).
Le programme écoÉNERGIE a été renouvelé en 2011, et a reçu 20 millions de dollars pendant cinq ans (2011-2012 à 2015-2016). Il appuie les collectivités autochtones et nordiques dans le but de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en finançant l'intégration de technologies éprouvées en matière d'énergie renouvelable, comme la récupération de la chaleur résiduelle, la biomasse, l'énergie géothermique, éolienne et solaire et les petites centrales hydroélectriques. Le programme comprend deux volets de soutien financier, y compris :
- Volet A : Financement pour appuyer les études de faisabilité sur des projets plus vastes d'énergie renouvelable (jusqu'à 250 000 $ pour les projets qui permettent d'abaisser les émissions de GES de plus de 4 000 tonnes durant leur cycle de vie du projet).
- Volet B : Financement pour appuyer la conception et la réalisation de projets d'énergie renouvelable intégrés à des bâtiments communautaires nouveaux et existants (jusqu'à 100 000 $ par projet).
L'évaluation a généré 19 conclusions, six recommandations pour la gestion du programme et quatre éléments à prendre en considération pour l'équipe de la haute direction d'AADNC, représentée par des membres du Comité des Opérations.
Besoin du programme
Constatation no 1 : Le gouvernement du Canada a toujours besoin de réduire les émissions de GES.
Constatation no 2 : Il y a un besoin continu de financer les projets sur l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique dans les collectivités autochtones et nordiques qui : 1) remplacent les systèmes diesel; 2) abaissent les coûts élevés de l'énergie; et 3) appuient le développement économique.
Constatation no 3 : Des exemples à l'échelle internationale démontrent qu'un programme écoÉNERGIE axé sur les collectivités hors réseau et les collectivités nordiques reste nécessaire.
Harmonisation avec les rôles et les responsabilités
Constatation no 4 : Le programme écoÉNERGIE est conforme aux rôles et aux responsabilités du gouvernement fédéral, et plus particulièrement au mandat d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.
Recommandation no 1 : Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE définisse clairement son créneau, en mettant l'accent sur les projets d'énergie renouvelable dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau.
Recommandation no 2 : Étant donné que le programme écoÉNERGIE met l'accent sur les collectivités hors réseau et nordiques, il est recommandé que le personnel du programme transmette au Secteur des terres et du développement économique (p. ex. au Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques) les leçons apprises, les pratiques exemplaires et les propositions de projets du volet A pertinentes, car ce Secteur finance déjà ce type de projets. Le personnel du programme devrait également informer les collectivités du changement d'orientation du programme, et leur fournir des renseignements concernant les éventuelles possibilités de financement par le Secteur des terres et du développement économique.
Harmonisation avec les objectifs fédéraux, ministériels et communautaires
Constatation no 5: Le programme écoÉNERGIE cadre avec les priorités fédérales, avec les priorités d'AADNC, et avec les besoins et priorités des collectivités autochtones et nordiques.
Efficacité du programme
Constatation nº 6 : Le programme écoÉNERGIE donne les résultats attendus en matière d'élaboration et de réalisation de projets d'énergie renouvelable viables.
Constatation nº 7 : Le programme écoÉNERGIE donne les résultats attendus en matière de réduction des émissions de GES dans les collectivités autochtones et nordiques.
Constatation no 8 : Le programme écoÉNERGIE atteint le résultat prévu, c'est-à-dire que les collectivités mettent en place une infrastructure communautaire qui respecte les exigences de santé et de sécurité et qui favorise la participation à l'économie.
Constatation no 9 : La conception fondée sur des propositions encourage un modèle de financement mené par les fournisseurs et non les collectivités ayant les besoins les plus grands.
Constatation no 10 : Même si l'harmonisation d'écoÉNERGIE avec les programmes existants d'AADNC, de Ressources naturelles Canada et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord est déjà amorcée, il est nécessaire que les partenaires améliorent la coordination de leurs investissements et de leur soutien en matière d'énergie renouvelable fournis aux collectivités autochtones et nordiques hors réseau.
Constatation no 11 : L'approche d'exécution centralisée des programmes de l'Administration centrale pourrait être améliorée en coordonnant l'élaboration et la mise en œuvre des projets ciblés avec le personnel régional de la Direction générale des infrastructures communautaires.
Constatation no 12 : Les volets A et B ont accordé du financement pour les études et les projets nécessaires; toutefois, il est possible de renoncer aux catégories de financement rigides et de passer au financement de la bonne étape sur l'ensemble des mesures de développement des énergies renouvelables qui favorisent le transfert des études aux infrastructures concrètes.
Constatation no 13 : Il est possible d'accroître les connaissances, la capacité et la confiance dont ont besoin les collectivités pour entreprendre des projets, en faisant la promotion d'initiatives de partage des connaissances et de mentorat.
Recommandation no 3 : Lors d'un éventuel remodelage du programme écoÉNERGIE, il est recommandé de tenir compte des éléments suivants :
- examiner l'efficacité et l'intérêt de conserver les volets de financement distincts et les crédits maximums affectés aux projets;
- examiner l'efficacité et l'intérêt de l'approche axée sur les propositions;
- développer une approche pour cibler les collectivités aux besoins les plus pressants;
- appuyer les projets qui intègrent des systèmes d'énergie renouvelable dans des systèmes existants à base de diesel afin de réduire la consommation de diesel; et
- fournir un appui actif et approprié aux collectivités dans le cadre de l'évaluation et de la progression de projets potentiels d'énergie renouvelable et/ou d'efficacité.
Recommandation no 4 : Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE établisse un processus visant à élaborer une stratégie de mobilisation et de collaboration pour chaque collectivité hors réseau qu'il cible, en veillant à ce que les activités et les investissements par AADNC, les partenaires fédéraux (p. ex. Agence canadienne de développement économique du Nord, Ressources naturelles Canada, Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique [SCREA]) et les autres ordres de gouvernement, soient coordonnés pour permettre aux collectivités de passer sans heurts de la recherche au projet final, en passant par le projet pilote.
Recommandation no 5 : Il est recommandé que le sous-ministre adjoint des Affaires du Nord travaille avec le sous-ministre adjoint principal des Opérations régionales pour améliorer la coordination du financement des projets d'énergie renouvelable au sein des collectivités autochtones ayant lieu au sein de la Direction générale des infrastructures communautaires et dans le cadre du programme écoÉNERGIE.
Considération no 1 pour le Comité des opérations : Le Ministère, en collaboration avec les partenaires fédéraux (p. ex. Agence canadienne de développement économique du Nord, Ressources naturelles Canada, SCREA) et les autres ordres de gouvernement, étudie l'élaboration d'un système central de suivi de cinq ans pour déterminer les activités et les investissements dans toutes les collectivités autochtones et nordiques hors réseau pour augmenter la collaboration stratégique.
Considération no 2 pour le Comité des opérations : Le Ministère étudie l'élaboration d'une politique ministérielle en matière d'énergie durable qui :
- appuie la conception, la construction et la mise en œuvre des systèmes d'énergie renouvelable qui fournissent de l'énergie aux collectivités en vertu du mandat d'AADNC; et
- favorise le financement des projets d'infrastructure à petite échelle qui augmentent l'efficacité énergétique afin de diminuer la demande énergétique (c.-à-d. remplacer les fenêtres, les systèmes de chaudières, les matériaux isolants, etc.).
Considération no 3 pour le Comité des opérations : Le Ministère étudie l'élaboration d'un système d'organisation et de suivi des études de faisabilité et des documents de planification communautaire financés (p. ex. vérifications de la consommation d'énergie, plans des infrastructures, plans de gestion des urgences, études sur l'adaptation aux changements climatiques, plans communautaires globaux, etc.) afin de mieux conserver les travaux financés et d'appuyer les prochaines décisions concernant le développement de l'infrastructure. La Direction générale des politiques stratégiques, de la planification et de la recherche d'AADNC peut être en mesure de créer une telle base de données centralisée et d'en faire l'un de ses outils ministériels de recherche.
Efficience du programme
Constatation no 14 : En raison du processus interne d'approbation de projet, il arrive souvent que le financement soit fourni pendant les mauvaises saisons de construction.
Constatation no 15 : Le programme écoÉNERGIE a la possibilité d'améliorer sa stratégie de mesure du rendement pour faire le suivi de l'efficience du programme et pour cerner plus efficacement tous les projets d'énergie renouvelable d'AADNC.
Constatation no 16 : Il se peut que les objectifs de réduction des GES de certains projets ne se réalisent pas pleinement si la collectivité n'a pas prévu de plan d'exploitation et d'entretien des projets d'énergie renouvelable, une fois ceux-ci implantés.
Recommandation no 6 : Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE mette à jour sa stratégie de mesure du rendement et l'évaluation des risques de façon à tenir compte des considérations relatives à la nouvelle conception du programme et à déterminer la méthode de suivi à utiliser pour suivre l'achèvement des projets d'énergie renouvelable financés dans l'ensemble du Ministère.
Économie du programme – coûts-avantages :
Constatation no 17 : La proportion des fonds du programme affectés au salaire et aux coûts de fonctionnement et d'entretien est en grande partie attribuable aux examens techniques et à l'expertise requise pour évaluer les propositions de projet, ainsi qu'à la nécessité de coordonner les fonds avec les autres ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux.
Constatation no 18 : Bien que les grands systèmes d'énergie renouvelable puissent avoir des avantages considérables sur le plan environnemental et financier pour les collectivités, la production d'énergie diesel des scénarios de réseau électrique autonome demeure souvent l'approche la plus rentable.
Constatation n° 19 : Les projets qui intègrent la technologie d'énergie renouvelable dans les nouveaux projets de construction sont plus rentables par rapport au remplacement des anciens systèmes.
Considération no 4 pour le Comité des opérations : Le Ministère étudie l'établissement des partenariats avec les services publics pour créer un environnement favorable à la croissance de l'industrie de l'énergie renouvelable dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau.
Réponse de la direction et plan d’action
Titre du projet : Évaluation du Programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques
Nº du projet : 1570-7/14091
1. Réponse de la direction
Cette réponse de la direction, et le plan d'action qui l'accompagne, ont été élaborés pour mettre en œuvre les recommandations découlant de l'évaluation du programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques, qui a été menée par la Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen. Le programme en est à sa cinquième et dernière année d'activité (2015-2016). Le moment de cette évaluation cadre bien avec l'élaboration de programmes connexes futurs dont la mise en œuvre est envisagée au-delà de la date d'échéance du programme de mars 2016.
Dans l'ensemble, l'évaluation était positive et a confirmé la pertinence, l'efficacité et la valeur du programme. Plus précisément, écoÉNERGIE :
- cadre avec les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral, le mandat et les priorités d'AADNC, ainsi qu'avec les besoins et les priorités des collectivités autochtones et nordiques;
- donne le résultat attendu en matière d'élaboration et de réalisation de projets d'énergie renouvelable viable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les collectivités autochtones et nordiques; et
- répond au besoin manifeste et constant de financer les projets efficaces d'énergie renouvelable et d'énergie au sein des collectivités autochtones et nordiques.
L'évaluation a donné lieu à six recommandations visant à améliorer la conception et la prestation d'un futur programme. Toutes ont été acceptées par le programme et le plan d'action ci-joint indique des activités précises pour mettre en œuvre ces recommandations.
La première recommandation porte sur la réorientation du soutien financier uniquement pour les projets au sein des collectivités autochtones et nordiques hors réseau (c.-à-d. les collectivités faisant face aux plus grands enjeux énergétiques en raison de leur dépendance à l'égard du diesel). En ce qui concerne le financement des projets en 2015-2016, la priorité a été déjà accordée aux projets dans les collectivités nordiques (dans les territoires) et aux projets dans les collectivités hors réseau (celles qui ne sont pas branchées à un réseau électrique provincial ou régional).
Ce changement d'orientation signifie que le programme, en cas de renouvellement, ne serait plus offert pour appuyer les projets d'énergie renouvelable au sein des collectivités des Premières Nations vivant au sud du 60e parallèle qui sont branchées à un réseau. Par conséquent, et comme il l'indique la deuxième recommandation, le programme collaborera avec le Secteur des terres et du développement économique pour transférer les connaissances concernant les projets d'énergie renouvelable précédents, continus, et éventuels au sein des collectivités branchées à un réseau et vivant au sud du 60e parallèle.
De la même façon, le programme continuera aussi de travailler avec le Secteur des opérations régionales et le Secteur des terres et du développement économique pour se tenir au fait et accroître la coordination, et maximiser les résultats dans tous les investissements, en cas de renouvellement du programme.
Les autres recommandations portent principalement sur une plus vaste collaboration à l'extérieur d'AADNC et les améliorations au programme opérationnel, y compris le renforcement du soutien pour les collectivités ciblées. Elles sont prises en considération aux fins d'intégration dans le futur programme proposé.
Les mesures visant à mettre en œuvre ces recommandations se poursuivront au cours des 12 à 18 prochains mois, bien que, pour le moment, une décision sur les programmes futurs est toujours en attente. L'échéance du renouvellement du programme est floue et pourra avoir une incidence sur les dates prévues de mise en œuvre et d'achèvement indiquées dans le tableau cidessous. Le programme a prévu des ressources pour mettre en place les mesures de suivi définies, au besoin.
2. Plan d'action
| Recommandations | Mesures | Gestionnaire responsable (Titre/Secteur) |
Dates prévues de mise en œuvre et d’achèvement |
|---|---|---|---|
| 1. Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE définisse clairement son créneau, en mettant l'accent sur les projets d'énergie renouvelable dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau. | Le programme accepte cette recommandation. a) Le programme a repéré des projets ciblés au sein des collectivités nordiques hors réseau qui pourraient constituer un élément central de tout programme de financement futur. |
Directrice, Environnement et ressources renouvelables, Organisation des affaires du Nord |
a) Recommandation mise en œuvre en 2015-2016. La priorité du financement a été accordée aux projets dans les collectivités nordiques hors réseau. En cours pour les programmes futurs – décision en attente. |
| 2. Étant donné que le programme écoÉNERGIE met l'accent sur les collectivités hors réseau et nordiques, il est recommandé que le personnel du programme transmette au Secteur des terres et du développement économique (p. ex. au Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques) les leçons apprises, les pratiques exemplaires et les propositions de projets du volet A pertinentes, car ce Secteur finance déjà ce type de projets. Le personnel du programme devrait également informer les collectivités du changement d'orientation du programme, et leur fournir des renseignements concernant les éventuelles possibilités de financement par le Secteur des terres et du développement économique. | Le programme accepte cette recommandation. a) En ce qui concerne les projets 2015-2016, un membre du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques a participé au Comité d'examen des projets du programme écoÉNERGIE. b) Au cours d'une période de transition, le programme participera à des rencontres avec le Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques où seront exposés les propositions précédentes et actuelles, ainsi que des renseignements sur des projets pour les projets d'énergie renouvelable au sein des collectivités reliées au réseau, et des renseignements disponibles sur la technologie. c) Le programme collaborera avec le personnel des Communications et avec le Secteur des terres et du développement économique en vue de préparer des documents à mettre à la disposition des collectivités au sujet des occasions continues ou nouvelles de financement. |
Directrice, Environnement et ressources renouvelables, Organisation des affaires du Nord |
a) Recommandation mise en œuvre en avril-mai 2015. b) et c) Recommandations mises en œuvre d'ici décembre 2016, en supposant la mise en œuvre des programmes de renouvellement en avril 2016. |
3. Lors d'un éventuel remodelage du programme écoÉNERGIE, il est recommandé de tenir compte des éléments suivants : a) examiner l'efficacité et l'intérêt de conserver les volets de financement distincts et les crédits maximums affectés aux projets; b) examiner l'efficacité et l'intérêt de l'approche axée sur les propositions c) développer une approche pour cibler les collectivités aux besoins les plus pressants d) appuyer les projets qui intègrent des systèmes d'énergie renouvelable dans des systèmes existants à base de diesel afin de réduire la consommation de diesel; et e) fournir un appui actif et approprié aux collectivités dans le cadre de l'évaluation et de la progression de projets potentiels d'énergie renouvelable et/ou d'efficacité. |
Le programme accepte cette recommandation. a) Le programme a pris en considération ces éléments dans l'approche proposée pour tout programme de financement futur. |
Directrice, Environnement et ressources renouvelables, Organisation des affaires du Nord |
a) En cours pour les programmes futurs – décision en attente. |
| 4. Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE établisse un processus visant à élaborer une stratégie de mobilisation et de collaboration pour chaque collectivité hors réseau qu'il cible, en veillant à ce que les efforts déployés et les investissements engagés par AADNC, les partenaires fédéraux (p. ex. Agence canadienne de développement économique du Nord, Ressources naturelles Canada, SCREA) et les autres ordres de gouvernement, soient coordonnés pour permettre aux collectivités de passer sans heurts de la recherche au projet final, en passant par le projet pilote. | Le programme accepte cette recommandation. a) Le programme a intégré ce concept dans l'approche proposée du programme pour tout financement futur, et travaillera à peaufiner les renseignements détaillés à l'échelle régionale tout au long de l'élaboration du cadre de contrôle de la gestion du programme. b) Bien qu'il soit nécessaire d'assurer une collaboration productive et continue avec les autres partenaires fédéraux et les autres ordres de gouvernement, le programme organisera des réunions officielles et/ou cherchera à élaborer une approche officielle de mobilisation et de collaboration avec les organisations clés. |
Directrice, Environnement et ressources renouvelables, Organisation des affaires du Nord |
a) En cours pour les programmes futurs – décision en attente. Le cadre de contrôle de la gestion devrait être terminé d'ici décembre 2016. b) En cours pour les programmes futurs – décision en attente. Les réunions et l'approche officielle de mobilisation et de collaboration doivent être terminées d'ici décembre 2016. |
| 5. Il est recommandé que le sous-ministre adjoint des Affaires du Nord travaille avec le sous-ministre adjoint principal des Opérations régionales pour améliorer la coordination du financement des projets d'énergie renouvelable au sein des collectivités autochtones ayant lieu au sein de la Direction générale des infrastructures communautaires et dans le cadre du programme écoÉNERGIE. | Le programme accepte cette recommandation. a) Le sous-ministre adjoint de l'Organisation des affaires du Nord travaillera, de concert avec le sous-ministre adjoint principal des Opérations régionales, à faire en sorte que le futur programme d'énergie de l'Organisation des affaires du Nord s'harmonise, dans la mesure du possible, avec les processus existants régionaux et/ou de l'administration centrale pour assurer une meilleure coordination des fonds pour les projets d'énergie renouvelable au sein des collectivités afin de maximiser les investissements. |
Sous-ministre adjoint, Organisation des affaires du Nord | a) En cours pour les programmes futurs – décision en attente. Le cadre de contrôle de la gestion devrait être terminé d'ici décembre 2016. |
| 6. Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE mette à jour sa stratégie de mesure du rendement et l'évaluation des risques de façon à tenir compte des considérations relatives à la nouvelle conception du programme et à déterminer la méthode de suivi à utiliser pour suivre l'achèvement des projets d'énergie renouvelable financés dans l'ensemble du Ministère. | Le programme accepte cette recommandation. a) Le programme a mis à jour sa stratégie de mesure du rendement et l'évaluation des risques de façon à tenir compte des considérations relatives à la nouvelle conception du programme. b) Le programme a établi un concept pour surveiller les projets financés par le programme, qui seront davantage peaufinés au moyen de l'élaboration du cadre de contrôle de la gestion du programme. c) Le programme collaborera avec les Opérations régionales et le Secteur des terres et du développement économique pour déterminer les options de suivi des projets d'énergie renouvelable à l'échelle du Ministère. |
Directrice, Environnement et ressources renouvelables, Organisation des affaires du Nord |
a) Une version provisoire de la stratégie de mesure du rendement a été approuvée par le Comité de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen le 24 avril 2015. b) En cours pour les programmes futurs – décision en attente. Le cadre de contrôle de la gestion devrait être terminé d'ici décembre 2016. c) En cours pour les programmes futurs – décision en attente. Options terminées d'ici décembre 2016. |
Je recommande la présente réponse de la direction, et le plan d'action qui l'accompagne, à l'approbation du Comité de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen.
Originale signée le 15 juin 2015 par :
Michel Burrowes
Directeur, Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen
J'approuve la réponse et le plan d'action de la direction.
Originale signée le 15 juin 2015 par :
Wayne Walsh pour :
Stephen M. Van Dine
Sous-ministre adjoint, Organisation des affaires du Nord
1. Introduction
1.1 Aperçu
La présente évaluation du Programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques (ci-après « le programme écoÉNERGIE ») a été réalisée conformément à la Politique sur l'évaluation du Conseil du Trésor et à temps pour être prise en considération pour le renouvellement du programme en 2014-2015. L'évaluation complète celle de 2010 concernant l'incidence du programme, et examine la pertinence du programme écoÉNERGIE (besoin continu) ainsi que son rendement (efficacité, économie, conception et exécution du programme) pour la période allant d'avril 2011 à décembre 2014. Elle a été réalisée par la Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC).
Le programme écoÉNERGIE a d'abord été créé en 2007, prenant appui sur le préexistant Programme d'action communautaire visant les Autochtones et les habitants du Nord (2003-2006). Il est dirigé par l'Organisation des affaires du Nord (secteur), est géré de façon centralisée par l'administration centrale d'AADNC, et comprend un réseau d'employés régionaux de soutien chargé de modifier les accords de contribution qui permettent l'apport des fonds de l'administration centrale aux collectivités présentant des propositions de projet approuvées. Le programme a été renouvelé en 2011, et ce, pour une période de cinq ans.
À l'échelle ministérielle, le programme écoÉNERGIE est l'un des six sous-programmes relevant du secteur du programme Infrastructure et capacités d'AADNCNote de bas de page 1, lequel s'inscrit dans la catégorie de résultat stratégique « Les terres et l'économie » d'AADNC. Dans le contexte du gouvernement fédéral, le programme écoÉNERGIE fait partie de l'ensemble des programmes sur l'énergie propre, dans le cadre du Programme de la qualité de l'air du Canada, mené par Ressources naturelles Canada.
Le Programme de la qualité de l'air est une composante fondamentale des efforts considérables du gouvernement du Canada, qui visent à relever les défis liés aux changements climatiques et à la pollution atmosphérique afin de créer un environnement propre et sain pour tous les Canadiens. Il appuie onze ministères et organismes et comporte cinq volets :
- Programme de réglementation de la qualité de l'air
- Énergie propre
- Transport écologique
- Mesures internationales
- Adaptation
Le volet Énergie propre consiste en une série de sept programmes visant à réduire les émissions de GES. Les ministères et les organismes partenaires sont responsables d'évaluer leurs programmes respectifs et de présenter leurs résultats dans une évaluation thématique de l'énergie propre menée par Ressources naturelles Canada au cours de l'exercice 2014-2015.
L'évaluation suivante fournit une analyse objective et indépendante du programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques. Elle offre aussi une analyse précise de la conception actuelle et de la mise en œuvre du programme. Les constatations issues de l'évaluation s'appuient sur l'analyse et la mise en correspondance des données obtenues par l'examen des documents et des dossiers, l'analyse documentaire, des entrevues auprès d'informateurs clés, et des études de cas communautaires. L'évaluation a généré 19 constatations clés et six recommandations.
1.2 Profil du programme
1.2.1 Contexte et description
AADNC soutient depuis longtemps le développement de l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique pour les collectivités autochtones et nordiques sur des réserves.
Le programme écoÉNERGIE, lancé en 2007, a remplacé le Programme d'action communautaire visant les Autochtones et les habitants du Nord (2003-2006). De 2007 à 2011, il a appuyé plus de 96 collectivités et financé plus de 110 projets. Des 110 projets financés, 41 ont été amorcés dans des collectivités « hors réseau » éloignées qui sont reliées non pas à un grand réseau régional, mais plutôt à des mini-réseaux qui acheminent l'énergie d'une source d'alimentation (habituellement un groupe électrogène diesel) vers les bâtiments de la collectivité. Ces 110 projets devraient réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'au moins 1,3 mégatonne (Mt ou million de tonnes) sur un cycle de vie de 20 ans.
L'examen des programmes d'énergie propre de 2010, dirigé par Ressources naturelles Canada, prônait le maintien du programme écoÉNERGIE en concluant que ce dernier avait permis d'identifier les ressources énergétiques locales nécessaires pour générer des avantages économiques et environnementaux aux collectivités autochtones et nordiques. Le programme a ensuite été renouvelé de 2011 à 2016. Son objectif principal était d'abaisser de plus de 1,5 mégatonne les émissions de GES. Il s'appuyait pour cela sur l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'énergie renouvelable qui réduisaient ou remplaçaient l'électricité et la chaleur produites à l'aide du gaz naturel, du charbon et du diesel.
Le programme renouvelé visait à faire face aux importants enjeux énergétiques pour les collectivités autochtones et nordiques, y compris les coûts élevés et variables de l'énergie, les réductions de tension occasionnelles, l'infrastructure vieillissante et inefficace, et les communautés isolées hors réseau dépendant de systèmes fonctionnant au carburant diesel et produisant beaucoup d'émissions. Pour surmonter ces défis, le programme écoÉNERGIE a appuyé les collectivités autochtones et nordiques dans le but de réduire leurs émissions de GES en finançant l'intégration de technologies éprouvées en matière d'énergie renouvelable, comme la récupération de la chaleur résiduelle, la biomasse, l'énergie géothermique, éolienne et solaire et les petites centrales hydroélectriques. Il comprend deux volets de soutien financier :
- Volet A : Financement pour appuyer les études de faisabilité sur des projets plus vastes d'énergie renouvelable (jusqu'à 250 000 $ pour les projets qui permettent d'abaisser les émissions de GES de plus de 4 000 tonnes durant leur cycle de vie du projet).
- Volet B : Financement pour appuyer la conception et la réalisation de projets d'énergie renouvelable intégrés à des bâtiments communautaires nouveaux et existants (jusqu'à 100 000 $ par projet).
Le programme est mis en œuvre de façon centralisée dans la région de la capitale nationale par le personnel de la Direction de l'environnement et des ressources renouvelables (DERR), au sein de l'Organisation des affaires du Nord d'AADNC. Les fonctionnaires responsables examinent les soumissions en utilisant les critères d'admissibilité et en finançant ensuite un examen technique par un tiers portant sur des projets admissibles afin de déterminer les réductions potentielles de GES. À la suite de ces évaluations, un comité d'examen des projets, formé par des représentants de l'Organisation des affaires du Nord et d'autres secteurs ministériels de même que par des conseillers externes, examinera tous les projets jugés admissibles et recommandera les projets les plus appropriés pour l'obtention d'un financement. Le directeur de la Division des changements climatiques approuve ensuite les projets aux fins de réalisation, selon les niveaux de financement disponibles.
1.2.2 Objectifs et résultats attendus
À l'échelle ministérielle, le programme écoÉNERGIE est l'un des six sous-programmesNote de bas de page 2 relevant du secteur du programme Infrastructure et capacités d'AADNC. Le résultat attendu pour l'ensemble de ces six sous-programmes est de s'assurer que « les collectivités des Premières Nations mettent en place une infrastructure communautaire qui respecte les exigences de santé et de sécurité et qui favorise la participation à l'économie ». Le programme sous-tend le résultat stratégique Les terres et l'économie : « Participation entière des personnes et des collectivités des Premières Nations, des Métis, des Indiens non inscrits et des Inuits à l'économie ».
Le programme écoÉNERGIE vise à obtenir les résultats suivants :
Résultats immédiats
- Des projets d'énergie renouvelable viables sont en cours d'élaboration dans les collectivités autochtones et nordiques (volet A).
- Les collectivités autochtones et nordiques ont des projets énergétiques intégrés dans des bâtiments communautaires nouveaux ou existants (volet B).
Résultats intermédiaires - Réduction des émissions de GES dans les collectivités autochtones et nordiques
Résultat final : - Les collectivités des Premières Nations disposent d'une infrastructure qui protège la santé et la sécurité et favorise la participation à l'économie
Résultat stratégique - Participation entière des personnes et des collectivités des Premières Nations, des Métis, des Indiens non inscrits et des Inuits à l'économie
Cette évaluation a porté sur la mesure dans laquelle le programme écoÉNERGIE obtient ces résultats.
1.2.3 Ressources du programme
Dans le cadre du Programme d'action communautaire visant les Autochtones et les habitants du Nord, AADNC a versé 30 millions de dollars pendant trois ans (2003-2004 à 2005-2006) pour renforcer la capacité qu'ont les collectivités autochtones et nordiques d'entreprendre des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. En 2007, dans le cadre du Programme de la qualité de l'air du gouvernement du Canada, AADNC a reçu 15 millions de dollars pendant quatre ans (2007-2008 à 2010-2011) pour mettre en œuvre le programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques. Le programme a financé la planification énergétique communautaire, l'intégration de technologies d'énergie renouvelable de petite envergure dans des bâtiments communautaires, ainsi que des travaux de faisabilité de grands projets d'énergie renouvelable.
Le programme écoÉNERGIE dans sa version actuelle a été renouvelé en 2011 et a reçu 20 millions de dollars pendant cinq années (2011-2012 à 2015-2016). Il finance l'intégration de technologies d'énergie renouvelable de petite envergure dans des immeubles communautaires, ainsi que des travaux de faisabilité de grands projets d'énergie renouvelable. Au fur et à mesure que le programme écoÉNERGIE s'est mis en place, il a mis l'accent de plus en plus sur le financement des collectivités autochtones et nordiques hors réseau.
De 2011 à 2014, le programme a versé en moyenne 850 000 $ par année en salaire et en avantages sociaux, 330 000 $ en exploitation et en entretienNote de bas de page 3, afin de distribuer $2,8 millions de dollars en subventions et en contributions aux collectivités bénéficiaires approuvées.
Depuis le 1er avril 2014, les activités de programme relèvent des modalités de deux autorisations du Programme des paiements de transfert :
- Contribution pour promouvoir l'utilisation, le développement, la conservation et la protection sécuritaires des ressources naturelles ainsi que le développement scientifique;
- Contributions pour appuyer la construction et l'entretien des infrastructures communautairesNote de bas de page 4.
Le financement du projet est alloué aux bénéficiaires approuvés en utilisant les accords de contribution. Tout projet financé par le programme écoÉNERGIE est compris dans les accords existants. Les accords de contribution sont rédigés par le personnel du programme de l'Administration centrale pour toute collectivité bénéficiaire qui n'en a pas déjà un en vigueur.
2. Méthode d’évaluation
2.1 Portée et calendrier de l'évaluation
L'évaluation a porté sur les activités du programme écoÉNERGIE réalisées entre avril 2011 et décembre 2014. Le mandat de l'évaluation a été approuvé en juin 2014 par le Comité de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen d'AADNC. Les travaux sur le terrain se sont déroulés entre juillet et décembre 2014.
Conformément aux exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor, l'évaluation fournit de l'information crédible et neutre sur la pertinence et le rendement du programme écoÉNERGIE. Elle fournit également de l'information utile en vue de l'élaboration des prochains programmes, notamment les options possibles, les pratiques exemplaires et les leçons apprises. L'évaluation tire profit des résultats de l'évaluation de l'incidence de 2010 et analyse les résultats des mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans l'évaluation de 2010.
2.2 Méthode d'évaluation
L'évaluation a porté sur les enjeux en matière d'évaluation suivants :
Pertinence du programme
Enjeu 1 : Nécessité de poursuivre les activités de surveillance
Enjeu 2 : Harmonisation avec les priorités gouvernementales
Enjeu 3 : Harmonisation avec les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral
Rendement du programme
Enjeu 4 : Efficacité
- Des projets d'énergie renouvelable viables sont en cours d'élaboration dans les collectivités autochtones et nordiques (volet A)
- Les collectivités autochtones et nordiques ont des projets énergétiques intégrés dans des bâtiments communautaires nouveaux ou existants (volet B)
- Réduction des émissions de GES dans les collectivités autochtones et nordiques
- Les collectivités des Premières Nations disposent d'une infrastructure qui protège la santé et la sécurité et favorise la participation à l'économie
Enjeu 5 : Efficacité et économie
Les conclusions et les constatations de l'évaluation au sujet des cinq principaux enjeux s'appuient sur l'analyse et sur la validation des diverses sources de données suivantes.
Analyse documentaire
Kishk Anaquot Health Research, une société d'experts-conseils, a examiné des documents spécialisés pertinents et récents. Le but de l'examen était de définir le terme « énergie renouvelable », de mettre en évidence les facteurs stratégiques nationaux et internationaux relatifs à l'énergie renouvelable, de décrire les rôles et responsabilités du gouvernement fédéral, de comparer la nécessité des technologies liées à l'énergie renouvelable dans les collectivités branchées au réseau et dans les collectivités hors réseau, de comparer l'utilité du financement de divers types de technologie liée à l'énergie renouvelable, de souligner les pratiques exemplaires afin de proposer des exemples de politique et de programme nationaux et internationaux, et de fournir une orientation quant à l'évolution du programme écoÉNERGIE d'AADNC, en fonction de l'analyse des conclusions.
Examen des documents et des dossiers
Les documents de programme et les dossiers de projet ont été passés en revue, notamment la conception élémentaire des programmes, la documentation sur la prestation de services et les pouvoirs financiers, les comptes rendus de réunion, les documents de planification stratégique, les documents de mesure du rendement et l'analyse afférente, les analyses sur la réduction des GES, les présentations au Parlement et un échantillon de propositions de projet et de rapports définitifs.
Analyse de base de données
On a réalisé une analyse de la base de données sur les projets du programme. Cette base de données recense les types de projet financés chaque année, l'emplacement de la collectivité, une indication à savoir si la collectivité est branchée au réseau ou non, les coûts du projet, l'estimation de la réduction des GES et le statut des projets du volet A financés auparavant (comme les études de faisabilité).
Entrevues auprès des informateurs clés
Au total, 26 entrevues ont été menées : huit avec des employés d'AADNC de la région de la capitale nationale, huit avec des employés d'AADNC des autres régions et dix avec des spécialistes externes, notamment des universitaires, des experts-conseils et des représentants d'autres ministères fédéraux.
Études de cas et visites dans les collectivités
Neuf études de cas ont été réalisées en Colombie-Britannique, au Yukon et dans le Canada atlantique. Ces études comprenaient des visites dans la Première Nation de Kluane, la Première Nation d'Eel Ground, la Première Nation d'Abegweit, la Première Nation de Penelakut, la Première Nation de Taku River, la Première Nation des Tlingits de la rivière Taku et la Première Nation des Tla-o-qui-aht. Il a été impossible de visiter deux des bénéficiaires de fonds dans le cadre du programme écoÉNERGIE. Les études de cas ont été sélectionnées en fonction des critères suivants :
- Exemples de projets achevés du volet A et du volet B
- Propagation à l'échelle régionale
- Régions ayant le nombre le plus élevé de projets financés
- Priorité, dans la mesure du possible, aux collectivités nordiques hors réseau afin de soutenir l'évolution du programme
- Bénéficiaires ayant reçu des fonds sur plusieurs années
- Investissements financiers les plus élevés dans le programme écoÉNERGIE
- Échantillon de collectivités ayant reçu du financement dans le cadre du programme précédent afin de démontrer les répercussions et les leçons apprises à long terme puisque les projets prennent habituellement au moins cinq ans à se concrétiser
- Échantillon de bénéficiaires pour lesquels le projet a été considéré comme étant un échec ou pour lequel les fonds ont été retournés
Les études de cas ont notamment pris la forme d'entrevues avec 25 intervenants liés aux projets, notamment des membres des collectivités, des entrepreneurs externes, des ingénieurs, des gestionnaires de projet, des exploitants de centrale ainsi que des chefs de bande et des membres de conseil de bande. Les documents clés, comme les propositions originales, les conceptions de projet, les rapports d'étape et les rapports définitifs, ont également été examinés au cours des études de cas.
2.2.1 Facteurs à considérer, points forts et limites
Le programme a permis de faire le suivi des données nécessaires en appui à sa stratégie de mesure du rendement. Les évaluateurs ont ainsi pu analyser le rendement du programme au cours des trois dernières années. Le récent examen des Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations, de l'Initiative sur les partenariats stratégiques et les investissements dans le développement économique d'AADNC a aussi permis aux évaluateurs d'utiliser les notes d'autres entrevues et études de cas où le programme écoÉNERGIE était mentionné, en appui à l'évaluation.
2.3 Rôles, responsabilités et assurance de la qualité
La Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen (DGEMRE) du Secteur de la vérification et de l'évaluation d'AADNC a géré et réalisé l'évaluation conformément à sa politique sur la participation et à son processus de contrôle de la qualité, lesquels cadrent avec la Politique sur l'évaluation du Conseil du Trésor. La société d'experts-conseils Kishk Anaquot Health Research s'est chargée de l'analyse documentaire. Le contrôle de la qualité a été effectué par les conseillers du groupe de travail sur l'évaluation, composé de gestionnaires, d'analystes et d'intervenants régionaux du programme écoÉNERGIE ainsi que de représentants de l'autre programme d'infrastructure d'AADNC. Ce groupe a été mis sur pied en vue d'assurer la qualité et la pertinence de l'approche en matière d'évaluation et des instruments de recherche ainsi que d'examiner les livrables provisoires. La Direction générale de la planification stratégique, de la politique et de la recherche d'AADNC a également examiné la qualité du rapport d'évaluation final.
3. Constatations de l’évaluation – Pertinence
3.1 Nécessité du programme
Constatation no 1 : Le gouvernement du Canada a toujours besoin de réduire les émissions de GES.
Le programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques a été élaboré en vue de faciliter l'intégration des technologies liées à l'énergie renouvelable dans les collectivités autochtones et nordiques et ainsi réduire les émissions de GES.
L'énergie renouvelable est obtenue à partir de ressources naturelles qui se renouvellent continuellement. Cette énergie inépuisable et durable se présente sous plusieurs formes, notamment l'eau en mouvement (p. ex. rivières et marées), le vent, la terre et le soleilNote de bas de page 5. Les formes d'énergie renouvelable les plus connues sont :
- Solaire (photovoltaïque, technologie de la thermie solaire, énergie solaire concentrée)
- Éolienne (sur le littoral et au large)
- Hydroélectrique (sur un cours d'eau et en réservoir)
- Océanique/maritime (notamment par les vagues et les marées)Note de bas de page 6
- Géothermique
- Bioénergie (notamment les biocombustibles et la biomasse qui peuvent être en circuit ouvert [production à partir des forêts et des déchets] ou en circuit fermé [production à partir de cultures énergétiques spécialisées]; les biocombustibles et la biomasse sont des ressources renouvelables seulement si la vitesse de leur utilisation n'excède pas leur vitesse de régénération)Note de bas de page 7,Note de bas de page 8
L'objectif ultime du programme écoÉNERGIE est d'exploiter les technologies liées à l'énergie renouvelable susmentionnées afin de réduire les émissions de GES. Cet objectif est en harmonie avec la conclusion acceptée à l'échelle mondiale, à savoir que les émissions de GES ont des répercussions néfastes sur le climat et qu'elles doivent être réduites. Conformément au Climate Change Performance Index de 2014 (indice de rendement de la lutte contre les changements climatiques) publié par GermanWatch et Climate Action Network in Europe, aucun pays n'est sur la bonne voie quant à la prévention des changements climatiques dangereuxNote de bas de page 9. Malgré des investissements importants dans l'énergie renouvelable, le Canada, la Chine et les États-Unis ont eu un piètre classement dans l'indice; le Canada se classe d'ailleurs au dernier rang des pays industrialisés occidentauxNote de bas de page 10.
Selon les Tendances en matière d'émissions au Canada 2014 d'Environnement Canada, les émissions de CO2 du pays ont constamment augmenté depuis 1990 et, si aucune mesure réglementaire n'est prise, elles devraient atteindre 727 mégatonnes d'ici 2020Note de bas de page 11. L'écart entre la projection de 2020 et la cible des émissions canadiennes de GES établi par l'accord de 2009 de Copenhague est estimé à 116 Mt d'éq. CO2, comme illustré dans le graphique historique suivantNote de bas de page 12.
Figure 1 : Émissions historiques de GES du Canada et projections jusqu'en 2020Note de bas de page 13
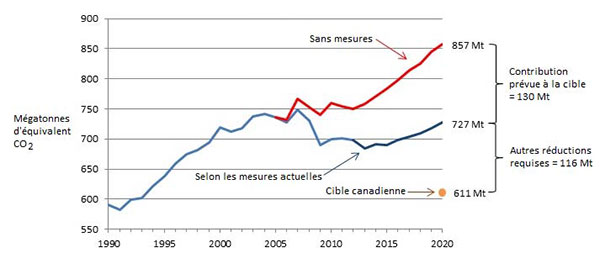
Équivalent textuel de la figure 1 Émissions historiques de GES du Canada et projections jusqu'en 2020
L’axe des ordonnées de ce graphique linéaire représente les « mégatonnes d’éq. CO2 ». Elle commence à 550 plutôt que zéro et elle est graduée en échelons de 50 jusqu’à 900. L’axe des abscisses représente les années, soit de 1990 à 2020. L’objectif canadien d’émissions de gaz à effet de serre est indiqué par un point sur le graphique d’une valeur de 611 Mt en 2020. Les lignes du graphique indiquent qu’on prévoit que le Canada émettra 727 Mt de gaz à effet de serre d’ici 2020 en fonction des mesures prises actuellement et que ses émissions atteindraient 857 Mt d’ici 2020 si aucune mesure n’était prise.
Les collectivités canadiennes pourraient subir les incidences suivantes si les émissions de GES ne sont pas radicalement réduitesNote de bas de page 14.
Impacts sur l'environnement
- Les températures annuelles moyennes globales devraient augmenter.
- Le réchauffement climatique aura pour effet de réduire la couverture de neige, de glace de mer et des glaciers, ce qui entraînera une élévation du niveau de la mer et une augmentation des inondations côtières. La hausse des températures fera aussi dégeler le pergélisol de l'Arctique.
- La fréquence et la gravité des tempêtes et des vagues de chaleur devraient augmenter.
- De nombreuses espèces sauvages auront de la difficulté à s'adapter à un climat plus chaud et seront probablement exposées à un stress plus grand causé par les maladies et les espèces envahissantes.
Impacts sur la santé humaine
- Les collectivités du nord du Canada, de même que les populations vulnérables comme les enfants et les personnes âgées, seront probablement les plus touchées par ces changements.
- L'augmentation des températures et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes pourraient augmenter les risques de décès attribuables à la déshydratation et à l'insolation, ainsi que le risque de blessures dues à des changements intenses dans les conditions météorologiques locales.
- Le risque de problèmes respiratoires et cardiovasculaires ainsi que de certains types de cancer pourrait s'accroître au fur et à mesure que les températures augmentent et aggravent la pollution de l'air.
- Le risque de maladies transmises par l'eau, la nourriture, les vecteurs et les rongeurs pourrait augmenter.
Impacts sur l'économie
- Les changements des conditions climatiques pourraient avoir des répercussions sur l'agriculture, la foresterie, le tourisme et les loisirs.
- Les impacts sur la santé humaine ajoutent sans doute des pressions économiques sur les systèmes de soins de santé et de soutien social.
- Les dommages causés aux infrastructures (p. ex. les routes et les ponts) par les phénomènes météorologiques extrêmes, le dégel du pergélisol et l'élévation du niveau de la mer devraient augmenter.
Par conséquent, des programmes comme écoÉNERGIE sont indéniablement requis à l'échelle nationale pour contribuer à la réduction des émissions de GES dans les collectivités canadiennes.
Constatation no 2 : Il y a un besoin continu de financer les projets sur l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique dans les collectivités autochtones et nordiques qui : 1) remplacent les systèmes diesel; 2) abaissent les coûts élevés de l'énergie; et 3) appuient le développement économique.
Bien que le principal objectif du programme écoÉNERGIE soit de réduire les émissions de GES, la nécessité de développer des technologies liées à l'énergie renouvelable est plus ciblée pour les collectivités qui ont envoyé des propositions de projet. Les collectivités sont moins préoccupées par la réduction générale des émissions de GES : elles soulignent plutôt que des solutions relatives à l'énergie renouvelable sont nécessaires afin de réduire leur propre dépendance aux systèmes diesel, d'abaisser les coûts élevés de l'énergie et d'appuyer le développement économique.
1) Les collectivités hors réseau entreprennent des projets d'énergie renouvelable afin de réduire leur dépendance aux générateurs au diesel
« L'énergie renouvelable coûte ridiculement cher aux collectivités hors réseau. » – Répondant
Comme l'a indiqué le Ministère, il y a 292 collectivités hors réseau au Canada, et plus de la moitié (167) sont des collectivités autochtones ou nordiques; de ce nombre, 77 collectivitésNote de bas de page 15 dépendantes de systèmes diesel se trouvent au nord du 60e parallèle, et 90 autres se trouvent au sudNote de bas de page 16. Dans tous les cas, les technologies liées à l'énergie renouvelable sont exploitées afin de réduire leur dépendance aux systèmes diesel puisque le transport, l'entreposage et la consommation coûtent très cher, représentent des risques de contamination, génèrent de la pollution par le bruit et ont des répercussions négatives sur la qualité de l'air à l'échelle locale. Les coûts sont beaucoup plus élevés que ce que la majorité des Canadiens payent pour un kilowattheure d'électricité. De plus, les collectivités autochtones et nordiques hors réseau sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques. Leurs revenus reposent habituellement sur les ressources terrestres et aquatiques ainsi que les autres ressources naturelles; l'élévation des températures a fait augmenter le coût et la complexité de production du diesel pour les collectivités qui utilisent des routes de glace comme principale méthode de transport du diesel.Note de bas de page 17 Note de bas de page 18 Note de bas de page 19 Note de bas de page 20 Note de bas de page 21 Note de bas de page 22
AADNC finance l'approvisionnement en diesel pour les collectivités hors réseau afin de soutenir la production calorifique et d'électricité. Bien que les données exactes ne puissent pas être calculées en raison des contraintes liées au codage financier, les coûts ne sauraient être qu'élevés en raison du transport nécessaire (par voie aérienne ou maritime ou encore au moyen des routes de glace). Par exemple, le bureau régional de l'Ontario estime que depuis 2005-2006, la différence relative au transport du carburant (jusqu'aux collectivités, afin de leur permettre de répondre aux demandes en carburant relatives à la production d'électricité en région éloignée) s'élevait à 46,8 millions de dollars, répartis entre 25 collectivités hors réseau. Bien que le prix du carburant ait fluctué au cours des années, AADNC a subi d'importantes contraintes en matière de financement entre 2006 et 2009, soit lorsque les collectivités hors réseau ont eu besoin d'autres fonds pour défrayer les coûts supplémentaires associés à la hausse du prix du diesel. Ces contraintes pourraient se poursuivre puisque le coût du diesel dans le nord de l'Ontario devrait augmenter de 40 % au cours des 10 prochaines annéesNote de bas de page 23.
De plus, les coûts que doivent engager les entreprises de services publics des provinces et des territoires pour fournir leurs services aux collectivités hors réseau dans les zones qu'elles desservent sont très élevées. Ces coûts sont particulièrement élevés dans le Nord. Selon l'Office national de l'énergie, « le Nord ne représente qu'environ 0,3 % de la population canadienne et de la consommation d'énergie au pays », mais « comptant un peu plus de 100 000 habitants disséminés sur un territoire de plus de 3,5 millions de kilomètres carrés, le Nord est confronté à de sérieux problèmes de coût de l'énergie et de logistique de distribution »Note de bas de page 24. Par exemple, le Nunavut dépend entièrement du diesel importé pour combler ses besoins de consommation quotidienne. Qulliq Energy Corporation, l'entreprise de service public qui approvisionne le Nunavut en énergie, fournit de l'électricité à plus de 33 000 personnes réparties dans 25 collectivités qui sont reliées à des réseaux isolés alimentés au diesel couvrant environ deux millions de kilomètres carrésNote de bas de page 25. Afin de satisfaire les besoins énergétiques de ses clients, en 2009-2010, Qulliq Energy Corporation a consommé 45 millions de litres de diesel à un coût de 39 millions de dollars ou 1181 $ par personneNote de bas de page 26. L'énorme quantité du diesel consommé pour générer de l'électricité dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau et son coût important démontrent la nécessité de continuer à subventionner les projets d'énergie renouvelable qui pourraient réduire considérablement la dépendance de ces collectivités sur les génératrices fonctionnant au diesel.
Le diesel est expédié aux collectivités éloignées hors réseau durant les mois d'été, puis est stocké dans des parcs de réservoirs en vue de sa distribution et de son utilisation tout au long de l'année. Le transport et le stockage du diesel dans ces collectivités sont à l'origine de problèmes environnementaux graves, car les déversements et les fuites peuvent contaminer les sources d'eau et les cours d'eau locauxNote de bas de page 27. Certes, l'acquisition et l'entretien des réservoirs de diesel incombent à chaque collectivité, mais la contamination des lieux et les risques pour l'environnement et la santé attribuables aux fuites relèvent d'AADNC. En raison de ces risques, AADNC assume les coûts d'amélioration des réservoirs de combustible et, au cours des cinq dernières années, le Ministère a versé 80 millions de dollars de plus pour améliorer les vieux réservoirs de combustible sur les réserves et a prévu 75 millions de dollars de plus à cette fin au cours des quatre prochaines années.
En outre, la croissance de la demande en électricité vient accentuer les problèmes d'ordre énergétique auxquels font face les collectivités hors réseau. Selon Ressources naturelles Canada, la demande en électricité dans les régions nordiques du Canada augmente de 1,5 % à 2 % par personne par annéeNote de bas de page 28. En raison de la demande croissante d'électricité, de plus grandes quantités de diesel doivent être expédiées dans les collectivités qui dépendent du diesel pour satisfaire leurs besoins en électricité. Les difficultés inhérentes au transport du diesel dans ces collectivités ont une incidence sur leur capacité de satisfaire leurs besoins, de sorte que les ruptures de courant y sont fréquentesNote de bas de page 29. Dans de nombreuses collectivités, les systèmes fonctionnant au diesel ne parviennent pas à satisfaire à la demande et finissent par devenir inopérants, ce qui cause des pannes de courant. Ces pannes peuvent durer de quelques heures à quelques semaines, ce qui nuit au bon fonctionnement de l'infrastructure communautaire dont les écoles, les bureaux de conseil de bandes et les centres de santéNote de bas de page 30. Elles limitent aussi le développement économique des collectivités autochtones et nordiques hors réseau, car les coûts élevés de l'électricité et le manque de fiabilité du réseau d'électricité entravent l'exploitation efficace des entreprises de sorte qu'il est plus difficile d'attirer des investisseursNote de bas de page 31.
2) Les collectivités reliées au réseau entreprennent des projets d'énergie renouvelable afin de réduire les coûts de l'électricité
« L'objectif est de réduire les coûts de l'électricité. » – Répondant
Au Canada, les prix de l'électricité que doivent payer les clients résidentiels varient énormément. En Alberta, en Saskatchewan et dans le Canada atlantique, les tarifs résidentiels d'électricité peuvent atteindre le double de ceux qui sont exigés dans les provinces riches en ressources hydroélectriques, notamment la Colombie-Britannique, le Manitoba et le Québec. Ainsi, entre 2010 et 2014, le prix moyen de l'électricité pour un client résidentiel consommant 1000 kWh par mois fournis par Hydro-Québec était de 6,88 ⊄/kWh; le tarif de Manitoba Hydro s'établissait à 7,47 ⊄/kWh, tandis que celui de BC Hydro se situait à 8,57 ⊄/kWhNote de bas de page 32. Par ailleurs, pendant la même période et pour la même consommation, les clients de SaskPower ont déboursé 13,32 ⊄/kWh, ceux de Nova Scotia Power ont payé 14,60 ⊄/kWh, tandis que les mêmes 1000 kWh par mois ont coûté aux clients de Maritime Electric, à l'ÎleduPrince-Édouard, 15,06 ⊄/kWhNote de bas de page 33. En outre, les frais de service ou charges énergétiques imposées par SaskPower et Maritime Electric à leurs clients en région rurale, y compris à de nombreuses collectivités de Premières Nations, sont plus élevés, ce qui augmente la facture d'électricité de ces clientsNote de bas de page 34.
« …nos collectivités éloignées sont celles qui éprouvent le plus de difficulté, elles sont aussi les plus conscientes du coût véritable de l'énergie. [Ce programme] les aide à se renseigner sur la valeur de l'énergie… il existe des options et des coûts, ainsi que des avantages et des désavantages et il est important de choisir judicieusement. » – Répondant
Ces coûts plus élevés correspondent aux données fournies par les répondants à une étude de cas, particulièrement ceux du Canada atlantique qui étaient parvenus à réduire considérablement leurs factures d'électricité en utilisant la technologie des panneaux solaires. Les répondants ont indiqué que la principale raison pour laquelle les collectivités participent au programme écoÉNERGIE est de recourir aux systèmes d'énergie renouvelable pour réduire leurs coûts de chauffage et d'électricité. Les évaluateurs ont constaté que, même lorsqu'elles sont reliées au réseau, les collectivités autochtones et nordiques doivent acquitter des coûts d'électricité et de chauffage importants pour chauffer et éclairer les édifices appartenant à une bande et qui sont exploités par celle-ci. Bon nombre de ces édifices sont utilisés en grande partie par les membres de la collectivité et, par conséquent, ils consomment de l'électricité pour le chauffage et l'éclairage pendant un grand nombre d'heures chaque année. Dans certaines régions, les coûts d'électricité élevés ont eu des répercussions graves sur le budget de fonctionnement des collectivités, ce qui a eu une incidence sur leur capacité de s'attaquer à d'autres priorités. Par conséquent, dans les régions où les coûts d'énergie sont plus élevés, les collectivités reliées au réseau doivent adopter des systèmes d'énergie renouvelable pour aider à abaisser leurs coûts de l'énergie.
3) Collectivités reliées à un réseau qui entreprennent des projets d'énergie renouvelable dans le but de stimuler leur développement économique
« Sur le plan du développement économique, d'une manière générale l'énergie dans la région revêt une importance énorme pour les Premières Nations. » – Répondant
Le programme écoÉNERGIE offre aussi une occasion précieuse aux collectivités autochtones et nordiques en possession d'un territoire ou qui ont accès à des terrains de l'État comportant les caractéristiques naturelles nécessaires pour les grands projets d'énergie renouvelable. Ainsi, plusieurs grands projets d'énergie renouvelable, dont des microcentrales hydroélectriques et des centrales solaires ou de parcs éoliens, ont été réalisés par des collectivités avec les fonds du programme écoÉNERGIE. Ces projets permettent souvent aux collectivités reliées à un réseau de conclure des accords d'achat d'énergie avec les entreprises de services publics des provinces et des territoires pour vendre au réseau l'énergie qu'elles produisent. Ils peuvent constituer une importante source de revenus pour ces collectivités, qu'elles peuvent réinvestir dans d'autres possibilités de développement économique ou utiliser pour satisfaire d'autres besoins de la collectivité. Selon un rapport produit par Lumos Energy pour le compte d'AADNC en 2012, les grands projets hydroélectriques constituent l'une des meilleures formes de possibilités de développement économique pour les collectivités de Premières Nations, de Métis et d'Inuits, autant pendant la construction que pendant l'exploitation. De tels projets de développement ont tendance à générer des retombées économiques, souvent dans les régions plus éloignées et rurales du pays. C'est pourquoi il est opportun et important pour AADNC d'examiner les grands projets de développement hydroélectriques partout au CanadaNote de bas de page 35.
Cependant, la réalisation de ces projets nécessite un apport de fonds important. Les premières étapes de l'élaboration de grands projets d'énergie renouvelable sont particulièrement difficiles, en raison du grand nombre d'études requises pour en déterminer la viabilité. Les collectivités doivent souvent se débattre pour trouver les fonds nécessaires pour la phase d'étude exploratoire, laquelle est essentielle, puisqu'elle permet de produire les données chiffrées qui sont utilisées pour attirer d'autres partenaires financiers.
De façon générale, l'évaluation a montré que le programme écoÉNERGIE doit continuer à financer les projets d'énergie renouvelable afin de fournir de l'énergie et de la chaleur, de réduire la consommation de diesel, les émissions de GES et les risques connexes, d'abaisser les coûts et de favoriser le développement économique.
Constatation no 3 : Des exemples à l'échelle internationale démontrent qu'un programme écoÉNERGIE axé sur les collectivités hors réseau et les collectivités nordiques reste nécessaire.
Les entrevues menées auprès des gestionnaires du programme écoÉNERGIE attestent clairement que ce programme ne doit plus être axé sur le financement d'un large éventail de projets un peu partout au Canada, mais plutôt cibler les collectivités qui ont le plus besoin de solutions d'énergie renouvelable. Pour cette raison, le programme accorde désormais la priorité aux propositions de projet provenant de collectivités éloignées, non reliées à un réseau et qui dépendent du diesel, lesquelles sont situées dans les parties nord des provinces et au nord du 60e parallèle. Pour déterminer si cette évolution du programme permet de répondre aux besoins que celui-ci devrait continuer à satisfaire, les évaluateurs se sont appuyés sur un examen de la littérature pour recenser les meilleures pratiques et les enseignements acquis sur la scène internationale.
Cet examen de la littérature a montré que, depuis 2008, le gouvernement des États-Unis s'est donné comme priorité le développement de l'environnement riche en énergie renouvelable dans le nord de l'Alaska. Depuis 2008, il a injecté d'énormes ressources humaines et financières, notamment 202,5 millions de dollars dans 227 projets déployés en Alaska, afin de faire progresser la technologie de l'énergie renouvelableNote de bas de page 36. Il a soumis chaque collectivité à une évaluation complète et produit un instantané de haut niveau de l'option la moins coûteuse pour l'électricité, le chauffage de l'espace et le transport dans chaque collectivitéNote de bas de page 37. De plus, en juin 2008, un groupe de travail sur l'efficacité du diesel a été formé; ses membres devaient se concentrer sur la réduction de la consommation du diesel dans les collectivités rurales au moyen de mesures d'efficacité liées à la production et à la distributionNote de bas de page 38. Selon une évaluation du fonds d'énergie renouvelable de l'Alaska menée en 2012 par un tiers, les 62 premiers projets qui ont été financés vont éventuellement représenter un avantage net en valeur actuelle de plus d'un milliard de dollars au cours de leur vie. Le coût de ces projets s'élève à 508 millions de dollarsNote de bas de page 39.
En ce qui concerne l'expérience de l'Alaska, il convient de souligner que la coordination de la recherche et des projets a été assurée sur place, par le personnel de l'Alaska Energy Authority. L'objectif était de développer la capacité du personnel sur place et de le responsabiliser, afin de garantir que les Alaskiens ont accès à l'information sur l'énergie et de leur fournir un seul endroit pour traiter leurs problèmes et leurs possibilités en matière d'énergie. Le gouvernement de l'État compte fonder ses décisions à l'avenir sur l'information recueillie par le personnel de l'Alaska Energy Authority. En encourageant le perfectionnement du personnel sur place, l'Alaska Energy Authority a concentré [et continue à concentrer] l'expertise dans les organismes de gouvernance pour permettre des années de politiques éclairées et d'élaboration de programmesNote de bas de page 40. Le United States Office of Indian Energy, qui se consacre exclusivement à la promotion de la sécurité énergétique au sein des collectivités autochtones américaines, a été un partenaire majeur en ce qui concerne ces travaux. Le partenariat avec les intervenants à l'échelle communautaire a permis aux conseils de bande d'améliorer l'efficacité énergétique et facilité leur transition vers des systèmes d'énergie renouvelableNote de bas de page 41.
Le gouvernement de l'Alaska a aussi noué de solides partenariats avec des établissements d'enseignement et des centres de recherche, notamment l'Alaska Building Science NetworkNote de bas de page 42, pour faire progresser son programme d'énergie renouvelable.Note de bas de page 43 À titre d'exemple, l'Alaska Center for Energy and Power, à l'Université de l'Alaska, a créé une base de données comparatives qui fait ressortir les options et les limites en matière de technologies pour chaque ressource qui est identifiée. Dorénavant, AADNC pourra créer une base de données semblable pour déterminer les options appropriées aux collectivités nordiques du Canada en matière de technologique, afin de faire des recommandations à celles qui demandent de l'aide.
Parallèlement à l'expérience de l'Alaska, les collectivités éloignées et nordiques relevant d'AADNC ont élaboré de nombreux plans énergétiques de haute qualité au fil des ans, mais peu ont été menés à terme. En Alaska, la réponse a consisté à amener les Alaskiens à contribuer à la solution, à participer activement à la sélection et à prendre en main leurs sources d'énergie de remplacementNote de bas de page 44. Même si le budget d'AADNC est nettement inférieur à celui de l'Alaska (20 millions de dollars sur cinq ans pour tout le Canada, comparativement à 50 millions de dollars par année uniquement pour l'Alaska), le Canada pourrait s'inspirer de l'expérience de l'Alaska et impliquer davantage les intervenants locaux dans la recherche et les investissements dans les collectivités nordiques ciblées.
L'examen de la littérature a aussi confirmé que la concentration sur les collectivités hors réseau ou rurales, en ce qui concerne le développement de systèmes d'énergie renouvelable, est une pratique exemplaire internationale qui a été appliquée par l'Australie, la Chine et l'Allemagne. En Australie, le programme d'énergie renouvelableNote de bas de page 45 est essentiellement axé sur les collectivités hors réseau et inclut les groupes autochtonesNote de bas de page 46 Note de bas de page 47 Note de bas de page 48.
La Chine a toujours préféré les expansions de réseaux, mais elle s'est récemment tournée vers les systèmes autonomes (c.-à-d. non reliés au réseau) qui se sont démarqués par leur fiabilité et l'amélioration de leur abordabilité. Le pays s'est concentré sur les peuplements minoritaires éloignés et pauvres en combinant entre autres les technologies hydroélectriques, solaires, éoliennes et géothermiques. Selon la Chine, la clé de sa réussite (99 % des habitants des régions rurales ont l'électricité) réside dans l'engagement du gouvernement à l'égard de la planification communautaire et du financement à long termeNote de bas de page 49 Note de bas de page 50.
En 2010, l'Allemagne a adopté sa Loi sur les sources d'énergie renouvelable qui prévoit une gamme complète d'incitatifs et de subventions pour favoriser le développement de l'énergie renouvelable; elle est maintenant un chef de file en matière de transition vers l'énergie renouvelable. Même si le pays ne compte aucune collectivité « éloignée », il attribue son succès surtout à la mise en application d'une politique axée sur la prise en charge par la collectivité par l'intermédiaire d'initiatives de coopérationNote de bas de page 51. Les profits réalisés au moyen des systèmes d'énergie renouvelable appartenant aux collectivités ont été consacrés aux maternelles, aux installations sportives et aux lieux de rassemblementNote de bas de page 52. L'expérience de l'Allemagne confirme l'utilité pour AADNC de continuer à investir dans le soutien du développement de systèmes d'énergie renouvelable dans les édifices communautaires, car les économies de coûts réalisées dans les dépenses publiques peuvent servir à fournir d'autres programmes et services communautaires.
En outre, l'Agence internationale de l'énergie a insisté sur le fait que le succès d'une stratégie d'énergie renouvelable doit inclure un cadre stratégique stable et habilitant permettant l'engagement et la prise en charge communautaire, des marchés favorables, incluant des subventions pour encourager l'utilisation, pour créer la capacité communautaire et pour faciliter la compréhension de l'énergie renouvelable et la sensibilisation à celle-ci.
3.2 Harmonisation avec les rôles et les responsabilités
Constatation no 4 : Le programme écoÉNERGIE est conforme aux rôles et aux responsabilités du gouvernement fédéral, et plus particulièrement au mandat d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.
La présente évaluation montre que les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral et d'AADNC sont complexes et qu'ils sont liés aux responsabilités provinciales et territoriales. De nombreux programmes de financement fédéraux, provinciaux et territoriaux ont été mis en place et continuent d'évoluer afin de faciliter le développement des technologies et leur adaptation aux conditions du Nord, d'accroître la capacité de production à partir de sources d'énergies renouvelables dans les communautés et de mettre en œuvre des projets d'énergies renouvelables.
C'est aux provinces et aux territoires qu'incombent essentiellement les rôles et les responsabilités en matière d'approvisionnement énergétique des communautés. Le gouvernement fédéral, pour sa part, soutient l'intégration du secteur des énergies renouvelables dans l'ensemble du pays.
Jusqu'à maintenant, les provinces et les territoires ont été les principaux promoteurs des programmes d'économie d'énergie, le gouvernement fédéral ayant tendance à apporter un soutien aux provinces et aux territoires, en déterminant les technologies des énergies renouvelables éprouvées et en faisant la promotion par la mise en place d'une approche nationale cohérente. Ce rôle de soutien du gouvernement fédéral auprès des administrations provinciales et territoriales, dans le développement des énergies renouvelables, est largement documenté. De fait, selon l'Agence internationale de l'énergie, le succès des politiques nationales en matière d'énergies renouvelables dépend de la mise en place d'un cadre gouvernemental qui facilite les projets de recherche et développement par l'industrie, jusqu'à ce que le secteur des énergies renouvelables prenne de l'essor et devienne un secteur prévisible, flexible et crédible. Les efforts doivent également inclure des mesures visant à réduire les obstacles économiques afin de faciliter la mise en place des technologies des énergies renouvelables. Lorsque les politiques sur les énergies renouvelables auront été élaborées et que les technologies renouvelables deviendront largement acceptées par le public et intégrées aux infrastructures existantes, le gouvernement fédéral pourra éliminer progressivement son aide cibléeNote de bas de page 53. À ce stade-ci, le rôle d'AADNC est donc d'accroître la visibilité et la viabilité des technologies des énergies renouvelables dans les communautés des réserves et les communautés du Nord, en attendant que ces technologies deviennent facilement accessibles et acceptées en tant qu'investissements publics courants et que les provinces et territoires mettent en place des cadres stratégiques qui puissent assurer la viabilité de ces systèmes.
« Le diesel est l'énergie privilégiée dans le Nord, en raison de la constance d'approvisionnement. La constance de l'approvisionnement, voilà l'élément préoccupant. Le financement d'études de faisabilité aide à changer les mentalités et à bâtir la confiance envers les technologies des énergies renouvelables. Les gens ont peur de prendre le risque de passer du diesel à une source d'énergie moins sûre. La transition vers de nouvelles technologies doit se faire de façon graduelle. L'élimination complète du diesel prendra beaucoup de temps… voilà pourquoi [le gouvernement] doit produire des résultats. » – Répondant
La mise en place d'un programme fédéral ayant pour but de promouvoir l'adoption des technologies des énergies renouvelables pour réduire les émissions de GES s'inscrit également dans les tendances internationales. De fait, dans toutes les classes de revenus, le pourcentage de pays ayant adopté une politique nationale en matière d'énergies renouvelables a augmenté de façon soutenue au cours de la dernière décennie. L'Assemblée générale des Nations Unies a désigné la prochaine décennie (c.à-d. de 2014 à 2024) « Décennie internationale de l'énergie durable pour tousNote de bas de page 54 », le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a indiqué qu'il était impératif d'amorcer une transition immédiate vers des énergies plus propres afin de réduire les conséquences catastrophiquesNote de bas de page 55 et les plus grandes économies mondiales et plus gros émetteurs de GES (qui représentent plus du tiers des émissions mondiales de GES) – à savoir la Chine et les États-Unis – ont annoncé des plans visant à réduire considérablement leurs émissions de carbone. Ainsi, les États-Unis se sont engagés à réduire, d'ici 2025, leurs émissions de GES de 26 à 28 % par rapport aux niveaux de 2005, alors que la Chine espère que ses émissions de CO2 commenceront à diminuer à partir de 2030 ou avant, grâce à une augmentation de la proportion d'énergie produite à partir de combustibles non fossiles, son objectif étant que cette proportion atteigne 20 % de la production totale d'énergie d'ici 2030. Ces engagements sont reconnus comme étant essentiels à l'intensification des efforts à l'échelle mondiale. Des engagements plus officiels doivent être négociés en prévision de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015 (CdP 21) qui se tiendra à Paris, en FranceNote de bas de page 56.
La production, le transport et la distribution de l'électricité relèvent de la compétence des provinces et des territoires, qui ont également compétence en matière de réglementation de ce secteur. Chaque province et territoire a établi une Loi sur les entreprises de service public, qui prévoit la création d'un conseil ou d'un office chargé de prendre des décisions et de formuler des recommandations concernant le fonctionnement des entreprises publiques ou privées de services publics qui sont responsables de la production et de la distribution de l'électricité. La présente évaluation révèle qu'un éventail d'investissements dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie ont été faits par l'ensemble des provinces et territoires, qui offrent en plus des incitatifs pour encourager l'introduction de systèmes d'énergies renouvelables. Le graphique qui suit illustre le nombre total d'incitatifs, d'initiatives ou de programmes (et non l'investissement total) mis en place dans chaque province et territoire.
Figure 2 : Incitatifs offerts par les provinces et territoires canadiens dans le domaine énergétiqueNote de bas de page 57
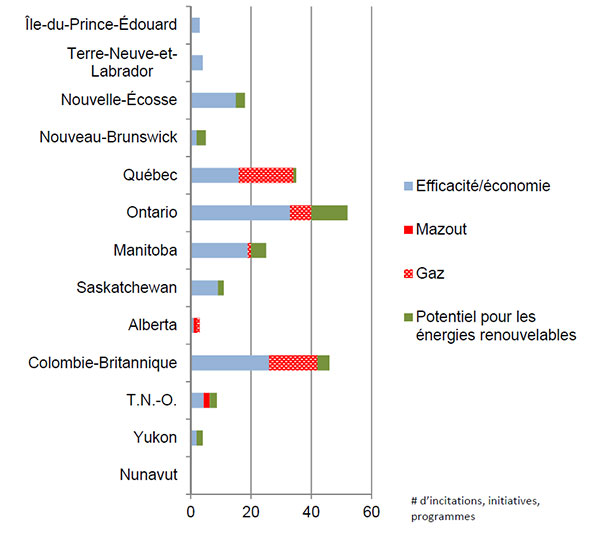
Équivalent textuel de la figure 2 Incitatifs offerts par les provinces et territoires canadiens dans le domaine énergétique
Ce graphique en barres brosse le tableau des incitatifs en matière d’énergie offerts dans les provinces et les territoires canadiens. L’axe des ordonnées représente les provinces et territoires. Ce sont dans l’ordre, de haut en bas, l’Î.-P.-É., T.-N.-L., la N.-É., le N.-B., le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la C.-B., les T.N.-O., le Yukon et le Nunavut. L’axe des abscisses représente le nombre d’incitatifs, d’initiatives ou de programmes (IIP) dans chaque province ou territoire sur une échelle graduée de 0 à 60 en échelons de 20. Les codes de couleurs de la légende indiquent quatre différentes phases et approches d’utilisation de l’énergie, soit l’efficacité ou la conservation, le pétrole, le gaz et le potentiel d’énergies renouvelables.
Seulement quatre provinces offrent plus de 20 IIP, à savoir le Québec, l’Ontario, le Manitoba et la C. B. Parmi ces dernières, l’Ontario et la C.-B.. ont mis en place plus de 40 IIP. Les IIP de ces quatre provinces portent tous sur l’efficacité ou la conservation, le gaz et le potentiel d’énergies renouvelables.
Le Nunavut est la seule province ou territoire qui n’offre aucun IIP.
Les IIP de l’Î.-P.-É. et de T.-N.-L. sont axés sur l’efficacité ou la conservation.
Les IIP de la N.-É., du N.-B., la Saskatchewan et du Yukon portent sur deux points, soit l’efficacité ou la conservation et le potentiel d’énergies renouvelables.
Les IIP de l’Alberta portent à part presque égale sur trois points, soit l’efficacité ou la conservation, le pétrole et le gaz.
Les IIP des Territoires du Nord-Ouest touchent trois aspects, soit l’efficacité ou la conservation, le pétrole et le potentiel d’énergies renouvelables.
Les IIP de l’Alberta et du N.-B. ciblent le moins souvent l’efficacité ou la conservation. Près de la moitié des IIP du Québec et des T. N.-O. ont trait à l’efficacité ou à la conservation. La majorité des IIP de toutes les autres provinces ciblent l’efficacité ou la conservation.
Comme l'indique le graphique qui précède, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont concentré principalement leurs efforts sur l'économie d'énergie et l'amélioration de l'efficacité des technologies énergétiques existantes. En plus de ces programmes et incitatifs, les gouvernements provinciaux et territoriaux de l'ensemble du Canada disposent également d'une variété d'instruments réglementaires pour promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables, notamment les suivants :
- programmes de compensation en vertu desquels un tarif majoré peut être versé sur votre facture de services publics pour la création de nouveaux systèmes d'énergie renouvelable permettant de compenser pour la consommation d'énergie de votre maison ou édifice ou de remplacer cette consommation par des énergies de sources renouvelables;
- approvisionnement par demandes de propositions ou demandes visant à augmenter la quantité d'énergies renouvelables, par un appel de soumissions auprès des fournisseurs d'énergies renouvelables;
- programmes d'offre standard, de tarifs de rachat garantis et de subventions offrant un tarif majoré pour les énergies renouvelables;
- adoption de normes obligatoires relatives au portefeuille d'énergies renouvelables, ou obligation pour les services publics de produire une quantité précise d'énergie à partir de sources renouvelables;
- système de facturation nette qui permet aux producteurs d'énergies renouvelables de vendre leur énergie excédentaire au réseau électrique public; et
- facturation nette au compteur, qui offre aux consommateurs qui produisent de l'électricité à partir d'énergies renouvelables la possibilité de se relier au réseau public pour compenser leur consommation, de rester branchés au réseau public et de satisfaire à leurs besoins énergétiques à partir de leurs propres systèmes si le service public est incapable d'y répondre.
L'Alberta a mis en place un programme de compensation et toutes les autres provinces utilisent des demandes de propositions. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard ont également établi des normes obligatoires relativement au portefeuille des énergies renouvelables. L'Ontario, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique offrent des programmes d'offre standard et de subventions. Le tableau qui suit présente la série de politiques en matière d'énergies renouvelables, par province et territoire.
| Province | Cible d'énergie renouvelable | Programme de compensation | Achat d'énergies renouvelables | Offre standard et tarif de rachat garanti | Normes pour le portefeuille des énergies renouvelables | Facturation nette | Facturation nette au compteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | Oui | Oui | |||||
| Alberta | Oui | Oui | Oui | ||||
| Saskatchewan | Oui | Oui | Oui | ||||
| Manitoba | Oui | ||||||
| Ontario | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Québec | Oui | Oui | Oui | ||||
| Nouveau-Brunswick | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Nouvelle-Écosse | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Île-du-Prince-Édouard | Oui | Oui | Oui (Éolienne seulement) |
Oui | Oui | ||
| Yukon | Stratégie énergétique en vertu de laquelle le Yukon s’engage à accroître de 20 % l’approvisionnement en énergies renouvelables et l’utilisation de ces énergies d’ici 2020. | ||||||
| Territoires du Nord Ouest | Fonds pour l’énergie renouvelable visant à subventionner la production d’énergies renouvelables : hydroélectricité, bioénergie et énergie solaire. | ||||||
| Nunavut | La stratégie Ikummatiit, une stratégie énergétique territoriale qui met l’accent sur les sources d’énergie de remplacement et l’utilisation efficace de l’énergie, devait être mise en œuvre, mais elle ne l’a jamais été. | ||||||
De plus, près d'une centaine de municipalités canadiennes ont établi des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serreNote de bas de page 61 Note de bas de page 62.
Bien que ces programmes provinciaux et territoriaux soient souvent offerts aux communautés dans les réserves, ils sont principalement mis en place dans des communautés hors réserves. AADNC offre des programmes comparables aux communautés dans les réserves.
Il ne fait aucun doute, à la lecture de ces exemples, que le gouvernement fédéral a un rôle évident à jouer pour promouvoir l'adoption des technologies des énergies renouvelables, alors que les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent axer leurs efforts sur l'amélioration du rendement des infrastructures énergétiques existantes et sur l'établissement d'un environnement propice aux investissements. Cependant, il est évident aussi que les rôles et les responsabilités des différents ministères fédéraux peuvent se chevaucher, en particulier dans le Nord où AADNC est moins lié par ses engagements en vertu de la Loi sur les Indiens et où d'autres ministères fédéraux apportent un soutien considérable.
Bien que, comme il a été mentionné précédemment, AADNC n'ait pas le mandat direct d'investir dans le soutien des technologies des énergies renouvelables, le Ministère a pris la décision stratégique d'investir dans les technologies des énergies renouvelables dans les communautés autochtones et du Nord de l'ensemble du Canada, en vertu de son mandat sur le plan socioéconomique. La revue de la littérature confirme que la promotion de l'utilisation des technologies des énergies renouvelables se justifie également par des motifs sociaux, politiques et économiques qui vont au-delà de la réduction des émissions de GES. De fait, ces technologies peuvent avoir de profonds bienfaits sur la santé, l'éducation et l'environnement des communautés. Elles peuvent également contribuer à améliorer l'accès à l'énergie et la sécurité énergétique, aider à réduire la pauvreté et favoriser l'égalité des sexes, la création d'emplois et le développement économique ruralNote de bas de page 63 Note de bas de page 64 Note de bas de page 65. Les communautés autochtones et du Nord qui relèvent du mandat d'AADNC ont besoin de sources durables et fiables d'énergie pour être en mesure de participer pleinement au développement politique, social et économique du Canada. En mettant l'accent sur l'intégration des technologies des énergies renouvelables dans les communautés hors réseau, AADNC peut réduire les coûts de fonctionnement liés au diesel, prolonger la durée de vie des infrastructures de production d'énergie existantes, favoriser la croissance des communautés et bâtir des communautés durablesNote de bas de page 66.
Par ailleurs, les enjeux énergétiques ont une incidence sur certains secteurs de programmes économiques, sociaux et environnementaux qui relèvent du mandat d'AADNC. Les difficultés causées par des infrastructures énergétiques peu performantes et la perturbation de l'approvisionnement énergétique limitent les retombées des programmes de développement économique mis en œuvre par AADNC. De plus, la fluctuation des coûts du carburant, la hausse des coûts de transport du carburant et l'accroissement de la demande résultant d'une croissance rapide de la population exercent des pressions sur le budget d'AADNC, tout en augmentant les émissions de polluants atmosphériques produits par la combustion de diesel. À cela s'ajoutent les défis environnementaux occasionnés par les déversements de carburant pouvant survenir durant le transport, l'entreposage local et le transfert de carburant, qui causent des dommages aux habitats sensibles et dont le nettoyage incombe à AADNC. En proposant des solutions axées sur les énergies durables pour résoudre ces problèmes énergétiques, les secteurs de programmes d'AADNC peuvent progresser. Le rôle d'AADNC dans le soutien des projets axés sur les technologies des énergies renouvelables est donc multidimensionnel.
En choisissant d'investir dans les technologies des énergies renouvelables, AADNC contribue à améliorer la sécurité énergétique et la viabilité des communautés autochtones et du Nord au CanadaNote de bas de page 67. Une fois implantés et mis en service, les systèmes énergétiques gérés par les communautés locales favoriseront les possibilités de développement économique local, faciliteront l'établissement de partenariats avec le secteur privé, contribueront à une hausse de l'emploi et au développement des compétences et répondront aux besoins d'une population croissante. De plus, l'augmentation de l'approvisionnement en énergie renouvelable réduira la production de polluants atmosphériques, les déversements de carburant et la contamination par le carburant, ce qui contribuera à améliorer la santé humaine et à protéger l'environnement local. Une diminution de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés, combinée à l'amélioration de l'efficacité énergétique, permettra de réduire les coûts énergétiques. En règle générale, l'amélioration de l'infrastructure énergétique se traduit par une augmentation des sources d'énergie durables et sûres, des possibilités économiques plus diversifiées et plus vigoureuses et des communautés plus autonomes, ce qui est compatible avec le mandat d'AADNC.
Au nord du 60e parallèle, les rôles et les responsabilités d'AADNC et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord se chevauchent, en ce qui a trait au développement de projets axés sur les énergies renouvelables
Au sud du 60e parallèle, AADNC est investi d'un mandat clair pour ce qui est d'aider les communautés des réserves à mettre en œuvre des projets sur les énergies renouvelables, ce mandat étant conforme aux engagements pris par le Canada et la communauté internationale en matière de réduction des émissions de GES. Dans le Nord, les rôles et les responsabilités précis d'AADNC, en ce qui a trait à la production, au stockage et à la distribution d'énergie, sont plus complexes, car les régimes énergétiques diffèrent dans chacun des trois territoiresNote de bas de page 68. De fait, les régimes énergétiques varient en fonction des responsabilités qui sont transférées du gouvernement fédéral aux territoires, des droits des peuples autochtones négociés en vertu de traités, des revendications territoriales et des ententes sur l'autonomie gouvernementale, ainsi que des pouvoirs des territoires relativement à la délivrance des licences et des permis aux fournisseurs de services énergétiques. Compte tenu des rôles et des mandats qui sont conférés aux territoires en vertu de la loi, et de la proximité de ces derniers avec les citoyens du Nord, il incombe aux gouvernements territoriaux d'assumer les rôles les plus directs dans le maintien de l'approvisionnement énergétique local, afin d'assurer le bien-être socioéconomique global de leurs régions. Chaque administration territoriale a mis en place des services publics qui ont pour mandat de développer les sources d'approvisionnement en énergie dans leur territoire respectif et d'investir dans la production, le transport et la distribution d'énergie si l'entreprise privée ne le fait pas. Au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, il existe également des services publics qui appartiennent à des intérêts privésNote de bas de page 69.
« Dans le Nord, les besoins sont fondamentaux : création d'emplois, économies de coûts et sécurité énergétique. » – Répondant
Dans le Nord où les communautés situées dans des réserves sont peu nombreuses, AADNC a un rôle moins clairement défini en ce qui a trait au développement et à la mise en place d'infrastructures, y compris dans le cadre des projets énergétiques. Le Ministère a pour mandat d'appuyer les habitants du Nord dans leurs efforts visant à améliorer leur bien-être social et leur prospérité économique, à développer des communautés plus saines et plus autonomes ainsi qu'à participer davantage au développement politique, social et économique du Canada pour le bien de l'ensemble des Canadiens – ce qui pourrait inclure les projets d'énergies renouvelables. Au Nunavut plus particulièrement, qui n'a pas encore adopté de stratégie énergétique et où les travaux se poursuivent en vue de terminer l'entente de transfert des responsabilités, AADNC a un rôle précis à jouer dans le développement et la mise en œuvre des projets énergétiques. En revanche, dans les territoires où il y a déjà eu transfert de responsabilités, c'est-à-dire au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, les gouvernements territoriaux, comme leurs homologues provinciaux, ont un rôle précis à jouer dans la prestation des services énergétiques. Le rôle d'AADNC est d'autant plus complexe que d'autres ministères et organismes assument également des responsabilités relativement à la production d'énergie dans le Nord. Le Secteur de l'énergie de Ressources naturelles Canada est le chef de file dans le domaine des politiques énergétiques, de la recherche sur les énergies propres et du développement technologique, et Ressources naturelles Canada est le centre des connaissances du gouvernement du Canada pour ce qui est de l'expertise scientifique sur les technologies des énergies propresNote de bas de page 70. L'Office national de l'énergie a pour objectif de promouvoir, dans l'intérêt public canadien, la sûreté et la sécurité, la protection de l'environnement et l'efficience de l'infrastructure et des marchés énergétiques, en s'en tenant au mandat conféré par le Parlement au chapitre de la réglementation des pipelines, de la mise en valeur des ressources énergétiques et du commerce de l'énergie. La nouvelle Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique mettra l'accent sur l'introduction de systèmes d'énergies renouvelables dans le Nord canadien, lequel inclut non seulement les zones situées au nord du 60e parallèle, mais également les portions nord des territoiresNote de bas de page 71. Enfin, l'Agence canadienne de développement économique du Nord a la responsabilité d'améliorer l'assise économique du Nord (au nord du 60e parallèle), ce qui peut inclure l'exploitation des technologies des énergies renouvelablesNote de bas de page 72.
Bien que de nombreux partenaires fédéraux participent à la recherche sur les technologies des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement et à la mise en place de ces technologies, le mandat de l'Agence canadienne de développement économique du Nord empiète directement sur celui d'AADNC au nord du 60e parallèle. L'Agence canadienne de développement économique du Nord, qui faisait à une époque partie d'AADNC, est aujourd'hui un organisme de développement régional qui collabore avec des partenaires et des intervenants en vue de promouvoir une diversification durable de l'économie dans les trois territoires du Canada, par le financement de programmes, l'élaboration de politiques et la conduite de recherches. Bien que l'Agence canadienne de développement économique du Nord ne finance pas nommément les énergies renouvelables, elle peut financer, et a de fait financé, des projets sur les énergies renouvelables qui s'inscrivent souvent dans le cadre de son programme Investissements stratégiques dans le développement économique du NordNote de bas de page 73 Note de bas de page 74. L'Agence canadienne de développement économique du Nord a notamment financé plusieurs importants programmes sur les énergies renouvelables dans les Territoires du Nord-Ouest et au YukonNote de bas de page 75.
Chevauchement entre les rôles et responsabilités de plusieurs secteurs, au sein d'AADNC, qui apportent une aide financière à l'élaboration de projets d'énergie renouvelable
Les résultats d'une analyse réalisée par des évaluateurs à l'égard des divers intervenants et bailleurs de fonds impliqués dans des projets d'énergie renouvelable au sein de collectivités autochtones et nordiques, ainsi que des exemples à l'échelle internationale, ont montré que le programme écoÉNERGIE doit occuper un créneau particulier. À l'heure actuelle, le programme écoÉNERGIE assure le financement d'études de faisabilité portant sur de grands projets d'énergie renouvelable, dans le cadre du volet A, et finance l'intégration de technologie des énergies renouvelables à des immeubles appartenant à des bandes, dans le cadre du volet B. Cependant, comme le démontre le contenu de l'annexe A, il ressort de l'évaluation que les projets d'énergie renouvelable qui sont admissibles à la fois sous le volet A et sous le volet B peuvent également être appuyés par d'autres sources de financement au sein d'AADNC. Plus précisément, les études de faisabilité sont admissibles aux programmes de développement économique d'AADNC et ont reçu des fonds dans le cadre de ces programmes. En outre, l'intégration de technologie renouvelable à des immeubles communautaires existants a été appuyée par la Direction générale des infrastructures communautaires d'AADNCNote de bas de page 76. À bien des égards, ces autres bailleurs de fonds sont des sources de financement plus appropriées pour les projets d'énergie renouvelable mis en œuvre au sein de collectivités sur le réseau, car ils disposent de fonds plus importants, sont assujettis à moins de restrictions et possèdent une expertise interne en matière de développement économique et d'infrastructure.
Toutefois, dans le cas des collectivités éloignées hors réseau et des collectivités nordiques, le potentiel économique des projets d'énergie renouvelable est faible, car il s'agit de petites collectivités dans lesquelles il y a peu de clients éventuels. Par conséquent, dans de telles circonstances, ces projets ne remplissent pas les critères d'admissibilité aux programmes de développement économique d'AADNC. De plus, en raison de leur envergure et de leur complexité, les projets d'énergie renouvelable ne s'inscrivent pas dans la portée des programmes d'infrastructure d'AADNC. Ces dernières années, le programme écoÉNERGIE s'est de plus en plus articulé autour des collectivités éloignées et nordiques, en raison du réel besoin de soutien de ces collectivités.
L'évolution du programme écoÉNERGIE, liée au choix de se concentrer uniquement sur les collectivités éloignées, nordiques et hors réseau, pourrait avoir pour effet de réduire le chevauchement et le double emploi au sein d'AADNC. Cependant, afin de s'assurer que les écarts de financement sont réduits au minimum, les responsabilités liées au financement des études de faisabilité dans les collectivités sur le réseau, ainsi qu'à l'intégration de technologie renouvelable aux immeubles existants au sein de collectivités sur le réseau, doivent être transférées au Secteur des terres et du développement économique et à la Direction générale des infrastructures communautaires (DGIC) respectivement. L'évaluation a révélé que l'exploitation de la technologie des énergies renouvelables offre des possibilités de développement économique prometteuses pour les collectivités sur le réseau. De même, il existe une forte demande des collectivités à l'égard d'études de faisabilité portant sur des projets d'énergie renouvelable de grande envergure, car le programme écoÉNERGIE n'a pu fournir qu'un financement d'environ 2,1 millions de dollars sur les 20 millions de dollars demandés par les collectivités reliées au réseau. Comme l'indique le présent rapport dans les pages qui suivent, AADNC doit continuer à promouvoir ces possibilités.
Recommandation nº 1 : Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE définisse clairement son créneau, en mettant l'accent sur les projets d'énergie renouvelable dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau.
Recommandation nº 2 : Étant donné que le programme écoÉNERGIE met l'accent sur les collectivités hors réseau et nordiques, il est recommandé que le personnel du programme transmette au Secteur des terres et du développement économique (p. ex. au Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques) les leçons apprises, les pratiques exemplaires et les propositions de projets du volet A pertinentes, car ce Secteur finance déjà ce type de projets. Le personnel du programme devrait également informer les collectivités du changement d'orientation du programme, et leur fournir des renseignements concernant les éventuelles possibilités de financement par le Secteur des terres et du développement économique.
3.3 Harmonisation avec les objectifs fédéraux, ministériels et communautaires
Constatation nº 5 : Le programme écoÉNERGIE cadre avec les priorités fédérales, avec les priorités d'AADNC, et avec les besoins et priorités des collectivités autochtones et nordiques.
Le programme écoÉNERGIE respecte et appuie les priorités du gouvernement du Canada, d'AADNC et des collectivités autochtones et nordiques. Plus particulièrement, le gouvernement du Canada a démontré son engagement à lutter contre le réchauffement de la planète, en signant la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et en participant au Dialogue Canada-États-Unis sur l'énergie propreNote de bas de page 77. Le Canada a également signé l'Accord de Copenhague, en vertu duquel le pays s'est engagé à réduire ses émissions de GES de 17 % d'ici 2020 par rapport aux niveaux de 2005Note de bas de page 78.
Le développement de la technologie des énergies renouvelables et l'implantation de cette technologie dans les collectivités autochtones et nordiques ont été désignés comme des priorités par le gouvernement du Canada, dans des documents critiques et des déclarations publiques. Plus spécifiquement, dans le discours du Trône de 2011, le gouvernement a déclaré qu'il favoriserait « le déploiement de technologies énergétiques propres dans les communautés autochtones et du Nord »Note de bas de page 79. En outre, dans le Plan d'action économique de 2011, il était indiqué ceci : « la prochaine phase du Plan d'action économique du Canada accroît le leadership du pays en matière de développement et de promotion des technologies d'énergie propre »Note de bas de page 80. En août 2011, John Duncan, alors ministre d'AADNC, a fait remarquer que l'investissement dans les projets d'énergie propre « renforce la volonté du gouvernement du Canada de travailler avec les collectivités pour réagir aux changements climatiques », tandis que John Baird, ministre des Affaires étrangères, a affirmé ceci : « le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer l'efficacité énergétique partout au pays »Note de bas de page 81. Ces déclarations indiquent clairement que la promotion des projets d'énergie renouvelable au sein des collectivités autochtones et nordiques est une priorité pour le gouvernement du Canada.
La promotion de la technologie des énergies renouvelables et l'amélioration de la fiabilité et de la durabilité de l'énergie fournie aux collectivités autochtones et nordiques sont également des priorités claires pour AADNC. Le programme écoÉNERGIE cadre avec le résultat stratégique, les terres et l'économie car il aide les collectivités des Premières Nations à acquérir, construire, posséder, exploiter et entretenir une infrastructure de base qui protège leur santé et leur sécurité et leur permet de s'intégrer à l'économieNote de bas de page 82. De plus, les rapports 2010-2011, 2011-2012, 20122013 et 2013-2014 sur les plans et les priorités d'AADNC font état d'un engagement à mettre l'accent sur la réduction des émissions de GES dans les collectivités autochtones et nordiques en appuyant le développement d'énergies renouvelables et des projets d'efficacité énergétique. Le programme écoÉNERGIE sert également directement l'objectif intitulé « Relever les défis des changements climatiques et de la qualité de l'air », énoncé dans la Stratégie fédérale de développement durable 2013-2016, ainsi que les objectifs du Cadre fédéral pour le développement économique des Autochtones et de la Stratégie pour le Nord du Canada de AADNC.
« Nous sommes considérés comme les gardiens de l’environnement. » – Dirigeant d’une collectivité interrogé
L'investissement dans les systèmes d'énergie renouvelable est également une priorité pour de nombreuses collectivités autochtones et nordiques, qui souhaitent réduire leur dépendance au diesel (dans le cas des collectivités hors réseau), réduire leurs coûts énergétiques et promouvoir les possibilités de développement économique. À titre d'exemple, selon Math'ieya Alatini, chef de la Première Nation de Kluane, le projet de système diesel-éolien de cette Première Nation est en accord avec toutes les valeurs qu'incarne une Première Nation…laisser une faible empreinte écologique; toujours penser aux générations futures lors de la prise de décisions; prendre soin de la terre…l'utilisation d'énergie responsable est une question de bon sensNote de bas de page 83.

D'autres dirigeants de collectivités ont affirmé que les projets d'énergie renouvelable qui permettent de réduire l'utilisation du diesel et sont des facteurs de développement économique « changent la donne » pour les collectivités. Un chef interrogé dans le cadre de l'évaluation a indiqué que sa collectivité souhaitait que son projet soit un exemple pour les autres collectivités et prouve qu'il vaut la peine d'investir dans l'énergie verte. Cette évaluation a montré que les collectivités autochtones et nordiques sont déterminées à faire en sorte que la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable en leur sein soit un succès, et, à cet égard, le programme écoÉNERGIE cadre parfaitement avec les priorités des bénéficiaires du programme.
3.4 Efficacité du programme
Constatation nº 6 : Le programme écoÉNERGIE donne les résultats attendus en matière d'élaboration et de réalisation de projets d'énergie renouvelable viables.
Dans le cadre du volet A du financement du programme écoÉNERGIE, AADNC contribue aux projets présentant un important potentiel de réduction des émissions de GES.
Entre avril 2011 et mars 2014, le programme écoÉNERGIE a financé 111 projets au Canada, dont 57 projets sous le volet A (études de faisabilité) dans 43 collectivités, et 54 projets sous le volet B (projets d'énergie renouvelable intégrés à des immeubles communautaires nouveaux ou existants). Depuis avril 2014, le programme a également approuvé le financement de 14 projets supplémentaires sous le volet A et de 18 projets supplémentaires sous le volet B.
Les activités de suivi des projets du volet A menés à bien dans le cadre du programme écoÉNERGIE ont révélé que, en novembre 2014, 12 % des 43 collectivités ayant réalisé des études de faisabilité étaient passées à l'étape de la mise en œuvre : trois projets étaient en cours de réalisation tandis que trois autres étaient déjà opérationnels. Parmi les projets opérationnels, citons notamment la centrale solaire de la Première Nation d'Alderville, et le projet de la Première Nation Behdzi Ahda" (Colville Lake) concernant l'utilisation d'énergie solaire et l'intégration, à son groupe électrogène diesel, d'un système de stockage dans des batteries.

Selon les résultats de l'évaluation, 65 % des projets visés par les études financées font toujours l'objet d'évaluations supplémentaires et sont en cours d'élaboration. Seulement 23 % des projets visés par des études réalisées dans le cadre du volet A ont été classés comme des projets non faisables, interrompus ou à l'état d'avancement inconnu. La majorité des 43 collectivités ayant reçu des fonds pour la réalisation d'études de faisabilité se trouvent en Colombie-Britannique (51 % des projets) et en Ontario (23 % des projets). La plupart des projets financés (42 %) étaient des études de faisabilité portant sur des projets hydroélectriques.
« La plupart des bailleurs de fonds sont trop réfractaires au risque. Il est très important d’obtenir ce financement de démarrage [pour la réalisation des études de faisabilité]. » – Un entrepreneur
Certaines personnes interrogées et certains chefs de projet ont fait remarquer que l'étape de la faisabilité et l'étape de la conception d'un projet d'énergie renouvelable sont celles qui présentent le plus haut risque d'investissement, car, à ces étapes, le risque que le projet ne porte pas ses fruits est élevé. AADNC choisit de prendre ce haut risque d'investissement, et malgré cela le programme donne tout de même les résultats attendus en matière d'élaboration et de réalisation de projets d'énergie renouvelable viable. Sur l'ensemble des projets du volet A, 12 % sont maintenant achevés et 65 % sont en voie de mise en œuvre. Cependant, les collectivités qui ont reçu des fonds du programme écoÉNERGIE pour l'étape de l'étude de la faisabilité de projets d'énergie renouvelable de plus grande envergure ont encore des défis à relever. Voici des exemples des difficultés associées à la réalisation de projets de grande envergure, tels que des projets de construction de microcentrales hydroélectriques, de centrales solaires ou de parcs éoliens, sans autre soutien de la part du programme écoÉNERGIE :
- La nécessité de trouver le financement indispensable afin de mener à bien les éventuelles études supplémentaires et évaluations environnementales requises pour que le projet soit attrayant aux yeux des investisseurs ou viable sur le plan commercial.
- La nécessité d'obtenir la mise de fonds requise pour mettre au point la technologie énergétique. Les obstacles sont particulièrement nombreux pour les collectivités hors réseau, dans les cas où l'analyse de rentabilisation pourrait ne pas être suffisamment solide si les coûts venaient à excéder les prix actuels du diesel et si la possibilité d'investissement privé est mince. Il arrive que certains projets, bien que considérés comme faisables, ne soient pas viables sur le plan économiqueNote de bas de page 84.
- Le manque de politiques et de programmes d'aide à l'échelle provinciale.
- Le fait que la collectivité ne possède pas la compétence administrative requise pour gérer le projet et obtenir la myriade de permis et d'approbations nécessaires pour entreprendre la réalisation. Ce problème touche particulièrement les collectivités qui changent souvent de dirigeants.
- Le fait qu'une collectivité ne possède pas la capacité opérationnelle requise pour diriger et poursuivre les grands projets qui sont mis en œuvre.
Les projets du volet B ont donné des résultats concrets pour les collectivités autochtones et nordiques
Sur les 54 projets du volet B qui ont été menés à bien, 61 % (soit 33 projets) étaient des projets liés à l'énergie solaire, qui ont abouti en raison de leur facilité de réalisation et de la disponibilité des technologies éprouvées. Parmi les autres, huit étaient liés à la géothermie, huit portaient sur la biomasse, trois reposaient sur l'utilisation de plusieurs technologies, et deux étaient des projets d'éoliennes. La majorité des projets relevant du volet B ont été réalisés en ColombieBritannique (26 % des projets) et en Ontario (23 % des projets).
Contrairement aux projets du volet A, qui n'ont généralement pas donné lieu à la réalisation de projets de technologie énergétique opérationnels, les projets du volet B, dans la plupart des cas, ont été achevés et ont donné lieu à des améliorations concrètes dans les collectivités. Toutefois, les projets relevant du volet B n'ont pas nécessairement capté l'attention générale de la collectivité ou contribué de manière significative à la réduction des émissions de GES.
Comparaison entre le volet A et le volet B
Les spécialistes du domaine ont maintenu que, pour ce qui est de réduire la dépendance au diesel, de réduire les émissions de GES et d'encourager l'utilisation générale de technologies des énergies renouvelables, les grands projets stratégiques (volet A) iront beaucoup plus loin que les petits projets ponctuels mis en œuvre aux quatre coins du pays (volet B). Cette affirmation a été confirmée par la comparaison entre les quelques projets opérationnels du volet A financés dans le cadre du précédent et de l'actuel programme écoÉNERGIE, et les projets opérationnels du volet B. Les collectivités de la Première Nation des Tlingits de la rivière Taku, de la Première Nation des Tla-o-qui-aht, et de la Première Nation T'Souke ont pu utiliser leurs études de faisabilité financées sous le volet A du programme écoÉNERGIE pour élaborer des analyses de rentabilisation solides en vue de la réalisation de projets de grande envergure – projets qui ont donné lieu à d'importantes réductions des émissions de GES. Ces mêmes projets ont également permis aux collectivités d'obtenir des avantages économiques significatifs, de participer aux discussions sur l'énergie renouvelable, de collaborer avec les collectivités environnantes et d'améliorer les relations avec ces dernières, de fournir de la formation et de proposer des emplois à long terme, et de susciter chez leurs membres un sentiment de fierté incommensurable.
Constatation nº 7 : Le programme écoÉNERGIE donne les résultats attendus en matière de réduction des émissions de GES dans les collectivités autochtones et nordiques.
La réduction des émissions de GES est le résultat final attendu du programme écoÉNERGIE. Il s'agit également du principal objectif de l'ensemble des programmes sur l'énergie propre mis en œuvre dans le cadre du Programme de la qualité de l'air dirigé par RNCan. Afin de permettre l'évaluation de la contribution des projets des volets A et B à la réduction des émissions de GES, les propositions de projets devaient comprendre un calcul réalisé au moyen du logiciel RETScreen (pour Renewable Energy Technology Screen) de RNCan. Une analyse a ensuite été réalisée par un tiers afin de vérifier l'évaluation des réductions potentielles. En fonction des analyses réalisées par des tiers pour chacun des projets approuvés dans le cadre du programme écoÉNERGIE, les projets financés doivent compenser les émissions de GES comme suit :
| Réduction annuelle des émissions de GES attendue dans le cadre des projets financés (en tonnes) |
Réduction des émissions de GES attendue dans le cadre du cycle de vie des projets financés (en tonnes) |
|
|---|---|---|
| Projets du volet A | 184 108 | 3 671 380 |
| Projets du volet B | 3 039 | 60 803 |
| Total | 187 147 | 3 732 183 |
Selon ces calculs, les projets du volet A menés à bien entraîneront environ 60 fois plus de réductions d'émissions de GES que les projets du volet B menés à bonne fin. Cependant, le volet A ne finance généralement que les études de faisabilité portant sur des projets de systèmes d'énergie renouvelable de grande envergure, projets dont la réalisation nécessite un budget bien supérieur au financement disponible dans le cadre du programme écoÉNERGIENote de bas de page 86. Il est donc difficile de comparer correctement les projets des volets A et B, car seuls quelques projets financés dans le cadre du volet A seront élaborés et menés à bien. Par conséquent, les chiffres concernant les réductions des émissions de GES découlant des projets du volet A sont des prévisions, qui se réalisent rarement, tandis que les réductions des émissions de GES prévues dans le cadre des projets du volet B correspondent aux réductions réelles.
Le nombre de projets financés et le montant du financement en dollars sont à peu près équivalents pour les deux volets, mais le volet A semble offrir des possibilités de rendement nettement plus élevé que le volet B en matière de réduction des émissions de GES par dollar de financement accordé dans le cadre du programme écoÉNERGIE. Afin de calculer les réductions réelles probables découlant des projets financés sous le volet A, compte tenu des difficultés susmentionnées associées aux projets de grande envergure, chacune des études financées a été examinée dans le but de déterminer l'étape en cours de la réalisation du projet. Les évaluateurs ont ensuite calculé la réduction des émissions de GES attendue dans le cadre des projets visés par les études financées qui étaient opérationnels ou en cours de réalisation en novembre 2014. Dans le tableau ci-dessous, ces chiffres sont comparés à la réduction des émissions de GES attendue au fil du cycle de vie des projets, à chaque étape de leur réalisation.
| État du projet en novembre 2014 | Réduction annuelle des émissions de GES attendue dans le cadre des projets du volet A (en tonnes) | Réduction des émissions de GES attendue dans le cadre du cycle de vie des projets du volet A (en tonnes) |
|---|---|---|
| Réalisation imminente | 3 880,3 | 77 619,9 |
| Réalisation en cours | 30 068,4 | 601 357,7 |
| Opérationnel | 1 301 | 26 032 |
| Total | 35 249,7 | 705 009,6 |
Afin de mettre en contexte ce que ces réductions représentent pour la population canadienne, les évaluateurs ont utilisé le calculateur des équivalences de gaz à effet de serre (Greenhouse Gas Equivalencies Calculator) de l'Environmental Protection Agency des États-Unis afin de dresser des scénarios comparables. Si les prévisions concernant les réductions des émissions de GES sont justes, les projets financés dans le cadre du volet B de 2011-2012 à 2013-2014 entraîneront chaque année une réduction comparable à celle qui résulterait du retrait de 640 véhicules de tourisme des routes, pendant 20 ans (c.-à-d. pendant la durée estimée du cycle de vie des systèmes)Note de bas de page 87. Lorsque les évaluateurs ont comparé le coût des projets du volet B à la réduction des émissions de GES qui en a découlé, ils ont obtenu comme résultat une valeur totale des dépenses engagées qui s'élève à environ 329,50 $ par véhicule retiré des routes chaque annéeNote de bas de page 88.
Parmi les projets du volet A qui sont à présent opérationnels, deux sont de grands projets d'énergie renouvelable qui, à eux seuls, entraîneront une réduction des émissions de GES équivalant à plus d'un tiers de la réduction attribuable à l'ensemble de projets du volet B réunis. Dans la majorité des cas, la réduction découlant des projets du volet A ne peut être calculée, car la plupart des projets financés ne sont pas encore à l'étape de la réalisation. Cependant, un certain nombre de projets probables devraient se traduire par d'importantes réductions des émissions de GES. Par exemple, le projet de système diesel-éolien de la Première Nation de Kluane, qui en est encore à l'étape de l'étude de faisabilité/de l'élaboration, devrait permettre une réduction annuelle de 504 tonnes d'émissions de GES, ce qui équivaut à retirer 106 véhicules de tourisme des routes chaque année pendant 20 ans (c.-à-d. pendant la durée estimée du cycle de vie du projet éolien) – soit un total de 2 120 véhiculesNote de bas de page 89.
Le financement par AADNC des études de faisabilité portant sur de grands projets d'énergie renouvelable entraînera, de façon exponentielle, des réductions plus importantes des émissions de GES si ces projets se concrétisent, mais les entrepreneurs et les spécialistes de la réalisation ont fait remarquer que la réduction prévue des émissions de GES ne devrait pas être le principal critère de financement. De nombreux autres facteurs – tels que les coûts de réalisation initiaux, l'expertise et le financement requis à l'égard du fonctionnement et de l'entretien, les facteurs environnementaux (p. ex. les voies migratoires des oiseaux), et la comparaison entre le coût par kilowattheure de la production d'énergie et le coût de l'utilisation de systèmes diesel efficients – sont importants et doivent être pris en considération en tout premier lieu afin de s'assurer de la viabilité réelle des projets sur le plan économique. En outre, certains intervenants interrogés ont indiqué que les conséquences de la réduction des émissions de GES, notamment l'amélioration de la fiabilité de l'énergie, la réduction des coûts et les possibilités de développement économique, étaient en réalité les résultats les plus importants des projets financés.
Constatation no 8 : Le programme écoÉNERGIE atteint le résultat prévu, c'est-à-dire que les collectivités mettent en place une infrastructure communautaire qui respecte les exigences de santé et de sécurité et qui favorise la participation à l'économie.
Il a été établi que le programme, outre sa contribution à l'objectif principal de réduction des émissions de GES, a également les retombées suivantes sur les collectivités bénéficiaires :
Impacts sur l'économie
La fiabilité de l'énergie et la réduction des coûts énergétiques favorisent le développement économique dans les collectivités autochtones et nordiques.
Le fait que de nombreuses collectivités éloignées et nordiques ne disposent pas d'un approvisionnement énergétique stable et fiable fait obstacle à leur développement économique et à la création d'emplois. Bon nombre de collectivités hors réseau connaissent des baisses de tension ou des pannes d'électricité dont la durée peut varier de plusieurs heures à quelques semainesNote de bas de page 90. Ces pannes ont des conséquences graves sur le fonctionnement de la collectivité, notamment sur le fonctionnement des écoles et des bureaux des conseils de bande, car elles paralysent souvent la collectivité qui se concentre alors uniquement sur les activités de baseNote de bas de page 91. La fiabilité de l'approvisionnement en électricité est l'un des facteurs de développement économique les plus importants et, par conséquent, le risque de panne d'électricité dissuade les gens d'investir et de développer les entreprises et l'industrieNote de bas de page 92.
Le coût élevé de l'électricité dans de nombreuses collectivités hors réseau a également un important effet dissuasif sur les investisseurs en puissance et les industries. Dans le rapport conjoint intitulé État de la situation des collectivités éloignées/hors réseau au Canada, préparé par AADNC et RNCan en août 2011, il est par exemple indiqué que « le coût de production d'électricité hors réseau, à partir de groupes électrogènes au diesel, peut être dix fois plus élevé que le coût de production d'un grand réseau », et que « le coût élevé de l'électricité dans les collectivités hors réseau est un obstacle majeur au développement économique, car il rebute toute industrie qui consomme ne serait-ce qu'une quantité modérée d'électricité »Note de bas de page 93. Dans les circonstances, il coûte plus cher aux entreprises d'explorer certaines possibilités, par exemple de réaliser des essais sur des sites afin de déterminer s'ils se prêtent à l'exploitation minière ou à l'exploitation d'une activité industrielle, et notamment à la construction et à l'entretien de baraquementsNote de bas de page 94. Le développement d'une énergie fiable, au moyen du raccordement à un réseau ou du développement de sources d'énergie renouvelable fiables, offre une stabilité accrue aux entreprises.
Les projets d'énergie renouvelable peuvent constituer une importante source de revenus pour une collectivité.
Comme cela a été mentionné plus haut, le programme écoÉNERGIE finance, dans le cadre du volet A, l'élaboration d'études de faisabilité portant sur de grands projets d'énergie renouvelable. Ce financement est indispensable pour que les collectivités puissent participer à l'évaluation de projets de production d'énergie ne générant que peu ou pas d'émissions de GES, et puissent percevoir les recettes potentielles découlant des accords d'achat d'énergie conclus avec les services publics locauxNote de bas de page 95. Nombreuses sont les collectivités qui ont utilisé le soutien initial fourni par le programme écoÉNERGIE pour élaborer de grands projets d'énergie renouvelable, projets qui appartiennent, dans leur totalité ou en partie, aux collectivités elles-mêmesNote de bas de page 96. Ces collectivités ont également conclu des accords d'achat d'énergie afin de vendre l'énergie produite au réseau local et de s'assurer ainsi une nouvelle source de revenus à long termeNote de bas de page 97.
Ces projets représentent une source de revenus importants, stables et à long terme pour les collectivités. La Première Nation d'Alderville a par exemple construit une centrale solaire de 5,7 mégawatts (MW), qui a commencé à produire de l'énergie en octobre 2013Note de bas de page 98. Dans le cadre d'un contrat d'une durée de 20 ans conclu avec l'Office de l'électricité de l'Ontario et prévoyant un tarif de rachat garanti, le projet constituera pour la Première Nation une source de revenus durables à long termeNote de bas de page 99. En outre, la centrale solaire de la Première Nation d'Alderville est en Ontario le premier projet de production d'énergie nouvelle appartenant entièrement à une Première NationNote de bas de page 100. En Colombie-Britannique, la Première Nation des Tlaoquiaht a établi avec la société Barkley Project Group un partenariat devant aboutir à la construction de deux microcentrales hydroélectriques qui sont à présent en activité. Les projets entrepris par la Première Nation ont été financés par le programme écoÉNERGIE avant son renouvellement en 2011, mais ils constituent un exemple remarquable des retombées que les projets du volet A ont sur les collectivités. En fait, la Première Nation des Tla-o-qui-aht travaille maintenant à l'établissement d'une troisième microcentrale. Elle est également le propriétaire majoritaire de ces installations.
Les grands projets axés sur les technologies des énergies renouvelables, comme la construction de microcentrales hydroélectriques, constituent pour les Premières Nations et les collectivités nordiques une source de revenus stables qui peut leur permettre d'exploiter d'autres possibilités de développement économique. Les collectivités sont souvent dépendantes des subventions gouvernementales, qui peuvent fluctuer d'une année à l'autre, créant ainsi un climat d'incertitude. Les revenus à long terme découlant des accords d'achat d'énergie représentent pour les collectivités une autre source de financement, fiable, qui peut permettre de soutenir le développement économique ou d'autres projets communautaires sans restreindre la capacité de la collectivité à répondre à d'autres besoins. Les collectivités où des visites ont été effectuées dans le cadre des études de cas de l'évaluation ont indiqué qu'elles considéraient ces accords d'achat d'énergie comme une étape importante vers l'indépendance économique.
Les projets d'énergie renouvelable peuvent permettre de réduire considérablement les coûts énergétiques assumés par les collectivités.
Au Canada, les collectivités autochtones, qu'elles soient rattachées ou non au réseau, doivent débourser des sommes importantes pour chauffer et éclairer les immeubles appartenant à des bandes. Par exemple, le Nunavut dépend entièrement des combustibles importés pour fournir de l'énergie à ses collectivités et, par conséquent, il importe des quantités très importantes de combustible, à un coût considérableNote de bas de page 101. De plus, certaines collectivités sur le réseau ont elles aussi de la difficulté à acquitter leurs factures énergétiques salées, surtout pour les grands immeubles appartenant à des bandes, comme les écoles et les bureaux des conseils de bande.
« Ici la plupart des immeubles fonctionnent à l’électricité, dont le coût est d’environ 2 500 $ à 3 000 $ par mois pour un petit bureau de conseil de bande. » – Personne interrogée dans le cadre d’une étude de cas dans la région de l’Atlantique
Le programme écoÉNERGIE a financé des projets d'énergie renouvelable qui permettront de réduire la quantité de carburant diesel utilisée pour la production d'électricité, de réduire la consommation d'huile de chauffage, de réduire les coûts de fonctionnement et d'améliorer l'efficacité énergétique dans de nombreuses collectivités différentes. Par exemple, au sein de la Première Nation d'Abegweit, le bureau du conseil de bande est doté de panneaux solaires qui ont permis de réduire les factures énergétiques de 35 % dès le premier mois de fonctionnement (avril), de 23 % au cours du deuxième mois (mai) et de 35 % au cours du troisième (juin). Cette diminution des coûts énergétiques a permis aux administrateurs de contribuer dans une plus large mesure au paiement des lourdes factures de chauffage domestique. L'expérience de la Première Nation d'Abegweit montre que les projets entrepris dans le cadre du volet B ont des retombées modestes, mais positives sur une collectivité.
En outre, une collectivité visitée dans le cadre de l'évaluation avait de la difficulté à payer les factures de chauffage de l'école, dont le montant annuel était supérieur à 30 000 $. Cette collectivité a donc entrepris un projet de chauffage géothermique, financé par le programme écoÉNERGIE, ce qui s'est traduit par une baisse de 40 % du coût énergétique (soit environ 12 000 $). Une autre collectivité ayant fait l'objet d'une visite durant l'évaluation a mis en place une chaudière alimentée à la biomasse qui, au cours de ses six premiers mois d'utilisation (de janvier 2014 à l'été), a permis de réduire de près de 50 % les coûts du chauffage des immeubles raccordés à la chaudière.

Au Yukon, la Première Nation de Kluane se lance dans un projet de système diesel-éolien, qu'elle prévoit mettre en service en 2015. Ce système produira 650 mégawattheures (MWh) par année et remplacera environ 27 % du carburant diesel consommé par deux collectivités, ce qui devrait se traduire par des économies annuelles en coûts de carburant estimées à plus de 200 000 $Footnote 102 Note de bas de page 103. Enfin, un projet solaire de la Première Nation de Deer Lake, en partie financé par le programme écoÉNERGIE, a apparemment permis au Conseil tribal Keewaytinook Okimakanak d'économiser 10 000 $ par mois.

Figure 6 : Photo du projet solaire de la Première Nation de Deer Lake (source : CBC News)Note de bas de page 104
Les économies de coûts réalisées ont motivé certaines collectivités à se lancer dans d'autres projets d'énergie renouvelable. Par exemple, une collectivité qui a fait l'objet d'une visite dans le cadre de l'évaluation a reçu des fonds qui lui ont permis d'installer des panneaux solaires pour le bureau de son conseil de bande. Au vu des économies de coûts qui en ont résulté, cette collectivité a installé d'autres panneaux solaires sur d'autres bâtiments communautaires (sans aide financière du programme écoÉNERGIE) afin de réduire ses coûts énergétiques.
Un certain nombre de collectivités ont tiré parti de leur projet d'énergie renouvelable financé par écoÉNERGIE pour développer leurs capacités et créer des emplois
Dans certains cas, les projets d'énergie renouvelable peuvent générer des emplois temporaires à la phase de construction et un nombre limité de postes permanents à l'étape d'exploitation du système d'énergie renouvelable. Les données provenant d'études de cas, les exemples empiriques offerts par les personnes interrogées et les reportages sur les projets menés à bien montrent que de multiples projets d'énergie renouvelable financés par écoÉNERGIE ont produit des emplois à court et à long terme pour les membres de la collectivité. Par exemple, la centrale solaire de la Première Nation d'Alderville (voir plus haut) a créé des postes temporaires pour plus de 20 membres de la collectivité durant la phase de construction et devrait fournir de l'emploi à long terme pour la collectivité tout au long de son exploitationNote de bas de page 105. De même, la Première Nation de Nak'azdli, qui a mis en œuvre un système de valorisation énergétique de la biomasse grâce au financement d'écoÉNERGIE, a formé et embauché (à temps partiel) cinq membres de la collectivité pour assurer l'entretien et l'exploitation de ce système. Il ressort des entrevues que l'ajout prochain d'installations de valorisation de la biomasse devrait permettre au projet de convertir les postes actuels de temps partiel à temps plein. Même si le nombre d'emplois est limité, ceux-ci sont situés dans la collectivité même et demandent une formation et un développement des compétences, ce qui entraîne une augmentation de la capacité de la collectivité à assurer, en autonomie, l'entretien et l'exploitation des installations.
Dans de multiples collectivités, la construction des projets d'énergie renouvelable a également ouvert de nouvelles possibilités de mentorat et de développement des compétences et a permis l'obtention de qualifications pour certaines personnes. Par exemple, la Première Nation des Tlingit de Taku River, même si le financement provient de l'ancien programme écoÉNERGIE, offre un bon exemple de la façon par laquelle la construction d'un projet d'énergie renouvelable peut servir à augmenter les possibilités d'emploi dans la collectivité. Lors de la construction de la microcentrale hydroélectrique, des membres de la collectivité ont reçu divers types de formation dont l'hydrologie et l'écoulement fluvial, l'analyse des sols, le contrôle du béton, l'inspection des soudures, la gestion générale de projet, l'inspection sur place, la gestion de contrats, la construction ainsi qu'une formation en divers métiers. De plus, les chefs de projet ont offert aux jeunes de la collectivité la possibilité d'accompagner les entrepreneurs sur le chantier pour les observer au travail, ce qui, selon les personnes interrogées, a permis aux jeunes d'acquérir une expérience de travail précieuse et les a encouragés à considérer différents parcours de carrière.
Dans un autre projet où le financement provenait de l'ancien programme d'écoÉNERGIE, la Première Nation T'Souke a veillé à ce que ses membres reçoivent une formation d'installation et d'entretien de panneaux solaires de la phase d'installation du projet. Cette formation a permis de créer des emplois pour ces membres qui aujourd'hui font l'installation et l'entretien de panneaux solaires dans les collectivités avoisinantes. Pour sa part, la Première Nation d'Eel Ground, au Nouveau-Brunswick, qui construisait une nouvelle école en intégrant un système de chauffage géothermique financé par écoÉNERGIE, a veillé à ce que l'entrepreneur mette en œuvre un programme de mentorat à l'intention des membres de la collectivité qui travaillaient au projet. Plusieurs membres de la Première Nation d'Eel Ground ont ainsi pu recevoir une formation, une certification ou une expérience précieuse permettant d'améliorer leurs perspectives d'emploi.
La possibilité d'utiliser les projets d'infrastructure, y compris la construction de systèmes d'énergie renouvelable, pour développer les capacités et créer de l'emploi représente une des pratiques exemplaires relevées dans l'évaluation du Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations effectuée en avril 2014. Comme dans les exemples cités précédemment, cette évaluation souligne que certains des projets du Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations ont investi dans l'enrichissement des connaissances et des compétences des membres des collectivités des Premières NationsNote de bas de page 106. Dans le cas des projets menés à bien, tant ceux du FIPN que ceux d'écoÉNERGIE, il faut souligner que l'élan qui a permis de tirer partir de la construction ou de l'exploitation d'un système d'énergie renouvelable pour développer les capacités et créer des emplois dans la collectivité a été donné par les collectivités elles-mêmes. Le compte rendu de l'évaluation du Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations indique que les « projets témoignent de la possibilité pour AADNC d'appuyer les futurs investissements dans les infrastructures qui incorporent les volets de formation élaborés dans des contrats de projet »Note de bas de page 107. Le programme écoÉNERGIE pourrait, de façon analogue, encourager les collectivités à veiller à ce que leur projet d'énergie renouvelable favorise la création d'emplois et le développement des compétences dans la collectivité.
Impacts sociaux
Les projets menés à bien représentent une source de fierté et d'inspiration pour entreprendre de nouvelles possibilités de développement économique.
Lors des visites effectuées dans le cadre de l'évaluation, les membres des collectivités ont fait remarquer que les projets d'énergie renouvelable du volet A représentaient un défi de taille qui, une fois relevé, devenait une grande source de fierté pour les collectivités. Selon l'un des chefs de projet, ces systèmes d'énergie renouvelable à grande échelle changeraient la donne parce qu'ils fournissent aux collectivités la preuve qu'elles sont capables d'entreprendre des projets d'une telle envergure. Par conséquent, de nombreuses collectivités ayant mené à bien des projets d'énergie renouvelable du volet A profitent à présent des compétences acquises pour entreprendre de nouveaux projets de développement, dont certains se trouvent à l'extérieur de leur collectivité. De plus, la réalisation d'un projet écoÉNERGIE suscite un sentiment de fierté et de capacité accru chez les membres de la collectivité qui ont reçu une formation et un emploi lors de la construction ou de l'exploitation du système d'énergie renouvelable. Dans l'une de ces collectivités, le chef de projet a affirmé qu'un membre de la collectivité devenu opérateur des installations s'était davantage engagé dans sa collectivité, étant plus fier et participant plus souvent, et en étant mieux disposé à offrir le meilleur de lui-même et à former les jeunes de sa collectivité.
Un projet de grande envergure tend à mobiliser davantage les membres de la collectivité et à mieux attirer l'attention des municipalités avoisinantes, du gouvernement provincial, du secteur privé et des autres collectivités autochtones et nordiques. Il peut même, dans certains cas, inspirer les collectivités autochtones ou nordiques avoisinantes à examiner les systèmes d'énergie renouvelable qui seraient réalisables chez elles.
Les projets d'énergie renouvelable provoquent des discussions et des initiatives en matière d'éducation portant sur l'utilisation de l'énergie et les changements climatiques.
Les projets d'énergie renouvelable entrepris par les collectivités autochtones et nordiques bénéficiaires du programme écoÉNERGIE ont fait augmenter l'importance et la visibilité des questions de consommation d'énergie et de changements climatiques chez un bon nombre de collectivités. Dans plusieurs cas, le projet d'une collectivité a servi de tremplin aux discussions concernant l'utilisation de l'énergie et l'élaboration de programmes éducatifs à l'intention des jeunes. Par exemple, la Première Nation de Nak'azdli a construit une tour pour mesurer la vitesse du vent dans ce secteur afin de déterminer la viabilité d'un projet éolien. Le chef de projet a obtenu la participation des élèves de la collectivité pour compiler les vitesses obtenues par cette tour dans le cadre d'un projet de classe. La Première Nation de Lennox Island et la Première Nation T'Souke se sont servies de leur projet de panneaux solaires pour susciter des discussions sur la durabilité dans leur collectivité et éduquer leurs élèves en matière d'énergie solaire et de changements climatiques.
Répercussions sur la santé et la sécurité
Un projet d'énergie renouvelable dans une collectivité qui dépend du diesel réduit le risque de contamination et des responsabilités qui y sont liées
L'utilisation d'une génératrice à moteur diesel s'accompagne de risques de contamination importants en cas de déversement ou de fuite. Les collectivités autochtones et nordiques hors réseau se font livrer de grandes quantités de diesel qui sont entreposées dans des réservoirs collectifs avant leur utilisation. Le transport et l'entreposage de diesel peuvent provoquer une contamination à la suite d'un accident de la route ou d'une fuite associée à un entreposage inadéquat. En fait, les risques liés à l'entreposage du diesel ont augmenté à tel point que le Commissaire à l'environnement et au développement durable du Canada a indiqué que le nettoyage consécutif à un déversement accidentel représentait une responsabilité importante et peu reconnue du gouvernement fédéralNote de bas de page 108. Lors d'un déversement de diesel, toute la collectivité peut en subir les répercussions au fur et à mesure que la contamination s'étend. L'infiltration de la nappe phréatique peut entraîner des risques pour la santé par l'ingestion de toxinesNote de bas de page 109. Qui plus est, la contamination par les hydrocarbures peut tuer les espèces sauvages et endommager l'écosystème local, ce qui peut se traduire par des difficultés économiques pour les collectivités qui dépendent de la terre pour leur nourriture et des revenusNote de bas de page 110. Alors que les réservoirs sont la propriété des collectivités autochtones et nordiques qui les exploitent, c'est AADNC qui porte la responsabilité des sites contaminés par le diesel. En raison du grand nombre de déversements de diesel, le Ministère a pris des mesures en vue de remplacer les réservoirs de diesel pour réduire le nombre de déversements.
La transition vers les sources d'énergie renouvelable va permettre de réduire les risques d'atteinte à l'environnement et à la santé chez les collectivités éloignées et nordiques hors réseau. Par exemple, une collectivité qui a mis en œuvre un système d'énergie renouvelable pour remplacer sa source principale d'électricité, soit leur génératrice diesel, a remarqué les bienfaits, pour la collectivité, de ne plus avoir à transporter, à entreposer et à brûler du diesel. En outre, Ressources naturelles Canada remarque que les risques en matière d'environnement liés au transport et à l'entreposage de diesel, comme les déversements dans les eaux arctiques et intérieures, les accidents sur les routes de glace ou la pollution provenant des génératrices de diesel diminueront chez les collectivités qui ont la capacité de réduire ou de supplanter d'importantes quantités de diesel grâce aux mesures prises en matière d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétiqueNote de bas de page 111.
Constatation 9 : La conception fondée sur des propositions encourage un modèle de financement mené par les fournisseurs et non les collectivités ayant les besoins les plus grands.
Le programme écoÉNERGIE reçoit les propositions provenant des collectivités chaque année, entre février et mars. La demande de propositions est affichée sur le site Web d'AADNC. Des lettres sont également envoyées à cet égard aux bureaux des conseils de bandes. Pour demander le financement d'un projet, les promoteurs doivent joindre à leur demande le budget du projet, une lettre d'appui (pouvant être une résolution du conseil de bande en appui au projet lorsqu'il y a eu quorum) et une analyse RETScreen, laquelle fournit une évaluation du système d'énergie renouvelable proposé accompagnée d'une analyse des coûts et d'une analyse des émissions.
« Nous avons rempli les demandes pour la Première Nation… Les Nations ont d’autres préoccupations. Elles veulent faire avancer ce dossier, mais elles n’en ont tout simplement pas la capacité. Personne ne veut payer un consultant pour remplir une demande. Mais la collectivité a besoin de cette capacité, car la qualité des demandes risque d’en souffrir. » – Un entrepreneur
Conformément au modèle de financement actuel, les collectivités présentent une demande de projet et reçoivent, si celui-ci est accepté, les fonds leur permettant de le mettre à exécution sans devoir passer par un processus d'appel d'offres. Lors des visites, les évaluateurs ont pu observer que les propositions soumises dans le cadre du programme écoÉNERGIE avaient souvent été préparées par les fournisseurs eux-mêmes et non par les collectivités bénéficiaires. Dans bon nombre de cas, c'est un fournisseur connaissant bien le programme écoÉNERGIE d'AADNC qui a contacté un conseil de bande ou une collectivité du Nord pour lui parler d'un projet d'énergie renouvelable particulier qui, à son avis, pourrait lui convenir. Ayant obtenu l'appui de la collectivité, le fournisseur procédait ensuite à la demande de financement du programme écoÉNERGIE au nom du conseil de bande. Bien que les évaluateurs aient d'abord été préoccupés par la possibilité que cette réalité incite les fournisseurs à abuser des collectivités et du financement fédéral offert, la visite des sites a permis de démontrer le contraire. Même lorsqu'un projet avait été conçu et proposé par un fournisseur spécialisé dans un secteur technologique précis en matière d'énergie renouvelable, les évaluateurs ont noté que l'entrepreneur s'était grandement investi dans le projet. Les petites entreprises, surtout, avaient à cœur de faire vivre une expérience positive à la collectivité bénéficiaire de manière à pouvoir faire la promotion de leur entreprise auprès d'autres collectivités autochtones. Les évaluateurs ont relevé des cas où des membres de la collectivité recevaient une formation ou un mentorat, tandis que dans d'autres, un entrepreneur organisait une réunion communautaire pour obtenir la participation de tous les intervenants d'un projet. Dans un vaste projet en particulier, l'entrepreneur lui-même est devenu actionnaire du projet.
Dans une région notamment, les évaluateurs ont constaté que le même entrepreneur s'efforçait d'implanter le même type de projet d'énergie renouvelable dans toutes les collectivités des Premières Nations grâce au financement d'écoÉNERGIE. Face à cet état de fait, les gestionnaires du programme ont soigneusement filtré les propositions de projet semblables et mis en œuvre une nouvelle politique en vertu de laquelle les entrepreneurs doivent informer leur collectivité cliente qu'ils travaillent déjà avec plusieurs autres collectivités. Les évaluateurs ont interrogé différents entrepreneurs fournissant des services aux collectivités des Premières Nations et ont pu constater l'authenticité de leur passion pour ers les technologies en énergie renouvelable et la sincérité de leur implication dans les collectivités. Il reste que le modèle du projet fondé sur des propositions pourrait donner lieu à des abus de la part des entrepreneurs. Dans l'une des collectivités visitées, les évaluateurs ont remarqué que l'entrepreneur privilégiait un type particulier de technologie en matière d'énergie renouvelable sans aborder les autres solutions possibles. Dans ces conditions, ce n'est pas toujours la technologie qui convient le mieux qui sera fournie à la collectivité, surtout lorsque l'entrepreneur qui soumet la proposition au nom de la collectivité s'est spécialisé dans un autre type d'énergie renouvelable.
Confrontés à l'aspect technique du programme écoÉNERGIE, les membres des conseils de bandes interrogés ont admis leurs sentiments d'isolement et de vulnérabilité lorsque vient le moment de sélectionner le bon entrepreneur et le bon projet pour leur collectivité, car ils n'ont pas l'expertise technique voulue. Ajoutons à cela qu'en raison de la centralisation du programme écoÉNERGIE, le personnel régional d'AADNC ne fournit pas de conseils à cet égard. C'est pourquoi de nombreuses collectivités font appel à une entreprise de gestion de projets comme tierce partie pour rédiger les propositions de projet. Il est permis de penser que cette réalité décourage les collectivités à faible capacité de présenter des demandes. En entrevue, l'agent de développement économique d'une Première Nation a expliqué en long et en large toutes les recherches qu'il devait effectuer pour comprendre les technologies offertes en matière d'énergie renouvelable, les entreprises dans son secteur, les coûts de construction du projet et le rendement du capital investi, et ce, afin de sélectionner le bon projet pour sa collectivité. Pour lui, toutes ces recherches et ces connaissances nécessaires à la soumission d'une proposition représentaient une montagne. D'autres répondants ont aussi fait remarquer que les collectivités dont les besoins sont les plus pressants (généralement les collectivités éloignées et hors réseau) n'ont souvent pas la capacité nécessaire pour réaliser une analyse RETScreen et qu'elles n'ont pas accès à une entreprise de gestion de projet ou à des entreprises de construction dans le domaine de l'énergie renouvelable pour leur permettre d'entreprendre un projet. Ces commentaires laissent à penser que les collectivités éloignées et de petite taille qui n'ont accès ni à des entrepreneurs ni à de l'équipement auront de la difficulté à présenter une demande au programme écoÉNERGIE et qu'elles sont, de ce fait, désavantagées.
En outre, le modèle du projet fondé sur des propositions qui caractérise le programme écoÉNERGIE limite sa capacité de financer les différentes composantes ou phases d'un projet de grande envergure, car chacune doit faire l'objet d'une soumission séparée, et ce, sans garantie préalable de financement. La prise en compte d'un seul projet à la fois selon des critères de financement restrictifs écarte d'autres modes d'allocation plus efficaces, comme le financement d'un projet qui comporte plusieurs phases. Par exemple, dans une collectivité, une seule partie de l'école a pu bénéficier du projet de chauffage par géothermie, car la proposition devait se plier au plafond de financement prévu par le programme. Même si le projet permettra à l'école de réaliser des économies importantes, un investissement plus important aurait permis un meilleur rendement du capital investi par l'installation du chauffage par géothermie dans toute l'école. Le programme écoÉNERGIE n'encourage donc pas les collectivités à trouver d'autres sources de financement en vue d'augmenter les fonds alloués aux projets d'énergie renouvelable. Cela dit, la collectivité n'avait ni la capacité ni la volonté de le faire. D'ailleurs, après s'être entretenus avec les entrepreneurs sur place, les évaluateurs ont appris que même si le projet de géothermie représente un excellent investissement, le rendement du capital investi, lui, aurait été plus élevé si d'autres options avaient été considérées, comme une chaudière plus efficace et l'installation de nouvelles fenêtres. Les entrepreneurs voulaient certainement fournir à la collectivité les meilleures options permettant d'abaisser le coût du chauffage de l'école, mais écoÉNERGIE était la seule source de financement disponible et une technologie d'énergie renouvelable était nécessaire. Dans ce cas particulier, les entrepreneurs ont choisi une solution plus coûteuse qui correspondait au financement offert et qui permettait d'en satisfaire les critères.
« Les collectivités n’ont généralement pas d’expérience en développement énergétique ou en énergies propres. Il leur faut une aide sur le plan de la gestion de projets pour acquérir cette capacité. » – Un entrepreneur
Dans une collectivité visitée, l'entreprise de gestion de projets qui travaille pour la collectivité depuis des années et qui s'est chargée de différents projets de construction a été en mesure de gérer un processus d'appel d'offres en vue de la construction d'une école qui comprenait un système de chauffage par géothermie financé par le programme écoÉNERGIE. Elle a opté pour la proposition classée au premier rang plutôt que pour la moins chère, ce qui a donné lieu à un important volet mentorat en plus de la formation et de la certification des membres de la collectivité qui ont été embauchés. Comme l'a fait ressortir une précédente évaluation du Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations d'AADNC, la capacité d'intégrer un processus d'appel d'offres fondé sur la qualité de l'entrepreneur et les avantages supplémentaires offerts à la collectivité constitue une pratique exemplaire pour obtenir des résultats optimaux. Cependant, ce genre de pratique ne saurait s'appliquer qu'aux projets de plus grande envergure pour éviter qu'elle ne devienne un mécanisme fastidieux et bureaucratique.
Compte tenu de ces conseils et pratiques exemplaires, les évaluateurs recommandent d'examiner le modèle du projet fondé sur des propositions et de le modifier pour permettre une stratégie de financement ciblée qui offrira de l'aide aux collectivités voulant entreprendre un ensemble réfléchi de projets et aux entrepreneurs qui fourniront la formation et le mentorat aux membres de la collectivité. Inspirée par la pratique exemplaire mise en lumière lors de l'évaluation des répercussions de 2010, à savoir que la préparation de plans énergétiques communautaires doit précéder le lancement de grands projets d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique pour améliorer l'efficacité des projetsNote de bas de page 112, la présente évaluation encourage une coordination d'une envergure encore plus grande. Plus précisément, il peut s'avérer avantageux pour le programme écoÉNERGIE de se détourner du financement de projets ad hoc pour financer les collectivités qui décident d'entreprendre un ensemble de mesures en développement énergétique en commençant par s'assurer que l'infrastructure existante est aussi efficace que possible, suivie des études et évaluations connexes permettant de sélectionner un système d'énergie renouvelable, pour terminer par la mise en œuvre de la solution la plus viable en matière d'énergie renouvelable.
Recommandation no 3: Lors d'un éventuel remodelage du programme écoÉNERGIE, il est recommandé de tenir compte des éléments suivants :
- supprimer les volets de financement distincts et les crédits maximums affectés aux projets;
- réviser l'approche fondée sur les propositions;
- développer une approche pour cibler les collectivités aux besoins les plus pressants;
- appuyer les projets qui intègrent des systèmes d'énergie renouvelable dans des systèmes existants à base de diesel afin de réduire la consommation de diesel; et
- fournir l'appui nécessaire aux collectivités lors de l'évaluation et de la proposition de projets d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique adaptés aux besoins.
Constatation no 10 : Même si l'harmonisation d'écoÉNERGIE avec les programmes existants d'AADNC, de Ressources naturelles Canada et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord est déjà amorcée, il est nécessaire que les partenaires améliorent la coordination de leurs investissements et de leur soutien en matière d'énergie renouvelable fournis aux collectivités autochtones et nordiques hors réseau.
« Nous aimerions tenter autre chose à l’extérieur des réserves en faisant intervenir les municipalités avoisinantes. » – Personne interrogée dans le cadre d’une étude de cas dans la région de l’Atlantique
AADNC reconnaît depuis des années que ce qui est nécessaire à la réussite des projets d'énergie renouvelable au Canada, c'est l'attribution d'un rôle précis pour les divers intervenants : Ressources naturelles Canada, écoÉNERGIE, les collectivités autochtones et nordiques, le gouvernement fédéral, les gouvernements du Nord, les services publics du Nord et les collectivités elles-mêmesNote de bas de page 113. Il ressort des évaluations précédentes d'écoÉNERGIE et de programmes de financement semblables en matière d'énergie, comme le Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations d'AADNC, qu'il est nécessaire de mieux coordonner les programmes d'infrastructure au sein d'AADNC et de l'ensemble du gouvernement fédéral pour atteindre des objectifs communsNote de bas de page 114. Les employés du Ministère qui ont été interrogés reconnaissent que celui-ci a fait des efforts pour mieux harmoniser sa programmation, ce dont témoigne la création de groupes de travail permettant les échanges et les discussions sur les projets approuvés. Cependant, certains d'entre eux, de même que des experts en la matière, sont d'avis que l'échange d'information est insuffisant et qu'il est nécessaire d'adopter une approche pragmatique pour coordonner la diversité d'intervenants, de programmes et de sources de financement.
De plus, les évaluateurs soulignent la présence d'un grand nombre d'intervenants qui travaillent dans les collectivités éloignées du Canada pour effectuer des recherches et mettre au point des technologies novatrices d'énergie renouvelable. Le défi découle du fait que même si les activités et les efforts se chevauchent, le niveau des besoins reste élevé alors que celui du financement est faible en comparaison et que la coordination entre les divers intervenants se limite le plus souvent à un simple échange de renseignements. Pour illustrer cette constatation, les évaluateurs ont créé un tableau qui met en lumière les intervenants et les programmes concernés et qui relève les possibilités pratiques permettant de mieux harmoniser les activités qui stimulent le développement et l'utilisation de technologies d'énergie renouvelable au Canada. Ce tableau se trouve à l'Annexe A.
En plus des divers programmes gouvernementaux de recherche et de financement en matière d'énergie renouvelable, les établissements universitaires du Canada sont eux aussi fortement axés sur la recherche de nouvelles technologies et sur l'adaptation de technologies reconnues à l'environnement nordique du Canada. Les évaluateurs ont recensé un certain nombre d'établissements d'enseignement et de centres de recherche dignes de mention pour la façon dont leurs réseaux et leurs partenariats avec d'autres établissements d'enseignement, le secteur privé et les programmes gouvernementaux encouragent les projets de recherche innovants et créent un élan dans le domaine des technologies en matière de ressources renouvelables dans l'ensemble du Canada. Un tableau illustrant le travail de ces établissements se trouve à l'Annexe A.
Arrivé à sa troisième version, le programme écoÉNERGIE d'AADNC démontre non seulement sa longévité, mais aussi sa capacité d'attirer un personnel hautement qualifié qui s'investit dans la création de partenariats avec beaucoup des intervenants mentionnés plus haut. De la même façon, bien des programmes susmentionnés se sont servis des leçons apprises et des pratiques exemplaires résultant du programme écoÉNERGIE pour fixer leurs propres objectifs et élaborer leur propre contenu. Au fil du temps, le programme écoÉNERGIE s'est joint à d'autres intervenants pour élaborer une approche coordonnée en matière d'exécution de programmes ou les a appuyés dans cette démarche.
Malheureusement, en dépit de vaillants efforts, les programmes ont été coordonnés de façon ponctuelle et le processus a surtout été axé sur l'échange d'information. Les évaluateurs ont appris qu'AADNC avait longtemps essayé de réunir ses partenaires pour renforcer la stratégie ministérielle à l'égard des collectivités hors réseau; le calendrier qui suit présente le résumé de ces tentatives.
| Date | Activité |
|---|---|
| 2005 | Les sous-ministres d'AADNC et de Ressources naturelles Canada ont mis au point un plan de travail pour discuter des collectivités hors réseau et éloignées |
| Septembre 2009 | Cadre d'AINC pour les hors-réseau : Plan d'action au sein d'AINC qui aborde les énergies renouvelables dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau, préparé par écoÉNERGIE |
| 2009 – 2011 | Groupe de travail sur les collectivités hors réseau d'AADNC formé et dirigé par écoÉNERGIE Le personnel participant provenait des programmes liés à AADNC, des bureaux régionaux, de Recherche et développement pour la défense Canada, de Ressources naturelles Canada et de son Centre canadien de la technologie des minéraux et de l'énergie à Varennes, du Conseil national de recherches, du gouvernement du Nunavut, du gouvernement de la Colombie-Britannique et du gouvernement de l'Ontario |
| 22 juin 2011 | Participation des Autochtones dans le secteur de l'énergie propre – discussion informelle Rassemblement national des représentants du Ministère ayant pour but d'explorer les options pouvant améliorer la coordination en ce qui a trait aux possibilités des collectivités autochtones sur le plan de l'énergie propre |
| 29 juin 2011 | Développement de projets d'énergie durable dans les collectivités autochtones hors réseau : Analyse des coûts et des avantages à long terme, SGA Energy Limited et Green Eagle Services, financement par la Direction des initiatives stratégiques et de l'intégrité des programmes et la Direction de l'environnement et des ressources renouvelables |
| Août 2011 (dernière mise à jour : mars 2012) |
Stratégie des hors réseau d'AADNC : Traitement de l'énergie durable dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau élaborée par écoÉNERGIE |
| 10 mai 2012 | Stratégie énergétique hors réseau mise à jour : Une solution durable aux problèmes soulevés par le diesel dans les collectivités (phase I) |
| 28 mars 2014 | Collectivités des Premières Nations hors réseau – Stratégie de l'infrastructure énergétiquepréparée par la Direction générale des infrastructures communautaires |
« Le Ministère a besoin d’une raison pour faire preuve d’audace. » – Répondant
Comme le démontre le tableau ci-dessus, AADNC travaille depuis 2005, tant à l'interne qu'avec ses partenaires fédéraux, à définir une stratégie de financement qui cible les collectivités autochtones et nordiques hors réseau. Par contre, ces initiatives ont été pilotées par différents intervenants : le programme écoÉNERGIE, la Direction de l'environnement et des ressources renouvelables, la Direction des initiatives stratégiques et de l'intégrité des programmes et la Direction générale des infrastructures communautaires. Les derniers efforts déployés en vue d'établir une stratégie d'infrastructure énergétique pour les collectivités des Premières Nations hors réseau sont restés à l'état embryonnaire, et il manque l'impulsion nécessaire pour la terminer. Les personnes interrogées ont également affirmé que le secteur de l'énergie renouvelable, particulièrement dans les collectivités hors réseau, ne manque pas d'intervenants dont le financement est minime et qui ne sont pas en mesure de coordonner le financement, les capacités et les connaissances pour soutenir des projets conjoints plus efficaces. L'évaluation a permis de constater qu'AADNC a tout mis en œuvre afin de dresser un plan d'action pratique sur la manière de soutenir et de financer les projets énergétiques dans les 175 collectivités hors réseau qui relèvent de lui.
« La prochaine étape [d’AADNC] consiste à mieux soutenir les priorités des collectivités en mettant à profit le calendrier et le financement. » – Répondan
À la lumière de ces constatations, les évaluateurs recommandent que le programme écoÉNERGIE, en partenariat avec l'équipe des infrastructures hors réseau de la Direction générale des infrastructures communautaires, crée une rubrique d'évaluation selon laquelle les 175 collectivités hors réseau relevant d'AADNC seront classées. D'après les résultats de cet exercice de classement, un plan de travail pratique de cinq ans serait élaboré dans chaque collectivité à haute priorité ciblée; ce plan réunirait l'expertise et les investissements des exercices de planification précédents et intégrerait tous les intervenants actuels. Il s'agirait en fait d'établir une approche de recherche et de financement par étapes stratégiques qui intègre les sources de financement fédérales pertinentes, comme Ressources naturelles Canada et la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SCREA), pour permettre aux collectivités de passer sans heurts de la recherche au projet pilote pour aboutir à l'exploitation d'un système d'énergie renouvelable.
Les évaluateurs reconnaissent que cette recommandation n'est pas nouvelle et que la tâche à accomplir n'a rien de facile. Cependant, il faut une approche réalisable et pragmatique, mue par un élan durable, pour dynamiser ces collectivités. Les évaluateurs privilégient un plan d'action stratégique, le programme écoÉNERGIE d'AADNC s'appuyant sur des fonds limités et ne disposant que d'une petite équipe. Son vaste mandat ne peut que s'alourdir, car le programme devra se concentrer sur les projets des collectivités hors réseau qui, en raison de leur éloignement physique, nécessitent un surcroît de ressources, particulièrement celles qui sont situées dans le Nord. Les spécialistes de l'industrie confirment que la réalisation de projets à énergie renouvelable coûtera trois fois plus cher dans le Nord que dans le Sud, car il est rare de pouvoir y accéder aux experts et à l'équipement nécessaire. D'après les expériences passées, il est extrêmement difficile de mettre en œuvre des technologies à énergie renouvelable dans les collectivités des Premières Nations hors réseau. Il faut d'abord adapter ces technologies au climat nordique, puis développer un haut niveau d'expertise dans la collectivité pour faire en sorte que le nouveau système à énergie renouvelable puisse être entretenu et réparé en cas en de fonctionnement défectueux ou de défaillance. De plus, une approche différente sera nécessaire pour chaque projet et le personnel du programme devra jouer un rôle plus actifNote de bas de page 115. Puisque l'objectif du programme se tourne vers les collectivités hors réseau qui ont le plus souvent un climat nordique très rigoureux, il sera d'autant plus important de pouvoir compter sur des partenariats et une approche hautement coordonnée bénéficiant du soutien de la haute direction pour maintenir l'élan nécessaire à la réalisation d'un plan de travail durable.
Recommandation no 4 : Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE établisse un processus visant à élaborer une stratégie de mobilisation et de collaboration pour chaque collectivité hors réseau qu'il cible, en veillant à ce que les activités et les investissements par AADNC, les partenaires fédéraux (p. ex. Agence canadienne de développement économique du Nord, Ressources naturelles Canada, Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique [SCREA]) et les autres ordres de gouvernement, soient coordonnés pour permettre aux collectivités de passer sans heurts de la recherche au projet final, en passant par le projet pilote.
Considération no 1 pour le Comité des opérations : Le Ministère, en collaboration avec les partenaires fédéraux (p. ex. Agence canadienne de développement économique du Nord, Ressources naturelles Canada, SCREA) et les autres ordres de gouvernement, étudie l'élaboration d'un système central de suivi de cinq ans pour déterminer les activités et les investissements dans toutes les collectivités autochtones et nordiques hors réseau pour augmenter la collaboration stratégique.
Considération no 2 pour le Comité des opérations : Le Ministère étudie l'élaboration d'une politique ministérielle en matière d'énergie durable qui :
- appuie la conception, la construction et la mise en œuvre des systèmes d'énergie renouvelable qui fournissent de l'énergie aux collectivités en vertu du mandat d'AADNC; et
- favorise le financement des projets d'infrastructure à petite échelle qui augmentent l'efficacité énergétique afin de diminuer la demande énergétique (c.-à-d. remplacer les fenêtres, les systèmes de chaudières, les matériaux isolants, etc.).
Considération no 3 pour le Comité des opérations : Le Ministère étudie l'élaboration d'un système d'organisation et de suivi des études de faisabilité et des documents de planification communautaire financés (p. ex. vérifications de la consommation d'énergie, plans des infrastructures, plans de gestion des urgences, études sur l'adaptation aux changements climatiques, plans communautaires globaux, etc.) afin de mieux conserver les travaux financés et d'appuyer les prochaines décisions concernant le développement de l'infrastructure. La Direction générale des politiques stratégiques, de la planification et de la recherche d'AADNC peut être en mesure de créer une telle base de données centralisée et d'en faire l'un de ses outils ministériels de recherche.
Constatation no 11 : L'approche d'exécution centralisée des programmes de l'Administration centrale pourrait être améliorée en coordonnant l'élaboration et la mise en œuvre des projets ciblés avec le personnel régional de la Direction générale des infrastructures communautaires.
Selon la conception actuelle du programme écoÉNERGIE, le personnel responsable à l'administration centrale d'AADNC examine les demandes des collectivités, rend les décisions de financement et intègre les modifications aux contributions apportées par un réseau de personnes-ressources travaillant dans les bureaux régionaux du Ministère. Ces personnes-ressources proviennent de différentes directions générales, notamment de Terres et développement économique et de la Direction générale des infrastructures communautaires. La relation qui existe entre le personnel de l'administration centrale et les personnes-ressources des régions varie; certaines sont très investies dans les projets d'écoÉNERGIE alors que d'autres s'occupent strictement des transferts de fonds. Lorsqu'une relation étroite s'est établie, le personnel de l'administration centrale consulte souvent leurs personnes-ressources régionales à propos de projets potentiels pour connaître leur opinion sur ceux qui offrent le meilleur potentiel de succès.
En définitive, les disparités au niveau de la participation régionale ont pour effet que certaines connaissances précises sur la région ne sont pas prises en compte au moment d'approuver un projet, ce qui peut influencer la gestion des ententes de financement pour cette région. Le profil de risques du programme écoÉNERGIE de 2011 considère ces disparités comme un facteur de risque, les régions ne disposant d'aucun processus cohérent pour gérer leur financement accréditif et pour prendre les décisions relatives au déblocage de fonds. Il existe des retards évidents entre l'approbation des projets et la signature des ententes de financement officielles.Note de bas de page 116 Ce facteur de risque pourrait engendrer des retards dans l'établissement d'ententes de financement et dans les ajustements nécessaires, sans compter qu'il pourrait retarder les projets et créer des problèmes de flux de trésorerie aux bénéficiaires qui n'ont pas suffisamment de liquiditésNote de bas de page 117. Cette question a elle aussi été relevée par un consultant en gestion de projets participant à différents projets d'écoÉNERGIE pour qui le processus décousu entre Ottawa et les régions constituait un obstacle de taille à la réussite des projets d'énergie renouvelable, car ces projets sont sensibles au facteur temps.
Les évaluateurs ont constaté que c'étaient surtout les personnes-ressources de la DGIC qui participaient à l'exécution régionale des projets d'écoÉNERGIE. Les liens naturels qui existent entre la construction de projets d'énergie renouvelable dans les collectivités et le travail de la DGIC ont permis aux personnes-ressources des régions de créer des rapports efficaces entre les projets d'infrastructure en cours et les projets d'écoÉNERGIE. En outre, l'expertise technique dont dispose la DGIC a permis aux personnes-ressources régionales de fournir un soutien efficace aux collectivités qui entreprenaient un projet d'énergie renouvelable à l'aide d'écoÉNERGIE. En renforçant et en élargissant le soutien régional aux projets d'écoÉNERGIE en développement, AADNC serait en mesure de maximiser son rendement du capital investi en veillant à fournir une orientation appropriée aux projets. Afin de mettre à profit cette capacité, les évaluateurs voient deux modes d'action possibles : 1) réaliser une entente avec Opérations régionales pour officialiser le soutien que le personnel de la DGIC apporte au développement des projets d'écoÉNERGIE; ou 2) déplacer le programme écoÉNERGIE au Secteur des opérations régionales, comme il a déjà été prévu à l'Architecture d'alignement des programmes d'AADNC.
Pour soutenir le premier mode d'action, différents coordinateurs régionaux ont dit que leur rôle actuel se limitait à transférer les fonds aux projets et qu'ils souhaiteraient jouer un rôle plus important et améliorer les communications avec le personnel de l'administration centrale à l'étape d'approbation des projets. De leur point de vue, une communication et une coordination accrues entre l'administration centrale et les régions conduiraient à une meilleure sélection de projets et à un soutien plus adapté aux collectivités bénéficiaires. Le Programme d'action communautaire visant les Autochtones et les habitants du Nord, qui a existé de 2003 à 2006 et qui précédait le programme écoÉNERGIE, disposait de personnel à temps plein dans les bureaux régionaux. Cependant, comme il a été déterminé que ce système était inefficace et non viable en raison du financement limité du programme, il a été supprimé de la version actuelle du programme écoÉNERGIE. Pour répondre à ces préoccupations, le programme écoÉNERGIE pourrait élaborer un modèle hybride de participation régionale avec la DGIC en officialisant un réseau régional des membres du personnel de la direction générale, notamment les ingénieurs et les spécialistes de la gestion de projet d'infrastructure déjà en place, afin d'appuyer la conception des projets d'écoÉNERGIE.
En ce qui concerne le deuxième mode d'action, la coordination entre le personnel de l'administration centrale d'écoÉNERGIE et les personnes-ressources des régions pourrait s'améliorer considérablement en détachant le programme écoÉNERGIE du Bureau des affaires du Nord pour l'intégrer dans le Secteur des Opérations régionales sous la responsabilité de la Direction générale des infrastructures communautaires, tout en conservant les autorisations de financement qui permettent au programme de fonctionner au nord comme au sud du 60e parallèle. Dans sa position actuelle aux Affaires du Nord, le programme écoÉNERGIE est éloigné à la fois des autres secteurs du Ministère et des bureaux régionaux, ce qui limite sa capacité de créer des partenariats avec d'autres secteurs et d'obtenir du financement supplémentaire. En comparaison, la DGIC entreprend des projets d'infrastructure et possède une expertise technique en région qui faciliterait l'intégration des projets en matière d'énergie renouvelable dans un plus grand nombre de projets d'infrastructure dont le financement a déjà été approuvé. De plus, la DGIC possède déjà un personnel en région dans tout le pays qui pourrait jouer un rôle vital pour faire la promotion du programme écoÉNERGIE dans les collectivités et appuyer la gestion de projet sur les lieux.
Si ce deuxième mode d'action est retenu, il faut aussi rappeler que la DGIC ne fonctionne qu'au sud du 60e parallèle, de sorte que le programme écoÉNERGIE devra compter fortement sur l'Agence canadienne de développement économique du Nord pour appuyer la gestion de la partie nordique de son programme. L'Agence canadienne de développement économique du Nord serait un partenaire approprié pour le programme écoÉNERGIE, parce les modalités du programme Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord de cette Agence permettent aux collectivités d'avoir accès à du financement pour l'étude et la construction de projets d'énergie renouvelable.
Recommandation no 5 : Il est recommandé que le sous-ministre adjoint des Affaires du Nord travaille avec le sous-ministre adjoint principal des Opérations régionales pour améliorer la coordination du financement des projets d'énergie renouvelable au sein des collectivités autochtones ayant lieu au sein de la Direction générale des infrastructures communautaires et dans le cadre du programme écoÉNERGIE.
Constatation no 12 : Les volets A et B ont accordé du financement pour les études et les projets nécessaires; toutefois, il est possible de renoncer aux catégories de financement rigides et de passer au financement de la bonne étape sur l'ensemble des mesures de développement des énergies renouvelables qui favorisent le transfert des études aux infrastructures concrètes.
La première version du programme écoÉNERGIE à AADNC a été lancée en avril 2003. Depuis, les collectivités bénéficiaires ont mis en œuvre divers types de projets, y compris des plans énergétiques pour la collectivité, des études de faisabilité et la réalisation de projets d'énergie renouvelable de faible envergure pour soutenir une partie des besoins de la collectivité en électricité ou en chauffage. Dans un certain nombre de collectivités bénéficiaires d'écoÉNERGIE, les évaluateurs ont pu constater que le champ d'études en matière d'énergie renouvelable est vaste et qu'en ce qui concerne les projets du volet A, il faut effectuer bon nombre d'études préliminaires et d'évaluations environnementales pour faire passer un projet de la conception à la réalisation. Les collectivités ont peu de garanties que leur projet verra jamais le jour ou qu'il fournira l'énergie et les économies voulues.
La petite équipe affectée à écoÉNERGIE à l'administration centrale, qui travaille selon les paramètres établis de financement, c'est-à-dire pour un an, a procédé à une répartition prudente des ententes de financement à un large éventail de projets dans l'ensemble du Canada. Dans même temps, elle reconnaît que certaines collectivités ont besoin d'un financement réparti sur plusieurs années pour assurer la réussite d'un projet d'énergie renouvelable de grande envergure.
Cependant, malgré ces efforts, comme le développement d'un projet d'énergie renouvelable de grande envergure exige un nombre important d'études et d'évaluations, les collectivités peuvent se trouver coincées et perdre leur élan initial lors de la phase de développement du projetNote de bas de page 118. Des 43 collectivités qui ont reçu un financement du volet A d'avril 2011 à novembre 2014, trois ont des projets en phase d'exploitation, trois sont à la phase de la construction, trois devraient entreprendre la phase de construction d'ici peu, alors que 28 collectivités doivent faire des évaluations supplémentaires ou attendent une autre source de financement. Les projets du volet A se développent habituellement sur une période de cinq à dix ans environ; c'est pourquoi 28 collectivités qui n'ont pas de sources de financement soutenues courent le risque de perdre leur impulsion et de s'immobiliser à l'étape des évaluations préalables. Dans certains cas, la solution technologique en énergie renouvelable qu'on a proposée à la collectivité pourrait ne pas être la solution la plus économique; pour d'autres, les coûts supplémentaires et nécessaires à la préparation d'un projet en vue d'obtenir un investissement privé pour construire représentent un défi de taille.
De même, la collectivité qui fait faire une étude de faisabilité pour finalement constater que le projet qu'elle avait envisagé n'est pas réalisable peut être découragée par de tels résultats. Dans l'une des collectivités visitées, les évaluateurs ont constaté que le projet financé par écoÉNERGIE a été jugé non réalisable. Découragée, la collectivité a mis fin aux quêtes de systèmes à énergie renouvelable, y compris des autres options viables. Après en avoir discuté avec le chef de bande, les évaluateurs ont pris note que le programme écoÉNERGIE devrait avoir une stratégie d'atténuation du risque pour remédier aux projets considérés non viables et conserver des relations harmonieuses entre le Ministère et les collectivités touchées. Les évaluateurs ont aussi remarqué qu'une réorganisation éventuelle du programme qui mettrait l'accent sur l'apport de soutien aux collectivités dans leur grand projet d'énergie renouvelable pourrait atténuer ces scénarios difficiles.
« J’aimerais que ce programme ait une approche mieux ciblée. Je voudrais que le Ministère cible des collectivités et qu’il les soutienne tout au long du processus. » – Dirigeant d’une collectivité interrogé
Selon l'Agence internationale de l'énergie, un programme d'énergie renouvelable ne peut avoir du succès que si l'environnement politique dans lequel il fonctionne offre un large éventail de mesures de soutien à partir de l'étape de la recherche jusqu'à la mise en œuvre du projetNote de bas de page 119. Pourtant, l'approche actuelle d'écoÉNERGIE fondée sur les propositions, à laquelle vient se greffer le manque de fonds pour les dépenses de capital pour la construction de grands projets, ne permet pas au Ministère de soutenir les collectivités à travers toutes les étapes. La stratégie de développement des collectivités qui ressort de la région de la ColombieBritannique d'AADNC et l'engagement d'AADNC envers le cadre de développement communautaire traditionnel devrait inciter écoÉNERGIE à considérer les avantages de déplacer son orientation axée sur les projets à une orientation axée sur les collectivités qui offre un soutien tout au long du continuum de développement des énergies renouvelables. Une orientation axée sur les collectivités serait aussi peut-être mieux à même d'atténuer les risques menaçant les relations lorsqu'une étude de faisabilité détermine qu'un projet est non réalisable, car la collectivité serait alors assurée d'une participation continue du programme en vue de trouver des solutions de rechange pour la collectivité touchée. En se servant d'une rubrique de classement des besoins des collectivités qui prend en compte l'éloignement, les coûts énergétiques, la dépendance au diesel, le degré d'usure et la qualité de l'infrastructure du diesel, les possibilités de développement économique et à quel point les politiques provinciales favorisent le développement des énergies renouvelables, le programme serait en mesure d'offrir des investissements plus importants à un plus petit nombre de collectivités chaque année. Il s'agit d'une approche plus stratégique qui permettrait de stimuler le développement de projets et d'assurer une coordination avec les autres partenaires fédéraux et provinciaux pour veiller à ce qu'une solution d'énergie renouvelable soit en voie de réalisation avant d'examiner le financement de la prochaine collectivité aux besoins les plus pressants qui désire explorer des solutions en matière d'énergie renouvelable.
Même si certaines personnes interrogées sont d'avis que de petits investissements dans tout le Canada accordés par un programme fondé sur les propositions permettraient aux collectivités motivées d'y avoir accès et de faire participer un plus grand nombre de collectivités, les évaluateurs constatent, pour leur part, qu'il existe beaucoup de possibilités de financement au niveau provincial dont ils pourraient se prévaloir, ce que montre l'Annexe B. Par ailleurs, une approche par niche permettrait d'éclaircir les rôles et les responsabilités des acteurs principaux sur le terrain et de réduire les possibilités de chevauchement entre programmes, ce que montre l'Annexe A.
En outre, l'actuel modèle des projets fondés sur des propositions oblige la collectivité à déterminer d'abord le type de projet qu'elle veut entreprendre avant de présenter une proposition pour obtenir du financementNote de bas de page 120. Cela semble problématique, les entrevues avec les membres de la collectivité ayant montré que les gestionnaires de projet au sein des bureaux de conseil de bande se sentent souvent dépassés par l'étendue des choix disponibles, lesquels comprennent : l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la microproduction d'hydroélectricité, l'énergie géothermique, la bioénergie, les systèmes de récupération de chaleur, les piles à combustible, les dispositifs de stockage de l'énergie, les compteurs intelligents, etc. En raison de la disponibilité des ressources, des coûts de la technologie, des éventuelles économies de coûts et des expériences des autres collectivités, une technologie d'énergie renouvelable en particulier peut être attrayante pour une collectivité. Toutefois, comme l'a révélé la revue de la littérature (se reporter à l'annexe C : Coûts et avantages des technologies liées à l'énergie renouvelable), l'option à privilégier dépend souvent d'un large éventail de considérations, propres à chaque collectivité, et fait parfois appel à une combinaison de technologies. De plus, dans certains cas, il est plus approprié d'impliquer en premier lieu un partenaire financier, chargé de surveiller l'utilisation de l'énergie par la collectivité bénéficiaire au moyen de l'installation de compteurs intelligents, puis d'envisager la modernisation des petits immeubles afin de s'attaquer au gaspillage d'énergie et de maximiser la conservation de l'énergie avant d'entreprendre l'élaboration d'un projet d'énergie renouvelable.
Il sera peut-être avantageux pour le programme écoÉNERGIE de délaisser les volets de financement pour adopter un processus en trois étapes : premièrement, déterminer les collectivités prioritaires; deuxièmement, financer l'évaluation des meilleures options d'énergie renouvelable pour les collectivités ciblées; et enfin, mettre en œuvre l'option d'énergie renouvelable la plus viable. L'Alaska Energy Authority a utilisé une conception de programme semblable. Dans le cadre de ce programme, la première étape a servi à évaluer diverses technologies d'énergie renouvelable, ainsi que la façon dont différentes technologies et sources de stockage peuvent être combinées pour optimiser le potentiel d'énergie en fonction des conditions économiques et environnementales de chaque collectivité. Plusieurs scénarios impliquant chaque collectivité ont été évalués dans le but de déterminer le niveau de pénétration de l'énergie renouvelable le plus élevé, qui serait techniquement et économiquement viable. Si le programme écoÉNERGIE décidait d'imiter cette approche, il devrait cesser de financer les études qui visent à déterminer la viabilité et le coût d'une seule option de technologie renouvelable, au profit d'une évaluation de différents scénarios technologiques afin de trouver la solution technique et économique qui convient le mieux à chaque collectivité. Des logiciels de modélisation informatique éprouvés comme HOMER SoftwareNote de bas de page 121 permettent aux collectivités de concevoir des miniréseaux hybrides d'énergie renouvelable éloignés ou rattachés à un grand réseau.
En faisant la promotion d'une approche axée sur la collectivité et en finançant l'évaluation de l'option technologique qui convient le mieux à chaque collectivité ciblée, le programme écoÉNERGIE serait à même d'appuyer les collectivités en abandonnant les études de faisabilité pour passer à des projets d'énergie renouvelable opérationnels. Aux étapes de soutien, le programme pourrait également offrir d'autres formes d'aide à la collectivité, comme de l'information pédagogique visant à faire connaître les technologies d'énergie renouvelable et à faire participer les membres de la collectivité à la conception et à l'élaboration des projets. Par exemple, il serait possible d'étendre à tous les projets financés par le programme écoÉNERGIE des initiatives en milieu scolaire, comme celles menées par la Première Nation Nakzadil, qui ont permis à des élèves de l'école élémentaire de participer à la collecte de données solaires et éoliennes, ou de la formation et du mentorat à l'intention des travailleurs communautaires, comme ceux offerts dans les Premières Nations Eel Ground et T'Souke. La revue de la littérature a également mis en évidence l'utilité des technologies d'énergie renouvelable comme tremplin professionnel et catalyseur de la création des connaissancesNote de bas de page 122,Note de bas de page 123.
Constatation no 13 : Il est possible d'accroître les connaissances, la capacité et la confiance dont ont besoin les collectivités pour entreprendre des projets, en faisant la promotion d'initiatives de partage des connaissances et de mentorat.
Dans la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable dans un contexte où l'appui du personnel du bureau régional d'AADNC est limité, certaines collectivités rencontrent des difficultés importantes liées à la gestion de projets techniques d'envergure. Les personnes interrogées dans le cadre de l'étude de cas ont déclaré se sentir isolées et stressées lorsqu'elles entreprennent des projets d'énergie renouvelable, en particulier à certaines étapes clés du processus, comme la recherche d'entrepreneurs, le choix de la technologie d'énergie renouvelable la mieux adaptée à leurs besoins et la supervision de la gestion de projet.
« Il est essentiel d’avoir un champion. Même si elle n’a pas les capacités, la collectivité peut tout de même avoir un champion qui se charge de communiquer avec les membres de la collectivité. De nombreuses demandes du gouvernement fédéral exigent le nom du chef de bande sur le formulaire, mais c’est celui du champion qui s’est associé à la collectivité qui importe le plus. Ces projets sont trop complexes pour être réalisés sans les champions. [Le Ministère] doit soutenir ces personnes. » – Un entrepreneur
Dans le cas de plusieurs projets d'énergie renouvelable, comme les microcentrales hydroélectriques ou les grands parcs éoliens/centrales solaires, les collectivités doivent se frayer un chemin à travers l'environnement difficile des études de préfaisabilité/faisabilité, obtenir l'approbation des organismes de réglementation environnementale, construire/concevoir l'installation et obtenir des fonds du secteur privé pour la construction du projet. Les collectivités qui ont réussi à développer de tels projets ont, dans de nombreux cas, eu à parcourir un processus long et intense d'apprentissage « sur le tas ». Souvent, les chefs de projet ont travaillé inlassablement à soutenir l'élaboration des projets et gérer ceux-ci en passant par les multiples étapes et obstacles qui jalonnent la réalisation d'un projet. Étant donné que bon nombre de collectivités veulent mener des projets en utilisant des technologies d'énergie renouvelable similaires, l'expérience et les connaissances acquises par celles qui ont réalisé de tels projets pourraient être extrêmement utiles tout au long du processus d'élaboration du projet, car cela permettrait aux collectivités de tirer parti des leçons apprises et d'éviter les erreurs les plus courantes.
Le programme écoÉNERGIE a la possibilité de créer un volet de mentorat qui relierait les gestionnaires de projet écoÉNERGIE antérieurs et les collectivités qui se préparent à mettre sur pied des projets similaires. Le volet de mentorat aiderait au transfert de renseignements et d'expériences sur l'élaboration de projets d'énergie renouvelable. Les investissements destinés au mentorat devraient être consentis là où l'intérêt de la collectivité et l'état de préparation sont manifestes, et où l'acceptation au projet est forte, de manière à accroître le succès des projets d'énergie renouvelableNote de bas de page 124. Les collectivités qui ont déjà été retenues par le programme, en particulier celles qui sont propriétaires ou copropriétaires de leur système énergétique, peuvent jouer un rôle de mentorat crucial, échanger leur savoir sur le processus d'élaboration et identifier les partenaires clés, susceptibles de contribuer à l'approvisionnement fiable et propre de l'énergie dans les collectivités éloignéesNote de bas de page 125.
Le concept de l'élaboration de mentorats au sein des programmes jouit d'un succès grandissant à AADNC. Par exemple, le bureau régional de la Colombie-Britannique d'AADNC s'est associé au conseil tribal Nautsa mawt en vue de mettre en œuvre une initiative de mentorat visant à aider les Premières Nations de la province à élaborer des plans communautaires globaux. Cette initiative fournit du soutien, des outils et des cadres, et prévoit l'échange de pratiques exemplaires entre les collectivités expérimentées et les communautés qui sont au tout début du processus d'élaboration d'un plan communautaire globalNote de bas de page 126. Dans certains cas, les gestionnaires de projets d'énergie renouvelable réussis ont été inscrits par un organisme de bienfaisance sans but lucratif pour offrir du mentorat aux collectivités qui en sont aux premiers stades de l'élaboration de projet. Toutefois, les collectivités qui ont profité de cette occasion de mentorat étaient d'avis que leur impact pourrait être plus grand avec un programme de mentorat plus développé, qui leur permettrait de rendre visite aux collectivités rattachées à un mentor et de jouer un plus grand rôle par rapport au soutien à l'élaboration de projets d'énergie renouvelable par les collectivités.
Par ailleurs, certains services publics provinciaux offrent des ateliers et de la formation aux dirigeants communautaires qui prennent part à l'élaboration de projets d'énergie renouvelableNote de bas de page 127. D'autres intervenants du secteur privé ont imaginé un programme de formation intensif complet, qui allait changer le paysage dans lequel évoluent les chefs et les collectivités autochtones au chapitre de l'élaboration et de la gestion des systèmes d'énergie renouvelable qui leur appartiennentNote de bas de page 128.
« Si j’étais une collectivité qui commence tout juste un projet, je voudrais savoir comment cela s’est passé dans d’autres collectivités. » – Chef de projet dans une collectivité
En plus du programme de mentorat, qui permet de renforcer les capacités, d'autres sources de partage des connaissances doivent être mises à la disposition des collectivités qui entreprennent des projets d'énergie renouvelable. Bien que la majorité des personnes interrogées aient discuté de leur participation dans divers groupes de travail, sommets sur l'énergie, forums, conférences et ateliers, la totalité d'entre elles a déclaré avoir besoin de renseignements supplémentaires, la technologie de l'énergie renouvelable étant en constante évolution. Dans de nombreux cas, les collectivités ont l'impression de manquer des compétences techniques nécessaires pour choisir la bonne société d'experts-conseils, superviser adéquatement le projet et évaluer l'ouvrage final. La mise au point d'outils de partage des connaissances pourrait accroître la capacité de chaque collectivité à déterminer la technologie d'énergie renouvelable la plus adaptée à ses besoins et les sociétés d'experts-conseils avec lesquelles signer un contrat pour mettre en œuvre efficacement la technologie. Du soutien supplémentaire de la part du personnel du bureau régional peut également atténuer ce problème.
Par le partage des connaissances, les collectivités pourraient être en contact avec les ressources et le matériel pédagogique existants, comme les documents de formation produits par l'Office of Indian Energy du département de l'Énergie des États-Unis, l'Alliance pour l'Électrification Rurale, Clean Energy Canada, l'Association canadienne de l'électricité et d'autres agences de l'énergie. De même, la simple création d'un site de réseaux sociaux, qui permet aux participants d'échanger, aiderait les responsables de projet, qui se disent souvent débordés et seuls au moment de l'élaboration des projets, à puiser dans les expériences de chaque collectivité. Le site Facebook de la Planification communautaire globale pour les Premières Nations de la ColombieBritannique en est un bon exempleNote de bas de page 129.
3.5 Efficience du programme
Constatation no 14 : En raison du processus interne d'approbation de projet, il arrive souvent que le financement soit fourni pendant les mauvaises saisons de construction.
Les personnes interrogées dans le cadre de l'étude de cas ont mentionné que, en raison du processus d'approbation du programme écoÉNERGIE et du calendrier du financement, il est difficile pour les collectivités de terminer les projets d'énergie renouvelable. En particulier, il a été mentionné que l'octroi de fonds dans les mois d'automne et d'hiver aux projets approuvés engendre des coûts et des retards considérables et inutiles. Par exemple, un groupe de gestion de projet a entrepris une étude de faisabilité pour laquelle le programme écoÉNERGIE avait fourni du financement pendant les mois d'hiver, avec comme exigence que l'étude soit terminée avant la fin de l'exercice. Le groupe n'avait donc d'autre choix que d'engager des experts-conseils pour étudier un fleuve gelé et faire des hypothèses sur la faisabilité d'un projet d'aménagement hydroélectrique sans avoir pu étudier le débit réel de la rivière au printemps ou en été.
La lenteur des transferts de fonds et l'exigence imposée aux collectivités de gérer les fonds pour poursuivre l'avancement des projets représentent une autre difficulté pour les communautés bénéficiaires, car elles placent les collectivités qui disposent de moins de ressources financières dans une position difficile et risquent d'entraîner des retards dans l'exécution des projets. Les experts-conseils qui travaillaient dans ce contexte devaient souvent faire preuve de patience avant d'être payés; certains d'entre eux ont même assumé seuls les dépenses du projet jusqu'à ce que le financement arrive. Toutefois, les personnes interrogées dans le cadre de l'étude de cas ont souligné que la rapidité du processus d'approbation s'est améliorée au cours des deux dernières années, depuis que le programme envoie plus tôt les appels de propositions. À cause des échéances du financement en cours d'exercice, l'approbation et le versement des fonds sont souvent différés dans le cadre des programmes de financement des infrastructures du gouvernement fédéral; toutefois, si les collectivités participaient concrètement à la conception de programmes, cette difficulté pourrait être atténuée. Le personnel du programme qui travaille avec les collectivités pour élaborer des propositions de projet met à profit sa connaissance approfondie de certaines collectivités, assurant ainsi que l'élaboration du projet et les ententes de financement ultérieures sont terminées au moment voulu au cours de l'année.
Constatation no 15 : Le programme écoÉNERGIE a la possibilité d'améliorer sa stratégie de mesure du rendement pour faire le suivi de l'efficience du programme et pour cerner plus efficacement tous les projets d'énergie renouvelable d'AADNC.
La définition et la mise en œuvre de la stratégie de mesure du rendement du programme écoÉNERGIE ont été jugées appropriées. Les évaluateurs ont également constaté que les renseignements sur le rendement recueillis sont utilisés régulièrement par les gestionnaires de programme pour la prise de décisions.
La stratégie de mesure du rendement du programme a été approuvée initialement par le Comité de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen, en mai 2011, à l'étape de la conception du programme (il s'agit du moment idéal pour créer un régime de gestion du rendement). Par la suite, la stratégie de mesure du rendement a été mise à jour, puis approuvée en février 2014, pour se conformer aux nouvelles directives transmises par le Secrétariat du Conseil du Trésor. Pour gérer le rendement du programme, la stratégie exigeait particulièrement l'évaluation par un tiers des réductions des émissions de GES projetées afin de suivre l'objectif principal du programme et de permettre au programme de choisir les projets qui apportent le plus haut potentiel de réduction de GES. Les évaluateurs ont pu établir que les objectifs du programme sont atteints sur la foi de la qualité des données fournies par la stratégie de mesure du rendement.
Bien que le programme fasse suffisamment le suivi de ses indicateurs de rendement, les évaluateurs ont relevé plusieurs possibilités d'amélioration. Tout d'abord, il est possible d'améliorer l'indicateur de réduction des GES. Cet indicateur pourrait également mesurer les litres de diesel déplacés pour démontrer l'efficacité du programme en réduisant la dépendance au diesel des collectivités concernées. Deuxièmement, le régime de gestion de l'information du programme pourrait être plus efficace. Même si les données du programme étaient suffisamment disponibles, il a été difficile d'analyser les résultats du programme obtenus entre 2011 et 2015 et de comparer ces résultats à des programmes similaires mis sur pied depuis 2003. Enfin, parce que le système de gestion de l'information est isolé, le programme ne peut suivre que les études sur l'énergie renouvelable et les projets financés par le programme écoÉNERGIE, tandis que le Ministère appuie des études et des projets similaires au moyen d'autres sources de financement. Par conséquent, pour suivre chronologiquement les projets d'énergie renouvelable financés par le programme écoÉNERGIE et évaluer l'ensemble des projets d'énergie renouvelable soutenus par AADNC, il est possible de saisir l'état des projets écoÉNERGIE et les renseignements sur le rendement dans le Système intégré de gestion des immobilisations du Ministère. En intégrant potentiellement le programme dans la base de données exclusive du Ministère sur les projets d'immobilisations, des projets comme le projet d'énergie solaire de la Première Nation T'Souke, qui est financé à la fois par écoÉNERGIE et le Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations, pourraient être considérés comme un seul et même projet d'immobilisations dans le système au lieu d'être suivis dans plusieurs bases de données.
Recommandation no 6 : Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE mette à jour sa stratégie de mesure du rendement et l'évaluation des risques de façon à tenir compte des considérations relatives à la nouvelle conception du programme et à déterminer la méthode de suivi à utiliser pour suivre l'achèvement des projets d'énergie renouvelable financés dans l'ensemble du Ministère.
Constatation no 16 : Il se peut que les objectifs de réduction des GES de certains projets ne se réalisent pas pleinement si la collectivité n'a pas prévu de plan d'exploitation et d'entretien des projets d'énergie renouvelable, une fois ceux-ci implantés.
« Je n’ai encore fait aucun entretien. J’ignore ce qui doit être fait exactement. » – Chef de projet dans une collectivité
Les personnes interrogées dans le cadre de l'étude de cas ont révélé que, bien que les projets d'énergie renouvelable soient perçus comme de précieuses contributions à la durabilité économique et environnementale des collectivités, peu d'entre elles ont élaboré un plan pour l'entretien et les réparations futurs de l'équipement ou des installations. La plupart des personnes interrogées ont dit s'attendre à ce que les coûts d'entretien soient minimes et peu fréquents, ou se le sont fait dire par les fournisseurs de technologie d'énergie renouvelable. Plusieurs collectivités ont exprimé leurs inquiétudes, car elles craignent que le personnel d'entretien des installations soit incapable d'entreprendre les réparations ou l'entretien nécessaires en raison de la nature technique des projets d'énergie renouvelable. Par conséquent, les collectivités sont préoccupées par le fait que, pour effectuer toute réparation, elles auront à faire appel au fournisseur de technologie d'énergie renouvelable, ce qui risque d'entraîner des coûts considérables. Étant donné qu'AADNC n'est pas tenu de fournir des fonds pour couvrir les dépenses de fonctionnement et d'entretien liées aux projets d'énergie renouvelable financés par le programme écoÉNERGIE, les coûts d'entretien et de réparation sont à la charge de la collectivité.
En l'absence d'un plan d'exploitation et d'entretien, il se peut que le projet d'énergie renouvelable ne parvienne pas à produire de l'énergie propre pour la collectivité, si l'équipement ne fonctionne pas bien et que la collectivité est incapable de le réparer ou le remplacer. Par exemple, une collectivité qui a installé des panneaux solaires sur un bâtiment appartenant à la bande à l'aide du financement du programme écoÉNERGIE a fait remarquer qu'elle n'a pas fait l'entretien des panneaux depuis qu'ils ont été installés; elle n'a fait ni le nettoyage ni le déblaiement de la neige accumulée sur les panneaux en hiver. L'absence d'entretien de la part de cette collectivité est non conforme aux recommandations du département de l'Énergie des États-Unis relatives à l'entretien des panneaux solaires. Selon ces recommandations, les systèmes d'énergie solaire ou photovoltaïques ont besoin d'un entretien systématique périodiqueNote de bas de page 130. Parce que les projets achevés financés par le programme écoÉNERGIE ne sont pas entretenus, ils risquent de ne pas réussir à réduire les émissions de GES à leur pleine mesure à cause du mauvais fonctionnement de l'équipement d'énergie renouvelable, ce qui, du même coup, affecte le rendement global du capital investi à AADNC.
La recension des écrits a également révélé le large éventail de compétences nécessaires pour entretenir les systèmes d'énergie renouvelable, comme il est indiqué dans le tableau suivant, où E, M et F renvoient à des ensembles de compétences élevées, moyennes et faibles.
| Énergie renouvelable | Compétences requises pour l'exploitation et l'entretien |
|---|---|
| Énergie éolienne |
|
| Énergie solaire (photovoltaïque, technologie de la thermie solaire, énergie solaire concentrée, systèmes de pompage) |
|
| Hydroélectricité |
|
| Énergie géothermique |
|
| Bioénergie |
|
| Production de biomasse |
|
Comme le montre le tableau ci-dessus, un bon nombre de postes requis pour exploiter et entretenir les systèmes exigent un niveau moyen de compétences, qui manquent souvent dans les collectivités éloignées. Pour assurer la durabilité des projets mis en œuvre par le programme écoÉNERGIE, le développement des capacités communautaires et le volet de mentorat représentent une nécessité absolue lorsque vient le temps de travailler avec les collectivités pour développer un système d'énergie renouvelable.
3.6 Économie du programme – coûts-avantages
Constatation no 17 : La proportion des fonds du programme affectés au salaire et aux coûts de fonctionnement et d'entretien est en grande partie attribuable aux examens techniques et à l'expertise requise pour évaluer les propositions de projet, ainsi qu'à la nécessité de coordonner les fonds avec les autres ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux.
En 2011, le programme écoÉNERGIE a reçu 20 millions de dollars sur cinq ans (2011-2012 à 2015-2016). Comme le montrent les tableaux ci-dessousNote de bas de page 132, du 1er avril 2011 au 31 mars 2014, le programme a versé en moyenne 42 $ en salaire, Opérations et entretien, et en avantages sociaux par tranche de 100 $ dépensés sur les projets approuvés. Autrement dit, il en coûte en moyenne 12 073 $ pour évaluer et approuver ou refuser une proposition de projet présentée par une collectivitéNote de bas de page 133.
| Réels | 2011-2012 | 2021-2013 | 2013-2014 | Total |
|---|---|---|---|---|
| RÉMUNÉRATION (AADNC) | 718 046,22 | 702 314,58 | 807 862,38 | 2 228 223,18 |
| DÉPENSES NON SALARIALES (AADNC) | 353 636,28 | 255 041,49 | 266 334,88 | 875 012,65 |
| SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 2 819 787 | 2 894 045 | 2 710 976 | 8 424 808 |
| Total | 3 891 469,50 | 3 851 401,07 | 3 785 173,26 | 11 528 043,83 |
| 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | |
|---|---|---|---|
| Crédit 1 + régime d'avantages sociaux des employés (RASE) | 1 215 291,74 | 1 097 818,99 | 1 235 769,74 |
| (Crédit 1 + RASE)/crédit 10 | 0,431 | 0,379 | 0,456 |
| Coût par tranche de 100 $ de subventions et contributions | 43,10 | 37,93 | 45,58 |
| 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | |
|---|---|---|---|
| Nombre de propositions reçues | 81 | 110 | 110 |
| Nombre de propositions approuvées et financées | 36 | 39 | 32 |
| Coût par proposition reçue | 15 004 | 9 980 | 11 234 |
| Coût par proposition financée | 33 758 | 28 149 | 38 618 |
À première vue, les coûts d'exploitation du programme sont plus élevés que ceux que l'on prévoit généralement dans un programme de subventions et contributions à AADNC. Cela tient au fait que le programme reçoit un grand nombre de propositions qui, pour la plupart, ne peuvent être approuvées en raison d'un financement de programme limité, mais qui nécessitent malgré tout une évaluation complète. Bien qu'à peine 36 % des propositions soient financées par le programme, chaque proposition doit être évaluée et classée par ordre de priorité. De même, pour évaluer tous les aspects des propositions de projet, il faut du personnel hautement qualifié, qui possède une formation scientifique et technique. En plus des coûts élevés que représente l'examen des propositions de projet, le personnel du programme participe activement à la liaison avec les provinces, les territoires, les services publics et les collectivités pour déterminer les projets qui auront le plus grand impact.
Dans l'ensemble, les coûts de fonctionnement du programme sont nécessaires pour s'assurer que les propositions de projet sont correctement évaluées et classées, que les collectivités ont le soutien dont elles ont besoin et que les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux participent activement au projet. Le développement de relations — une priorité importante du Ministère — nécessite davantage de ressources, car, pour réussir un projet, tout ne se résume pas à offrir un chèque aux collectivités dont le projet a été approuvé. Toutefois, les frais d'exploitation élevés représentent également une question d'économie d'échelle. Le montant de subventions et de contributions que peut verser aux collectivités le programme écoÉNERGIE est peu élevé, et il faut plus de personnel pour exécuter un programme, même petit. Si l'exécution du programme était transférée à la Direction générale des infrastructures communautaires d'AADNC, le programme serait appuyé par les systèmes de soutien existants, ce qui réduirait les coûts indirects et les coûts d'exploitation. En outre, en modifiant la conception fondée sur les propositions, il serait possible de réduire les coûts irrécupérables découlant de l'évaluation des propositions refusées. Par exemple, en 2013-2014, 78 propositions ont été évaluées à un coût d'exploitation interne d'environ 12 073 $ par proposition, ce qui correspond à un total de 941 694 $ en coûts d'exploitation internes, qui seraient plus utiles s'ils servaient à cibler et à soutenir les projets réalisables dans les collectivités qui en ont le plus besoin.
Constatation no 18 : Bien que les grands systèmes d'énergie renouvelable puissent avoir des avantages considérables sur le plan environnemental et financier pour les collectivités, la production d'énergie diesel des scénarios de réseau électrique autonome demeure souvent l'approche la plus rentable.
Bien que de grands projets d'énergie renouvelable entrepris par les collectivités reliées à un réseau (par le truchement du volet A du programme écoÉNERGIE) aient produit des résultats substantiels, la situation est très différente dans les collectivités hors réseau. Plus précisément, les collectivités hors réseau sont souvent très petites; elles ont donc des besoins énergétiques moindres, ce qui réduit le potentiel de développement économique que représente un projet d'énergie renouvelable. Les principales personnes interrogées se sont dites inquiètes du fait que, pour les collectivités hors réseau qui entreprennent de grands projets d'énergie renouvelable, le tarif par kilowattheure de l'énergie produite par les projets achevés risque d'être plus élevé que celui de l'énergie produite par les actuels systèmes utilisant des générateurs diesel. Pour ces collectivités, les systèmes alimentés au diesel représentent l'option la plus rentable, même si celle-ci n'est pas la plus durable ou la plus respectueuse de l'environnement. En particulier, le transport de carburant diesel pour les collectivités hors réseau éloignées est parfois difficile et coûteux, et si le volume de diesel nécessaire n'est pas calculé correctement, il faut peut-être s'attendre à des baisses de tension ou à des pannes d'électricité en cas de rationnement. Afin de réduire les conséquences environnementales négatives de la production d'énergie à l'aide de générateurs diesel et d'accroître la constance de l'approvisionnement énergétique, certaines collectivités entreprennent des projets d'énergie renouvelable, même si cela implique un prix plus élevé par kilowattheure. Dans ces collectivités, les gestionnaires de projet espèrent ou prévoient bénéficier de subventions de la part des services publics afin de compenser l'augmentation du coût par kilowattheure.
Le tableau ci-dessous donne un exemple du prix par kilowattheure de l'énergie produite par les systèmes d'énergie renouvelable et décrit en détail les coûts liés à chaque option d'approvisionnement en énergie utilisée dans les Territoires du Nord-Ouest. Comme l'illustre le tableau, la production d'énergie à l'aide de générateurs diesel reste l'option la plus rentable, à l'exception des projets hydroélectriques de grande taille.
Tableau 9 : Coûts des options d'approvisionnement de l'énergie dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.)
| Source d'électricité | Sous-produit de la production de chaleur | Coût de l'énergie ($/kWh) | Coûts d'installation ($/kWh) | Ressources locales requises | Considérations environnementales | Autres commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | Oui | 0,35 $ | 3 000 $ | Non | Non renouvable; émission de GES | Norme actuelle de fiabilité dans le Nord |
| Petite centrale hydro (1 MW) | Non | 0,375 $ - 0,626 $ | 4 000 $ - 30 000 $ |
Essentielles | Renouvelable; faible émission de GES | Peut fournir la capacité et l'énergie requises pour remplacer le diesel |
| Grande centrale hydro (100 MW) | Non | >0,050 $ + transmission | >2 500 $ + transmission | Essentielles | Renouvelable; faible émission de GES | Peut fournir la capacité et l'énergie requises pour remplacer le diesel |
| Production combinée de chaleur et d'électricité - biomasse | Oui | Variable | Variable | Facteur de coût | Renouvelable; GES comparables à ceux du diesel | Solution surtout intéressante sur le plan économique lorsque les sous-produits peuvent être utilisés |
| Solaire | Non | 0,59 $ - 0,83 $ |
9 000 $ - 14 000 $ |
Non | Renouvable; faible émission de GES | Aucune capacité de stockage; capacité installé, limitée à 20 à 30 % de la charge moyenne |
| Éolienne | Non | 0,36 $ - 0,77 $ |
3 500 $ - 23 000 $ |
Essentielles | Renouvable; faible émission de GES | Aucune capacité de stockage; capacité installé, limitée à 20 à 30 % de la charge moyenne |
| Production combinée de chaleur et d'électricité - géothermie | Oui | Inconnu | Inconnu | Essentielles | Renouvable; faible émission de GES | Peut fournir la capacité et l'énergie requise |
| Gaz naturel liquéfié | Oui | <0,35 $ | 1 000 $ (conversion bicarburant) | Non | Non renouvable; émissions de GES moindre qu'avec le diesel | Peut fournir la capacité et l'énergie requises pour remplacer le diesel |
Réunion de 2014 sur la situation de l'énergie dans les Territoires du Nord-OuestNote de bas de page 134
Selon les personnes interrogées et l'information provenant de la recension des écrits, l'augmentation du prix par kilowattheure est considérée comme un obstacle au développement futur des systèmes d'énergie renouvelable dans les collectivités hors réseauNote de bas de page 135. Dans plusieurs cas, le coût de construction d'un système d'énergie renouvelable dans une collectivité hors réseau et le prix offert par les services publics au moyen d'un accord d'achat d'énergie font en sorte que le risque financier est trop grand pour les bailleurs de fonds potentiels, ce qui décourage ceux-ci à participer à de tels projets. Selon la revue de la littérature, les subsides reçus en capital ou les rabais sont essentiels au succès des politiques en matière d'énergie renouvelable et des programmes subséquents. Par exemple, BC Hydro a mis sur pied un programme d'électrification des collectivités éloignées qui aide ces dernières à recevoir le service d'électricité hors réseau de BC Hydro, souvent par le passage de la production d'énergie à l'aide de générateurs diesel à la production d'énergie propreNote de bas de page 136. Grâce à ce programme, BC Hydro verse jusqu'au coût maximal évité par la non-utilisation de diesel au moyen d'ententes d'achat d'électricité, ce qui aide les collectivités à couvrir les coûts de la dette associés à la construction de grandes installations d'énergie renouvelable. Cette pratique a facilité l'élaboration de projets qui ont considérablement réduit la consommation de carburant diesel dans certaines collectivités hors réseau.
Bien que les subventions fournies par les services publics ne soient pas du ressort du programme écoÉNERGIE, la haute direction devrait reconnaître la nécessité de mettre en place des mesures supplémentaires pour conclure des partenariats avec les services publics provinciaux afin de développer un environnement favorable à la croissance de l'industrie de l'énergie renouvelable.
Considération no 4 pour le Comité des opérations : Le Ministère étudie l'établissement des partenariats avec les services publics pour créer un environnement favorable à la croissance de l'industrie de l'énergie renouvelable dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau.
Constatation n° 19 : Les projets qui intègrent la technologie d'énergie renouvelable dans les nouveaux projets de construction sont plus rentables par rapport au remplacement des anciens systèmes.
D'après les experts sur le terrain interrogés, il est plus efficace d'intégrer un système d'énergie renouvelable à un nouveau projet de construction que de rénover une ancienne infrastructure, lorsque l'enjeu énergétique principal n'est pas l'amélioration de l'approvisionnement énergétique, mais la réduction de la demande énergétique. Selon ces scénarios, le meilleur plan d'action consiste souvent à éliminer les pertes d'énergie, notamment en modernisant les appareils d'éclairage, en installant des minuteries, en rafraîchissant l'isolation et en remplaçant les fenêtres. En comparant deux sites visités, les entrepreneurs ont mentionné qu'une installation géothermique dans une école déjà construite est moins efficace qu'une installation géothermique dans une nouvelle école. En se basant sur ses expériences antérieures, un entrepreneur a affirmé catégoriquement qu'il est souvent plus coûteux de rénover une structure existante. Même si les évaluateurs n'ont reçu que des exemples anecdotiques, il est évident que, avec la conception d'une nouvelle construction, les effets positifs d'un système d'énergie renouvelable sont souvent accrus par la combinaison du système avec d'autres normes établies par des certifications, comme la certification LEED et Green GlobeNote de bas de page 137.
Dans l'un des sites visités par les évaluateurs, le gestionnaire de projet géothermique a indiqué que, bien que la composante géothermique fît partie de la conception initiale de la nouvelle école, en raison des mesures de limitation des coûts, celle-ci aurait été éliminée de la conception du projet si le programme écoÉNERGIE n'avait pas fourni de financement. Cet exemple montre combien le partenariat entre le programme écoÉNERGIE et la Direction générale des infrastructures communautaires d'AADNC est important, et combien il permet de veiller à ce que les systèmes d'énergie renouvelable constituent une considération clé lors de l'élaboration de nouvelles infrastructures dans les réserves. De même, bien que la programmation visant l'amélioration de l'efficacité énergétique soit indispensable avant d'envisager le développement de technologies d'énergie renouvelable, le financement des projets d'efficacité énergétique ne devrait pas être confié au programme écoÉNERGIE, comme il est question à la section 3.2. Au lieu de cela, le programme pourrait envisager d'encourager les collectivités à s'associer à d'autres bailleurs de fonds pour, d'abord, augmenter leur efficacité avant de travailler avec le programme écoÉNERGIE pour développer une technologie d'énergie renouvelable.
4. Conclusions et recommandations
4.1 Conclusions
La présente évaluation du Programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques a été réalisée conformément à la Politique sur l'évaluation du Conseil du Trésor et à temps pour être prise en considération pour le renouvellement du programme en 2014-2015. L'évaluation a généré 19 conclusions, six recommandations pour la gestion du programme et quatre éléments à prendre en considération pour l'équipe de la haute direction d'AADNC, représentée par des membres du Comité d'évaluation.
L'évaluation a permis de conclure ce qui suit :
- Il y a un besoin continu de financer les projets sur l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique dans les collectivités autochtones et nordiques tout en encourageant le programme à se concentrer sur les collectivités du Nord et hors réseau.
- Le programme est conforme aux rôles et aux responsabilités du gouvernement fédéral, et plus particulièrement au mandat d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.
- Le Programme cadre avec les priorités fédérales, avec les priorités d'AADNC, et avec les besoins et priorités des collectivités autochtones et nordiques.
- Le programme donne les résultats attendus.
- Il serait bon que le programme envisage des améliorations sur le plan de la conception et de l'exécution, comme l'amélioration de la coordination avec la Direction générale des infrastructures communautaires des Opérations régionales, en examinant la conception fondée sur les propositions, en fournissant un soutien direct pour l'élaboration de projets, en coordonnant le financement du programme avec les activités des intervenants et en s'assurant que les fonds du projet sont fournis pendant la saison de construction.
4.2 Considérations pour le Comité des opérations
Considération no 1 pour le Comité des opérations : Le Ministère, en collaboration avec les partenaires fédéraux (p. ex. Agence canadienne de développement économique du Nord, Ressources naturelles Canada, SCREA) et les autres ordres de gouvernement, étudie l'élaboration d'un système central de suivi de cinq ans pour déterminer les activités et les investissements dans toutes les collectivités autochtones et nordiques hors réseau pour augmenter la collaboration stratégique.
Considération no 2 pour le Comité des opérations : Le Ministère étudie l'élaboration d'une politique ministérielle en matière d'énergie durable qui :
- appuie la conception, la construction et la mise en œuvre des systèmes d'énergie renouvelable qui fournissent de l'énergie aux collectivités en vertu du mandat d'AADNC; et
- favorise le financement des projets d'infrastructure à petite échelle qui augmentent l'efficacité énergétique afin de diminuer la demande énergétique (c.-à-d. remplacer les fenêtres, les systèmes de chaudières, les matériaux isolants, etc.).
Considération no 3 pour le Comité des opérations : Le Ministère étudie l'élaboration d'un système d'organisation et de suivi des études de faisabilité et des documents de planification communautaire financés (p. ex. vérifications de la consommation d'énergie, plans des infrastructures, plans de gestion des urgences, études sur l'adaptation aux changements climatiques, plans communautaires globaux, etc.) afin de mieux conserver les travaux financés et d'appuyer les prochaines décisions concernant le développement de l'infrastructure. La Direction générale des politiques stratégiques, de la planification et de la recherche d'AADNC peut être en mesure de créer une telle base de données centralisée et d'en faire l'un de ses outils ministériels de recherche.
Considération no 4 pour le Comité des opérations : Le Ministère étudie l'établissement des partenariats avec les services publics pour créer un environnement favorable à la croissance de l'industrie de l'énergie renouvelable dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau.
4.3 Recommandations
Recommandation no 1 : Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE définisse clairement son créneau, en mettant l'accent sur les projets d'énergie renouvelable dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau.
Recommandation no 2 : Étant donné que le programme écoÉNERGIE met l'accent sur les collectivités hors réseau et nordiques, il est recommandé que le personnel du programme transmette au Secteur des terres et du développement économique (p. ex. au Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques) les leçons apprises, les pratiques exemplaires et les propositions de projets du volet A pertinentes, car ce Secteur finance déjà ce type de projets. Le personnel du programme devrait également informer les collectivités du changement d'orientation du programme, et leur fournir des renseignements concernant les éventuelles possibilités de financement par le Secteur des terres et du développement économique.
Recommandation no 3: Lors d'un éventuel remodelage du programme écoÉNERGIE, il est recommandé de tenir compte des éléments suivants :
- supprimer les volets de financement distincts et les crédits maximums affectés aux projets;
- réviser l'approche fondée sur les propositions;
- développer une approche pour cibler les collectivités aux besoins les plus pressants;
- appuyer les projets qui intègrent des systèmes d'énergie renouvelable dans des systèmes existants à base de diesel afin de réduire la consommation de diesel; et
- fournir l'appui nécessaire aux collectivités lors de l'évaluation et de la proposition de projets d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique adaptés aux besoins.
Recommandation no 4 : Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE établisse un processus visant à élaborer une stratégie de mobilisation et de collaboration pour chaque collectivité hors réseau qu'il cible, en veillant à ce que les activités et les investissements par AADNC, les partenaires fédéraux (p. ex. Agence canadienne de développement économique du Nord, Ressources naturelles Canada, Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique [SCREA]) et les autres ordres de gouvernement, soient coordonnés pour permettre aux collectivités de passer sans heurts de la recherche au projet final, en passant par le projet pilote.
Recommandation no 5 : Il est recommandé que le sous-ministre adjoint des Affaires du Nord travaille avec le sous-ministre adjoint des Opérations régionales pour améliorer la coordination du financement des projets d'énergie renouvelable au sein des collectivités autochtones ayant lieu au sein de la Direction générale des infrastructures communautaires et dans le cadre du programme écoÉNERGIE.
Recommandation no 6 : Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE mette à jour sa stratégie de mesure du rendement et l'évaluation des risques de façon à tenir compte des considérations relatives à la nouvelle conception du programme et à déterminer la méthode de suivi à utiliser pour suivre l'achèvement des projets d'énergie renouvelable financés dans l'ensemble du Ministère.
Annexe A – Programmes complémentaires du gouvernement et possibilités d’aller chercher d’autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Programme d'immobilisations et d'entretien/Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations d'AADNC
Domaines d'activités de programme complémentaires
Le Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations, maintenant intégré au Programme d'immobilisations et d'entretien, fournit un financement ciblé pour les projets liés à l'énergie. Par exemple, le Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations et écoÉNERGIE fournissent tous deux du financement pour le même projet d'énergie solaire en Colombie-Britannique. De 2007 à 2013, le Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations a investi 11 931 526 $ dans 37 projets d'énergie dans les réserves. La somme moyenne investie dans les projets était de 136 800 $, semblable aux montants fournis pour les projets d'écoÉNERGIENote de bas de page 138.
Les auteurs de l'évaluation du Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations réalisée en 2014 ont recommandé que la Direction générale des infrastructures communautaires (DGIC) d'AADNC participe au programme écoÉNERGIE afin de définir une stratégie pour échanger les études de faisabilité réalisées. En échangeant ces études, ce partenariat soutiendrait des projets sur l'énergie qui pourraient être financés par le Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations et ferait en sorte que les agents régionaux de première ligne aient accès à cette information essentielleNote de bas de page 139.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
- Possibilité pour écoÉNERGIE d'utiliser le Plan d'investissement dans l'infrastructure des Premières Nations de la Direction générale des infrastructures communautaires (DGIC) pour financer les projets communautaires applicables liés à l'énergie.
- Possibilité pour écoÉNERGIE et la DGIC de financer conjointement de nouveaux projets de construction qui intègrent une composante d'énergie renouvelable.
- Possibilité pour écoÉNERGIE d'utiliser le personnel régional du Programme d'immobilisations et d'entretien/Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations pour fournir des conseils et une expertise pour l'élaboration de projets liés à l'énergie renouvelable.
- Possibilité d'élaborer une politique en matière d'énergie durable qui porte principalement sur la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable pour fournir de l'énergie tout en faisant la promotion de l'efficacité énergétique, ce qui permet de réduire la demande en énergie. Possibilité pour la DGIC de faire des investissements pour mettre à jour l'infrastructure existante, comme en installant des compteurs intelligents, en remplaçant les luminaires, en utilisant des minuteries, en changeant les fenêtres et les chaudières, etc.
- Aussi une occasion pour la DGIC d'encourager l'application des normes Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) et Green Globe pour les édifices comme composante d'une politique sur l'énergie durable d'AADNC.
Programme d'immobilisations et d'entretien d'AADNC et projet conjoint de l'Initiative sur les partenariats stratégiques avec Manitoba Hydro.
Domaines d'activités de programme complémentaires
Les partenaires s'efforcent de trouver la combinaison idéale de systèmes d'énergie renouvelable et de sources d'entreposage pour quatre collectivités des Premières Nations hors réseau du Manitoba. Ils ont pour objectif de compenser la consommation de diesel et de réduire les coûts de production d'énergie.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Possibilité pour écoÉNERGIE de travailler avec les intervenants du projet du Manitoba pour réaliser des évaluations semblables de la technologie qui convient le mieux dans d'autres collectivités hors réseau et de communiquer les pratiques exemplaires et les leçons tirées de l'expérience du Manitoba.
Programmes et politiques des gouvernements provinciaux et territoriaux
Domaines d'activités de programme complémentaires
Comme souligné dans la section 3.2, les gouvernements provinciaux et territoriaux font activement la promotion des projets liés à l'énergie renouvelable dans les municipalités et les collectivités des Premières Nations.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Possibilités de participer à des projets conjoints pour encourager les collectivités des Premières Nations à créer des partenariats avec des municipalités pour mettre au point des systèmes d'énergie renouvelable soutenant les collectivités des Premières Nations et du Nord pour tirer profit des programmes qui encouragent le branchement au réseau et la vente d'énergie renouvelable.
Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques d'AADNC
Domaines d'activités de programme complémentaires
Le Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques répond aux besoins financiers des collectivités autochtones qui recherchent une possibilité économique ou qui souhaitent participer à un projet de développement économique, y compris les projets liés à l'énergie renouvelable. Le programme est un regroupement de l'ancien Programme d'opportunités économiques pour les communautés et de l'initiative Grands projets et fonds d'investissement (qui finançaient tous deux des études de faisabilité pour les grands projets d'énergie renouvelable) et du Programme de développement des entreprises autochtones.
Les collectivités inuites et des Premières Nations ainsi que leurs gouvernements, y compris les conseils tribaux, sont admissibles à du financement dans le cadre du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques. Un financement est offert pour aider les collectivités à profiter de possibilités économiques et à attirer du financement du secteur privé, y compris la réalisation d'études de faisabilité. En conséquence, les collectivités branchées au réseau qui souhaitent entreprendre de grands projets liés à l'énergie renouvelable à des fins de développement économique peuvent recevoir du financement du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques pour faire des études de faisabilité. Cela recoupe le financement des études de faisabilité fournie dans le cadre du volet A du programme écoÉNERGIE.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Comme mentionné dans la section 3.2, il est recommandé que le rôle actuel du programme écoÉNERGIE en matière de financement d'études de faisabilité à grande échelle réalisées par des collectivités branchées au réseau à des fins de développement économique soit transféré au Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques dans le Secteur des terres et du développement économique d'AADNC.
Programme des services relatifs aux terres et au développement économique d'AADNC
Domaines d'activités de programme complémentaires
Une enveloppe de financement, y compris une composante de financement environnemental, est à la disposition des collectivités située sur une réserve. Le Programme des services relatifs aux terres et au développement économique affecte des fonds aux collectivités des Premières Nations et des Inuits (et aux organismes auxquels elles ont accordé un mandat) pour offrir des services de développement économique en leur nom, comme des initiatives de planification du développement économique communautaire et de renforcement des capacités ou l'élaboration de propositions. Les résultats attendus de ce programme visent à ce que les collectivités des Premières Nations et des Inuits deviennent plus autonomes et auto-suffisantes et développent une économie durable.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Il peut y avoir des possibilités de coordonner le soutien financier d'écoÉNERGIE avec la composante de financement environnemental ciblé qui soutient la formation et les études de faisabilité dans les collectivités située sur une réserve.
Conseil de l'Arctique
Domaines d'activités de programme complémentaires
Le Canada terminera sa présidence de deux ans en 2015. Travaillant en collaboration avec les sept autres pays de l'Arctique, le Conseil gère six groupes de travail qui traitent des enjeux liés à l'Arctique, comme l'environnement et les changements climatiques. Le Conseil de l'Arctique demeure le principal forum multilatéral au moyen duquel le Canada fait la promotion de sa politique étrangère dans l'Arctique et défend les intérêts du Canada dans l'Arctique à l'échelle internationaleNote de bas de page 140. Influencé par sa participation au Conseil, le Canada a annoncé la création de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique en 2015. Les propos de certains répondants portent à croire que le Conseil de l'Arctique pourrait participer plus activement au développement des énergies renouvelables dans le Nord pendant la dernière année de la présidence du Canada.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Des possibilités pour écoÉNERGIE d'aider l'équipe de soutien du Conseil de l'Arctique d'AADNC et de poursuivre les efforts pour atteindre l'objectif commun des membres du Conseil, à savoir exploiter et utiliser les ressources d'énergie renouvelable dans l'ArctiqueNote de bas de page 141.
Station canadienne de recherche dans l'Extrême Arctique (SCREA)
Domaines d'activités de programme complémentaires
L'une des principales priorités de la SCREA est de développer et promouvoir l'énergie renouvelable dans le Nord. Une des composantes du programme est un projet pilote sur des technologies liées à l'énergie renouvelable qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Dans l'avenir, le programme se concentrera sans doute principalement sur l'adaptation de technologies qui ont fait leurs preuves dans le Sud à l'environnement du Nord, avec un accent particulier sur les collectivités éloignées et hors réseau.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Possibilité de coordonner une approche de financement par étapes pour que les activités de recherche de la SCREA soient d'abord réalisées dans les collectivités ciblées, puis suivies par un programme écoÉNERGIE visant à promouvoir la mise en œuvre de la technologie ayant fait ses preuves.
Diverses possibilités de financement d'AADNC pour la planification communautaire, la planification de l'utilisation physique des terres et la planification de l'énergie
Domaines d'activités de programme complémentaires
AADNC, grâce à divers programmes (y compris le premier programme écoÉNERGIE) et les récentes initiatives de projet pilote, a financé l'élaboration de plans communautaires exhaustifs, de plans communautaires d'énergie et de plans d'utilisation physique des terres, qui définissent souvent des possibilités liées aux technologies d'énergie renouvelable dans les collectivités.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
La possibilité pour écoÉNERGIE de financer des projets communautaires sur les énergies renouvelables qui cadrent dans un plan stratégique plus large pour le développement et le bien-être de la collectivité. Les membres du personnel des bureaux régionaux qui soutiennent les initiatives de planification communautaire et les plans régionaux d'infrastructure des Premières Nations sont un bon point de départ pour repérer les collectivités impatientes de participer à des projets liés à une technologie en matière d'énergie renouvelable.
Ensemble des initiatives écoÉNERGIE de Ressources naturelles Canada :
- écoÉNERGIE sur l'efficacité énergétique pour les bâtiments,
- écoÉNERGIE sur l'efficacité énergétique pour l'industrie,
- écoÉNERGIE sur l'efficacité énergétique pour les normes et l'étiquetage de l'équipement,
- écoÉNERGIE sur l'efficacité énergétique pour les habitations,
- écoÉNERGIE sur l'efficacité énergétique pour les véhicules,
- Programme écoÉNERGIE Rénovations – Maisons,
- Initiative écoÉNERGIE sur l'innovation,
- Initiative écoÉNERGIE sur la technologie,
- écoÉNERGIE pour les biocarburants,
- écoÉNERGIE pour l'électricité renouvelable,
- Initiative des collectivités EQuilibrium,
- écoTECHNOLOGIE pour véhicules,
Domaines d'activités de programme complémentaires
Le point de définition de la séparation entre les programmes de Ressources naturelles Canada et le programme d'AADNC est que Ressources naturelles Canada finance la conception et la mise à l'essai d'une technologie n'ayant pas fait ses preuves, alors qu'AADNC finance des technologies qui ont fait leurs preuves et qui sont prêtes à être commercialisées.
Ressources naturelles Canada se concentre généralement sur les collectivités hors réserve; toutefois, des contributions sont parfois faites aux collectivités des Premières Nations. Par exemple, l'Initiative sur l'innovation a financé la recherche sur les compteurs intelligents et sur l'intégration de l'énergie solaire aux projets de microréseaux dans les collectivités autochtones. Ressources naturelles Canada a aussi financé, dans une Première Nation de la Saskatchewan, une première démonstration du genre qui combinait diverses technologies éoliennes. Le personnel des programmes de Ressources naturelles Canada et le personnel des programmes d'AADNC participent aux comités de sélection des projets pour éviter un dédoublement du financement.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Les propos des répondants ont permis de cerner des possibilités où l'expertise de Ressources naturelles Canada pourrait être mieux utilisée pour soutenir les projets d'AADNC. Par exemple, le laboratoire de l'énergie renouvelable du Centre canadien de la technologie des minéraux et de l'énergie de Ressources naturelles Canada est particulièrement bien positionné pour soutenir les collectivités afin qu'elles préparent de meilleures propositions de projet; il peut aussi procéder à des évaluations pour déterminer la technologie qui convient le mieux à leur réalité environnementale.
Recherche et développement pour la défense Canada
Domaines d'activités de programme complémentaires
Les activités de recherche et développement liées à l'énergie de Recherche et développement pour la défense Canada sont très disparates (peu de données probantes établissant une collaboration à l'extérieur du Ministère) et axées sur la sécurité; toutefois, les Forces armées canadiennes ont accru leur présence dans l'Arctique, ce qui signifie que le Ministère est de plus en plus familier avec les difficultés associées aux conditions caractéristiques des collectivités nordiques éloignées. Cela pourrait être à l'avantage des collectivités nordiques qui relèvent du mandat d'AADNC.
Voici un exemple de solution élaborée récemment par Recherche et développement pour la défense Canada : en mars 2014, les Forces armées canadiennes ont mis en place une mini centrale électrique combinant l'énergie éolienne et solaire pour alimenter l'équipement de communication. La centrale a été mise au point pour réduire la dépendance des Forces armées canadiennes à l'égard du carburant expédié, au cas où de mauvaises conditions météorologiques en rendraient l'expédition impossible. La centrale est portable et sera utilisée dans des endroits isolésNote de bas de page 142.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Possibilité pour écoÉNERGIE d'utiliser les leçons apprises des activités de recherche et de développement de technologies liées aux énergies renouvelables pour l'Arctique de Recherche et développement pour la défense Canada.
Conseil national de recherches Canada
Domaines d'activités de programme complémentaires
Le Conseil national de recherches Canada (CNRC) est la principale organisation de recherche et de technologie du gouvernement du Canada. En collaboration avec des clients et des partenaires, il fournit un soutien à l'innovation, effectue de la recherche stratégique et offre des services scientifiques et techniques. Le portefeuille Énergie, mines et environnement du CNRC propose des solutions technologiques de pointe aux secteurs canadiens des ressources et des services publics. Le portefeuille Énergie, mines et environnement du CNRC travaille en collaboration avec des clients et des intervenants le long de toute la chaîne de valeur afin de s'attaquer à des problèmes complexes au moyen d'initiatives cibléesNote de bas de page 143.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Possibilités de communication de l'information et de coordination des projets dans les collectivités nordiques au moyen du Programme de l'Arctique du CNRC, qui met au point des technologies pour assurer un développement durable ayant peu d'impact sur l'environnement du Nord, tout en augmentant la qualité de vie des résidents nordiques.
Agence canadienne de développement économique du Nord
Domaines d'activités de programme complémentaires
Les modalités du programme Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN) de l'Agence canadienne de développement économique du Nord permettent aux collectivités d'avoir accès à du financement pour étudier et construire des projets liés à l'énergie renouvelable. Les investissements dans l'énergie renouvelable ont été de 2 798 147 $, ce qui représente 3 % du financement total du programme ISDEN de 2007-2008 à 2011-2012Note de bas de page 144. Les évaluateurs ont signalé un cas où les programmes ISDEN et écoÉNERGIE finançaient la même étude de faisabilité sur l'hydroélectricité dans deux collectivités voisines. Les deux ministères n'étaient pas au courant de leurs investissements réciproques.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Il y a une possibilité pour AADNC de s'appuyer sur l'expertise du personnel du programme ISDEN de l'Agence canadienne de développement économique du Nord pour recommander des projets conjoints pour la participation d'écoÉNERGIE dans des collectivités nordiques hors réseau.
Environnement Canada
Domaines d'activités de programme complémentaires
La Section des programmes horizontaux d'Environnement Canada coordonne la participation du Ministère aux programmes de technologie du gouvernement fédéral qui sont axés sur la durabilité et l'environnement.
L'Initiative écoÉNERGIE sur l'innovation est un programme horizontal auquel participe la Direction générale des sciences et de la technologie d'Environnement Canada. Les cinq priorités du programme sont les suivantes :
- efficacité énergétique
- électricité propre et énergie renouvelable
- bioénergie
- électrification des transports
- pétrole et gaz non classiquesNote de bas de page 145
Le Programme de financement communautaire ÉcoAction est un programme de subventions et de contributions qui offre du financement aux groupes admissibles, y compris les organisations autochtones, afin d'entreprendre des projets communautaires visant la protection, la réhabilitation et la mise en valeur de l'environnement naturel et le renforcement de la capacité des collectivités à maintenir ces activités dans l'avenir. Le programme fournit annuellement environ 4,5 millions de dollars en financement et soutient environ 100 nouveaux projets chaque année. Parmi les exemples d'activités financées, il y a les projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en réduisant la consommation et en prenant des mesures pour améliorer l'efficacité énergétique des habitations; améliorer la qualité de l'eau en réduisant la quantité de pesticides ou de substances ménagères dangereuses qui se retrouvent dans les cours d'eau et les lacs; travailler pour réduire les émissions atmosphériques qui contribuent à la pollution de l'air; et restaurer et protéger l'habitat naturelNote de bas de page 146.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Possibilité de coordonner le Programme de financement communautaire ÉcoAction avec le financement de projets d'écoÉNERGIE dans les collectivités autochtones et nordiques.
PPP Canada
Domaines d'activités de programme complémentaires
Le Fonds P3 fournit du financement pour des projets d'infrastructure provinciaux, territoriaux, municipaux et des Premières Nations réalisés dans le cadre d'un partenariat public-privé. Les projets admissibles visent la construction, le renouvellement ou l'amélioration des matériaux de l'infrastructure publique dans plusieurs secteurs, y compris des projets d'énergie verte. Les projets sont généralement de grande envergure pour susciter l'intérêt secteur privé et obtenir son financement.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Possibilité pour écoÉNERGIE de mobiliser PPP Canada comme partenaire dans l'élaboration de projets choisis.
Fédération canadienne des municipalités
Domaines d'activités de programme complémentaires
Le Fonds municipal vert fournit, par l'entremise d'un processus concurrentiel d'approbation du financement, du soutien pour des projets de rénovation et de nouvelle construction axés sur l'efficacité énergétique.
Possibilités d'aller chercher d'autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats
Possibilité d'encourager les partenariats entre les collectivités autochtones et les municipalités voisines pour entreprendre des projets liés à l'énergie verte.
Annexe B : Activités de recherche universitaire connexes
La tableau suivant présente une sélection des nombreux établissements d'enseignement qui offrent des programmes menant à l'obtention d'un grade lié à l'énergie ainsi que des centres de recherche connexes dans lesquels des recherches de pointe en écotechnologies sont menées dans l'ensemble du Canada. Ces centres d'expertise pourraient être mieux utilisés par AADNC pour exploiter la recherche, les études et l'expertise existantes.
| Établissements d'enseignement | Activités de recherche liées à l'énergie renouvelable |
|---|---|
| Collège du Yukon (Territoire du Yukon) |
Le Collège du Yukon accueille le centre de recherche du Yukon, qui est financé par le gouvernement du Yukon et le programme d'innovation en climat froid de l'Agence canadienne de développement économique du Nord.Note de bas de page 147 Parmi les projets liés à l'énergie, il y a la réalisation d'un projet pilote sur une centrale hybride d'énergie solaire/diesel dans les stations nordiques éloignées dont Northwestel est propriétaire.Note de bas de page 148 |
| Université d'OttawaNote de bas de page 149 (Ontario) |
En mars 2015, l'université a tenu une conférence sur invitation seulement pour les dirigeants industriels, les représentants du gouvernement, les universitaires, les organisations sans but lucratif et les représentants des groupes autochtones ayant des intérêts dans le secteur de l'énergie. L'objectif de la conférence était d'entamer un dialogue sur l'importance de la recherche sur les écotechnologiesNote de bas de page 150. |
| Université Carleton (Ontario) | Centre de recherche sur l'énergie durable de Carleton. |
| Collège de Lethbridge (Alberta) | L'International Wind Energy Academy est un consortium de plus de vingt partenaires, dont le Collège de LethbridgeNote de bas de page 152. |
| Institut de technologie du Nord de l'Alberta (Alberta) | Les chercheurs du nouveau Northern Alberta Institute of Technology Centre for Sustainable Energy Technology du Boreal Research Institute étudient des façons de remettre en état les sites de puits de pétrole et de gaz dans le nord-ouest de l'AlbertaNote de bas de page 154. |
| Université McMaster (Québec) | L'institut McMaster d'études sur l'énergie participe actuellement à la recherche sur l'électricité solaire et éolienne, en partenariat avec Cleanfield Energy Corp. et les Centres d'excellence de l'OntarioNote de bas de page 155. |
| Le centre d'excellence de Sechelt (Colombie-Britannique) | Le centre d'excellence de Sechelt dirige une initiative de formation sur les centrales hydroélectriques des Premières Nations pour les Autochtones qui veulent travailler dans le domaine de l'énergie renouvelable. Les partenaires sont la First Nations Employment Society et Regional Power. Situé dans la centrale électrique de Sechelt Creek sur le territoire shíshálhNote de bas de page 157. |
| Université de Colombie-Britannique (Colombie-Britannique) | Les chercheurs du Clean Energy Research Centre participent à des études sur l'énergie solaire, éolienne et de la biomasseNote de bas de page 158. Le projet de démonstration et de recherche en bioénergie de l'Université de la Colombie-Britannique devrait alimenter 1 500 habitations et réduire de jusqu'à 12 % la consommation de gaz naturel de l'UniversitéNote de bas de page 159. |
| Université de Victoria (Colombie-Britannique) | Les chercheurs de l'Institute for Integrated Energy Systems s'efforcent principalement de mettre au point des solutions liées à l'énergie photovoltaïque éolienne, solaire, des vagues et des maréesNote de bas de page 160. L'Université héberge aussi le Pacific Institute for Climate Solutions. Le réseau international de chercheurs produit des publications, des articles de recherche et des recommandations stratégiques concernant l'atténuation des effets des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ciNote de bas de page 161. |
| Université du Nouveau-Brunswick (Nouveau-Brunswick) | La direction générale de la gestion de l'énergie des installations du campus de Fredericton de l'Université obtient des résidus de bois de l'industrie provinciale, ce qui a entraîné une réduction des émissions de dioxyde de carbone de jusqu'à 15 000 tonnes par annéeNote de bas de page 162. |
Annexe C : Coûts et avantages des technologies liées à l’énergie renouvelable
Extrait de la recension des écrits réalisée par la société d'experts-conseils Kishk Anaquot Health Research.
L'évaluation des coûts des technologies liées à l'énergie renouvelable est très complexe et dépend des taux d'utilisation, de l'ensemble des ressources disponibles et de la valeur de la capacité associée aux variations régionales. Parmi les variables à prendre en considération dans les décisions concernant les investissements, il y a :
- le taux d'utilisation prévue ou demande en énergie et sources d'énergie existantes quand une capacité accrue en énergie est requise;
- l'ensemble de ressources existantes ou les sources d'énergie actuelles qui pourraient être déplacées par de nouvelles sources; et
- la capacitédépend de la capacité d'un système à répondre aux demandes régionales changeantes de façon équilibrée avec un résultat qui peut suivre la demande (p. ex. technologies acheminables comme les technologies géothermiques ou de la biomasse qui ont plus de valeur que les sources plus intermittentes ou les technologies non acheminables comme l'énergie solaire et éolienne)Note de bas de page 165.
Même si les coûts moyens actualisés de l'énergie sont utiles, ils peuvent aussi être trompeurs. Ils incluent les coûts en amont ou de développement et excluent le coût du transport de l'énergie, l'intégration d'autres systèmes, les coûts environnementaux ou les subventions et crédits d'impôt qui pourraient compenser les coûts. Avec chaque transition vers une nouvelle source d'énergie, il y a aussi les coûts éludés du maintien des anciennes sources d'énergie. Autrement dit, les coûts moyens actualisés éludés des nouvelles sources d'énergie doivent être pris en considération lorsqu'on tient compte de la viabilité économique de toute technologie potentielle liée à l'énergie. Par exemple, il ne suffit pas d'examiner le coût en capital ou le coût du cycle de vie d'un système solaire sans tenir compte de la quantité d'énergie à intensité carbonique onéreuse qu'il pourrait remplacerNote de bas de page 166.
Toutes les variables sont dans un flux constant, les coûts changent selon les régions, les technologies évoluent et les prix du carburant changent;Note de bas de page 167 par conséquent, les estimations doivent être analysées prudemment. Ils ne remplacent pas les évaluations de faisabilité.Note de bas de page 168 En bref, tous les coûts sont liés au temps et à l'espace et devraient être interprétés en conséquence. La baisse importante (de 83 % dans les cinq dernières années) des systèmes photovoltaïques solaires est un exemple important.
Les coûts moyens actualisés en capital des technologies héliothermiques, éoliennes (extracôtières) et photovoltaïques sont les plus élevés, suivis de ceux des technologies hydrauliques, éoliennes (côtières), de la biomasse et géothermiques. Une fois construite, la technologie de biomasse peut être la plus coûteuse à exploiter en raison des coûts d'entretien et de fonctionnement variables liés aux sources de carburant. Par opposition, nombre de technologies liées à l'énergie renouvelable ne sont associées à fn106 de carburant (p. ex. les technologies éoliennes, solaires et géothermiques). Les figures 5 et 6 illustrent les coûts moyens actualisés en énergie prévus des technologies liées à l'énergie renouvelable pour les exploitations entrant en fonction en 2019, et la figure 7 tient compte des coûts éludés de maintenir le statu quo lorsqu'un compare les sources d'énergie renouvelable choisies au charbon. Toutes les estimations des figures 5 à 7 s'appuient sur la division de la statistique et de l'analyse indépendantes de l'United States Energy Information Administration et sont prévues pour 2019Note de bas de page 169.
Coûts moyens actualisés en capital, d'exploitation et d'entretien par technologie
d'énergie renouvelable (2012 $US/MWh )
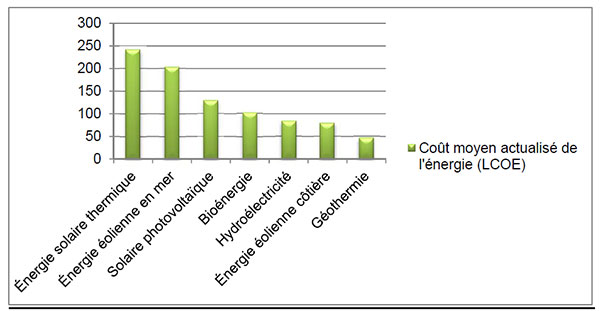
Équivalent textuel de la oûts moyens actualisés en capital, d'exploitation et d'entretien par technologie d'énergie renouvelable (2012 $US/MWh )
Sur ce graphique en barres, l’axe des ordonnées est gradué de 0 à 250 ($US/MWh ) en échelons de 50. L’axe des abscisses représente sept « technologies d’énergies renouvelables », soit, de gauche à droite, l’énergie solaire thermique, l’énergie éolienne au large, l’énergie photovoltaïque solaire, l’hydroélectricité, l’énergie éolienne sur le rivage, l’énergie biomassique et l’énergie géothermique. La légende à codes de couleur présente trois méthodes d’établissement des coûts, soit les coûts moyens actualisés en capital, les coûts fixes de fonctionnement (F) et d’entretien (E) et les coûts variables de F et E.
Seulement deux technologies comportent des « coûts variables de F et E », soit l’hydroélectricité (près de zéro sur l’axe des ordonnées) et l’énergie biomassique (presque 50 sur l’axe des ordonnées).
Toutes les technologies d’énergie renouvelable comportent des « coûts fixes de F et E », mais ils sont tous inférieurs à 50. Ces coûts sont presque nuls pour l’hydroélectricité.
La majorité des coûts de toutes les technologies d’énergies renouvelables sont des « coûts moyens actualisés en capital » (à l’exception de l’énergie biomassique dont les coûts sont presque également répartis en coûts moyens actualisés et en coûts variables de F et E). Les coûts moyens actualisés les plus élevés sont présentés à gauche de l’axe des abscisses (énergie solaire thermique) et diminuent au fur et à mesure qu’on se déplace vers la droite de l’axe des abscisses (énergie géothermique).
Total des coûts moyens actualisés du système par technologie d'énergie renouvelable (2012 $US/MWh )
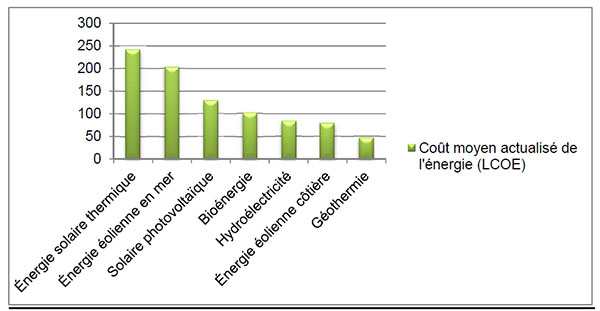
Équivalent textuel de la Total des coûts moyens actualisés du système par technologie d'énergie renouvelable (2012 $US/MWh )
Sur ce graphique en barres, l’axe des ordonnées vertical est gradué de 0 à 300 ($US/MWh ) en échelons de 50. L’axe des abscisses représente sept « technologies d’énergies renouvelables », soit, de gauche à droite, l’énergie solaire thermique, l’énergie éolienne au large, l’énergie photovoltaïque solaire, l’énergie biomassique, l’hydroélectricité, l’énergie éolienne sur le rivage et l’énergie géothermique. Seulement une variable est mesurée, soit le coût moyen actualisé de l’énergie (CMAE). Le CMAE le plus élevé revient à l’énergie solaire thermique, soit un peu moins de 250 $US/MWh . L’énergie géothermique affiche le CMAE le plus faible, soit 50 $US/MWh .
Compte tenu des coûts éludés liés au maintien de la production d'énergie par rapport au charbon, divers systèmes d'énergie renouvelable maintiennent à peu près le même classement, les technologies géothermiques, éoliennes (côtières), hydrauliques, de la biomasse, photovoltaïques et solaires étant les solutions les plus attrayantes du point de vue des coûts. En se projetant dans l'avenir pour les années 2019 et 2040, toutes les solutions attrayantes tiennent compte du fait que les coûts moyens actualisés de l'énergie seuls conservent leur classement approximatif avec la valeur exceptionnelle des systèmes géothermiques, surtout à long terme. Même si les coûts moyens actualisés éludés de l'énergie associés aux technologies liées à l'énergie renouvelable par rapport au diesel sont les plus appropriés pour cette analyse, le charbon est utilisé ici comme indicateur. La figure 7 montre la différence moyenne entre les coûts moyens actualisés de l'énergie soustraits des coûts moyens actualisés éludés de l'énergie pour diverses technologies liées à l'énergie renouvelable.
Différence moyenne entre les coûts moyens actualisés éludés d'énergie – Coûts moyens
actualisés d'énergie par technologie d'énergie renouvelable par rapport au charbon
(2012 $US/MWh) 2019 et 2040
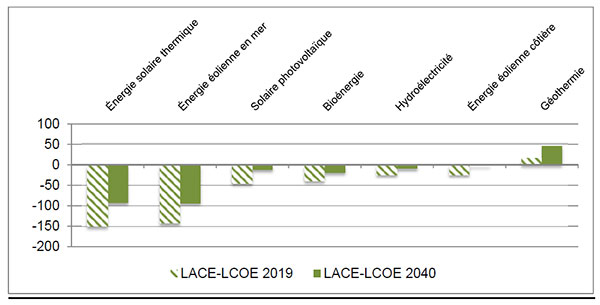
Équivalent textuel de la Différence moyenne entre les coûts moyens actualisés éludés d'énergie – Coûts moyens actualisés d'énergie par technologie d'énergie renouvelable par rapport au charbon (2012 $US/MWh ) 2019 et 2040
Ce graphique en barres comporte des nombres positifs et négatifs sur l’axe des ordonnées. La ligne du zéro se situe dans la moitié supérieure du graphique (le zéro est le troisième nombre à partir du haut de l’axe des ordonnées). Les nombres positifs de l’axe des ordonnées sont gradués de 0 à 100 et les nombres négatifs de 0 à -200. Tous les nombres augmentent ou diminuent selon des échelons de 50. L’axe des abscisses représente sept « technologies d’énergies renouvelables », soit, de gauche à droite, l’énergie solaire thermique, l’énergie éolienne au large, l’énergie photovoltaïque solaire, l’énergie biomassique, l’hydroélectricité, l’énergie éolienne sur le rivage et l’énergie géothermique.
Puisqu’il s’agit d’un graphique comparatif, une seule variable est présentée (CEMAE-CMAE) sous forme de deux barres juxtaposées (la barre de gauche pour l’année 2019 et celle de droite pour 2040).
Les six premières technologies d’énergie renouvelables représentées sur l’axe des abscisses se trouvent dans la section négative du graphique. Dans chaque cas, l’écart entre les coûts évités moyens actualisés (CEMAE) et les coûts moyens actualisés de l’énergie (CMAE) est plus important en 2019 (présenté comme la plus longue barre descendante) qu’en 2040.
La seule technologie d’énergie renouvelable représentée dans la section positive du graphique est « l’énergie géothermique ». Dans ce cas, l’écart entre les CEMAE et les CMAE en 2019 est plus faible que celui prévu en 2040.
Pour discerner le plein avantage économique de technologies choisies liées à l'énergie renouvelable, une évaluation du cycle de vie de chaque source d'énergie serait requise. Autrement dit, les répercussions « du début à la fin » (p. ex. création de l'élimination, de la mise en service et de la mise hors service) d'une technologie liée à l'énergie renouvelable de même que les répercussions liées au matériel et au flux d'énergie pendant que des opérations liées aux technologies d'énergie renouvelable sont nécessairesNote de bas de page 170. En outre, les coûts associés à la pollution de l'eau, de l'air et par le bruit, à la perte de terres agricoles, de milieux humides et de forêts primaires, aux émissions de CO2 et à la diminution de la couche d'ozone et aux ressources non renouvelables doivent aussi être pris en considération pour comprendre la proposition de valeur de la transition des combustibles fossiles vers les technologies liées à l'énergie renouvelableNote de bas de page 171.
Même si ces analyses de la situation dépassent la portée de l'examen, il peut être utile de tenir compte de certains éléments de comparaison plus accessibles comme la longévité et la capacité de divers systèmes d'énergie renouvelable. Le facteur de capacité d'un système d'énergie est essentiellement la partie de l'énergie produite par le système en fonction de sa capacité de fonctionnement complète. Aucun système n'a un facteur de capacité de 100 % parce que tous les systèmes ont des périodes d'arrêt pour les calendriers d'entretien ou les pannes, et pour certains, la disponibilité des sources d'énergie est variable (p. ex. solaire et éolien). Les systèmes hydrauliques, solaires et géothermiques semblent durer plus longtemps que d'autres systèmes d'énergie renouvelable, mais les systèmes de la biomasse et géothermiques sont associés à des facteurs de capacité plus élevée. Le tableau 9 montre la durée de vie prévue et le facteur de capacité de technologies choisies liées à l'énergie renouvelable.
| Systèmes d'énergie renouvelable | Longévité (années) | Facteur de capacité |
|---|---|---|
| Hydroélectricité | 70 | 47 % |
| Énergie éolienne | 20 | 35 % |
| Énergie solaire thermique | 20 à 40 | 25 % |
| >Énergie solaire photovoltaïque et énergie solaire thermique | 25 à 30 | 20 % |
| Bioénergie | 25 | 80 % |
| Énergie géothermique | 25 à 30 | 75 à 90 % |
Pour un examen plus complet des étapes d'expansion technologique des diverses technologies liées à l'énergie renouvelable, à la dépendance à l'égard de la disponibilité des ressources locales, à la disponibilité saisonnière et à la capacité de fournir une capacité d'énergie de base et de charge, il faut consulter les tableaux 1, 3 et 4 sur la production d'électricité au Canada par l'Association canadienne de l'électricité.
La fabrication, la construction et la mise hors service de diverses technologies liées à l'énergie renouvelable produisent divers niveaux d'émissions de GES. En mettant un accent particulier sur le dioxyde de carbone, il est évident que l'énergie solaire et géothermique a le potentiel de produire le plus de CO2 pendant leur cycle de vie, pendant que l'énergie marine, éolienne et hydraulique semble avoir le moins d'effet sur les émissions de CO2 pendant leur cycle de vie. Le tableau 10 révèle l'intensité du cycle de vie du CO2 de diverses technologies liées à l'énergie renouvelable.
| Énergie renouvelable | GES par kWh |
|---|---|
| Hydroélectricité | 4 et 14 g de CO2Note de bas de page 187 |
| Énergie éolienne | 8 à 20 g CO2 (valeurs aberrantes de 80 g CO2) |
| Énergie solaire | 30 et 80 g de CO2 |
| Énergie géothermique | <50 g CO2 pour les centrales à vapeur de vaporisation <80 g CO2 pour les projets de systèmes géothermiques enrichis |
| Énergie marine | 8 g CO2 |
| Bioénergie | 4.3.1 Il y a un vaste éventail de bilans de GES dépendant des changements apportés à l'utilisation des terres liés à la source d'énergie : la canne à sucre et les résidus de la foresterie produisent les meilleures économies de GES, mais des augmentations sont possibles quand des terres naturelles sont converties. Par exemple, les bilans négatifs de GES sont les pires pour les biocarburants produits à l'aide d'huile de palme, de soya et de maïs. La bioénergie peut réduire les GES de 80 à 90 % par rapport aux combustibles fossiles de base sur des terres de grande qualité et dans des scénarios de gestion des forêts. |
Un examen des émissions de GES produites par diverses sources d'énergie renouvelable de même que les répercussions sur l'eau et les déchets révèle que certains sont plus bénins que d'autres. L'énergie géothermique et la bioénergie ont toutes deux des effets sur les déchets. L'énergie solaire, l'énergie géothermique, l'hydroélectricité et la bioénergie ont toutes des effets sur l'utilisation de l'eau (bien qu'ils soient peu importants). Le réservoir d'une centrale hydroélectrique a des effets plus spectaculaires sur l'eau, et la conversion de la biomasse ne libère pas les utilisateurs des émissions de GES. Le tableau 11 expose les émissions de GES associées à la conversion de l'énergie, à l'utilisation de l'eau et aux répercussions sur les déchets de diverses sources d'énergie renouvelable.
| Source d'énergie renouvelable | GES provenant du processus de conversion de l'énergie | Répercussions sur l'utilisation de l'eau | Déchets |
|---|---|---|---|
| Hydroélectricité | Aucune | Changements au modèle de débit du réservoir d'une centrale hydroélectrique | Aucun |
| Cours minimal de la rivière | |||
| Énergie éolienne | Aucune | Aucune | Aucun |
| Énergie solaire | Aucune | Faible | Aucun |
| Énergie géothermique | Aucune | Faible | Oui |
| Énergie marine | Aucune | Non consommable | Aucun |
| Bioénergie | 4.3.2 Faible | 4.3.3 Faible | 4.3.4 Oui |
De la même façon, il faut s'assurer que les conséquences de l'échange du CO2 pour des composés organiques volatils, d'oxyde nitreux ou d'autres sous-produits de la nouvelle source d'énergie sont soigneusement prises en considération dans les évaluations de la faisabilité.
Enfin et surtout, il faut prendre en considération les autres conséquences environnementales de l'adoption de nouvelles sources d'énergie et technologies. La participation de la collectivité est centrale dans le processus d'adoption des technologies liées à l'énergie renouvelable de façon à ce que les répercussions des technologies liées à l'énergie renouvelable préconisées soient connues à l'avance. Le tableau 12 fournit un résumé des difficultés et des éléments à prendre en considération par source d'énergie renouvelable.
| Technologies liées à l'énergie renouvelable |
Répercussions possibles |
|---|---|
| Bioénergie (matière première réservée) | Perte d'habitats naturels de grande qualité par conversion en terres aménagées, pression sur les aires de conservation, effets sur la biodiversité agricole et la faune associés à l'intensification de l'agriculture, dégradation du sol, eutrophisation et rejets de pesticide dans les habitats aquatiques, l'introduction d'espèces envahissantes ou génétiquement modifiées |
| Bioénergie (résidus) | Le retrait de résidus peut entraîner la dégradation des sols, la perte d'habitats de débris ligneux dans les systèmes forestiers |
| Énergie solaire photovoltaïque (installations sur le terrain) | Perturbation associée aux étapes d'installation, changements communautaires au niveau de la centrale en raison des effets d'ombre |
| Énergie solaire concentrée | Perturbation d'écosystèmes désertiques fragiles |
| Énergie géothermique | Répercussions de produits chimiques dangereux en solutions saumâtres en cas d'élimination en surface, de modification des habitats dans les aires de conservation |
| Hydroélectricité (effets généraux) | Modification du littoral, des écosystèmes riverains et lénitiques, interférence avec les voies de migration du poisson, accès limité aux frayères et aux zones d'élevage, modification des charges de sédiment dans la rivière |
| Hydroélectricité (typique des réservoirs) | Perte d'habitat et de biotope spécial par l'inondation (transformation d'écosystèmes terrestres en écosystèmes aquatiques et d'écosystèmes riverains en écosystèmes lénitiques), répercussions des changements dans la composition chimique et la température de l'eau (en aval), modifications du débit saisonnier et des régimes d'inondation, extirpation des espèces indigènes/introduction d'espèces non indigènes, modification du cycle de l'eau en aval |
| Centrale marémotrice | Modification des écosystèmes marins et côtiers, changements de la turbidité et de la salinité de l'eau, mouvement des sédiments dans l'estuaire touchant la végétation, le poisson et les lieux de reproduction d'oiseaux |
| Énergie des gradients de salinité | Les eaux saumâtres usées ont des effets sur l'environnement marin et riverain local |
| Énergie thermique des mers | La remontée des eaux riches en éléments nutritifs en surface peut avoir un effet sur la vie aquatique |
| Énergie des vagues, courants marins et marées | Les aubes en rotation des turbines, le bruit, la vibration et les champs électromagnétiques peuvent avoir un effet sur les espèces sensibles (élasmobranches, mammifères marins), la perturbation des habitats pélagiques et communautés benthiques |
| Énergie éolienne sur le littoral | Perturbation des voies de migration des oiseaux, collisions mortelles d'oiseaux/de rapaces et de chauve-souris, évitement d'un secteur ou déplacement vers un autre, réduction de la reproduction |
| Énergie éolienne en mer | Les ondes acoustiques pendant la construction peuvent avoir un effet négatif sur les mammifères marins, la perturbation des habitats benthiques |
Pour un examen plus technique et plus complet des contaminants associés à des technologies liées à l'énergie renouvelable choisies, le lecteur est invité à consulter la section 3.3.4, Summary of Environmental Impacts in Price Waterhouse Coopers (2009) Alberta Environment - Assessment of Selected Renewable Energy Technology and Potential in Alberta et le tableau 2, répercussions environnementales des technologies de production d'électricité (page 17) sur la production d'électricité au Canada par l'Association canadienne de l'électricité.
Production combinée de chaleur et d'électricité
Comme la production combinée de chaleur et d'électricité est catégoriquement différente des technologies liées à l'énergie renouvelable, l'analyse de ses coûts et avantages demeure différente. La production combinée de chaleur et d'électricité est aussi connue comme étant la récupération de la chaleur résiduelle, la récupération de l'énergie et la coproduction. Essentiellement, la production combinée de chaleur et d'électricité ou la coproduction est la production simultanée de chaleur et d'électricité. La chaleur qui serait autrement perdue dans la production d'électricité est récupérée et utilisée pour le chauffage et la climatisation, le chauffage de l'eau et les processus industrielsNote de bas de page 190. La production combinée de chaleur et d'électricité est beaucoup plus écoénergétique que la production séparée d'électricité et de chaleurNote de bas de page 191.
Il est clair que l'efficacité énergétiqueNote de bas de page 192 et la conservation peuvent être des mesures rentables à prendre avant de passer aux technologies liées à l'énergie renouvelableNote de bas de page 193 Note de bas de page 194. Au lieu d'une solution plus facile à appliquer, l'efficacité énergétique a été décrite comme une solution à notre portée. Toutefois, compte tenu de la pression mondiale en faveur de la réduction des émissions de GES, les mesures d'efficacité qui maintiennent la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés peuvent être des solutions à court terme. Pris en considération en fonction du cycle de vie, les décideurs doivent tenir compte des coûts de la dépendance continue à l'égard des combustibles fossiles importés dans les systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité dont le coût augmente au fil du temps pendant que les coûts de production des technologies liées à l'énergie renouvelable sont fixés à l'avance et diminuent au fil du tempsNote de bas de page 195. La dépendance continue à l'égard des combustibles fossiles importés et l'augmentation de leurs coûts au fil du temps peut aussi avoir l'effet inattendu de décourager les activités et les possibilités et d'enfermer les collectivités du Nord dans une infrastructure obsolète avec tous les coûts environnement et sociaux concomitants associés à la dépendance au diesel (p. ex. déversements, fuites, transport, bruit, conséquences pour la santé, GES, etc.)Note de bas de page 196. Même si les mesures d'efficacité réduiront les émissions de GES, elles ne sont pas sans émissions.
Les coûts de récupération de la chaleur résiduelle dépendent en grande partie de la capacité thermique des centrales électriques où une mauvaise capacité thermique entraîne une faisabilité moindre de la production combinée de chaleur et d'électricitéNote de bas de page 197.
…, les projets liés à la chaleur résiduelle dans les Territoires du Nord-Ouest sont loin d'être rentables. Fort Liard requiert plus de 1,3 million de soutien du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, et le système d'Inuvik exigera un montant de subvention semblable pour être économiqueNote de bas de page 198. [traduction]
Malgré cela, du point de vue de l'efficacité, la production combinée de chaleur et d'électricité est attrayante et mérite un examen plus poussé par les décideurs. Environ les deux tiers de l'énergie dépensée pour produire de l'électricité à l'aide du diesel peuvent être captés sous forme de chaleur et coûte moins cher que le pétrole actuellement utilisé pour chauffer les édifices du quartier. Les entreprises d'électricité du Nunavut et plusieurs collectivités nordiques utilisent la récupération de la chaleur résiduelle même si ces systèmes sont onéreux à construire et doivent être très près des secteurs d'utilisation, même si nombre de personnes veulent que les centrales au diesel soient plus éloignées de leur habitation. L'avantage des systèmes utilisant la chaleur résiduelle est qu'ils peuvent être adaptés pour accepter la chaleur produite avec du pétrole et des sources renouvelables nécessaires aux variations inévitables de chaleur associées à la production d'électricitéNote de bas de page 199. La récupération de la chaleur résiduelle permet d'économiser 30 à 100 % des coûts de chauffageNote de bas de page 200, il n'y a pas d'émissions de GES provenant du processus de conversion de l'énergie, les répercussions sur l'eau sont faibles, et il n'y a pas de production résiduelleNote de bas de page 201.
La production combinée de chaleur et d'électricité est également générée par un certain nombre de technologies qui ont chacune leurs avantages et leurs désavantages.
Il arrive que la coproduction paraisse indiquée, c'est-à-dire préférable à la production d'électricité de remplacement indépendante et d'énergie thermique du point de vue économique et environnemental. Tel n'est toutefois pas toujours le cas, surtout dans les systèmes à ratios élevés de chaleur et d'électricité et l'efficacité modérée des systèmes ou des systèmes qui fonctionnent avec une charge partielle pendant une grande partie du tempsNote de bas de page 202. [traduction]
Le tableau 14 révèle l'écart entre plusieurs systèmes de coproduction (le lecteur est informé du fait que ce ne sont pas tous les systèmes de coproduction qui sont représentés ici, car aucune donnée n'est disponible pour tout l'éventail des systèmes dans la base de données du Centre canadien de données et d'analyse de la consommation finale d'énergie dans l'industrie).
| Système de coproduction | Production d'énergie électrique (pourcentage de combustible consommé) | Efficacité générale (%) | Ratio chaleur-électricité | Qualités thermiques |
|---|---|---|---|---|
| Turbine à vapeur à contrepression | 14 à 28 | 84 à 92 | 4-22 | Élevées |
| Turbine à vapeur à condensation | 22 à 40 | 60 à 80 | 2-10 | Élevées |
| Turbine à gaz | 24 à 42 | 70 à 85 | 1,3-2 | Élevées |
| Moteur alternatif | 33 à 53 | 75 à 85 | 0,5-2,5 | Faibles |
| Turbine à gaz à cycle combiné | 34 à 55 | 69 à 83 | 1-1,7 | Moyennes |
| Piles à combustible | 40 à 70 | 75 à 85 | 0,33-1 | Faibles à élevées |
| Microturbines | 15 à 33 | 60 à 75 | 1,3-2 | Moyennes à faibles |
En définitive, le plus grand potentiel de production combinée de chaleur et d'électricité est dans le secteur industriel, et d'autres opérations qui ont besoin d'une source d'électricité fiable et continue comme les hôpitaux, les centres de données et les universités. Les estimations de la coproduction canadienne révèlent que l'Alberta produit le plus d'énergie grâce à la production combinée de chaleur et d'électricité (49,4 %), suivie de l'Ontario (39,8 %), de la Colombie-Britannique (28,2 %), du Québec (11,2 %), de la Saskatchewan et du Manitoba (7,2 %), des provinces de l'Atlantique (6,3 %) et des territoires (0,1 %)Note de bas de page 204.
Les compétences pour installer et entretenir les systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité sont normalement fournies par le fournisseur, mais l'installation de systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité exige aussi des personnes compétentes en plomberie ou en installation d'un système de chauffage qui pourraient avoir besoin d'une formation supplémentaireNote de bas de page 205. Les coûts en capital d'un système de coproduction à l'aide d'une turbine à gaz de 50 MW pourraient être de 45 millions de dollars et prendre jusqu'à un an et demi à installer, et un système de 1 MW pourrait coûter 1,6 million selon la complexité des systèmes à l'étudeNote de bas de page 206.
Les estimations des échantillons pour des tailles de projet (< 400 KW à > 5 MW) dans un éventail de sites d'une complexité variée sont présentées dans le tableau 15). Les coûts en capital sont amortis sur une période de dix ans. Les estimations des coûts de fonctionnement et d'entretien peuvent varier grandement avec les systèmes électriques du cycle de Rankine avec des coûts d'entretien relativement faible. Toutefois, le lecteur est averti que les coûts varient selon la technologie et les conditions du site. Comme la chaleur résiduelle est récupérée, il n'y a, en théorie, aucun coût de carburant.
| Coût de l'électricité produite à l'aide de la chaleur résiduelle | |
|---|---|
| Coûts d'installation | $US/KW 2 000 $ à 4 000 $ |
| Coûts de production d'électricité à l'aide de la chaleur résiduelle | |
| Capital amorti | $/kWh 0,055 $ à 0,125 $ |
| Coûts de F et E | $/kWh 0,005 $ à 0,020 $ |
| Coût total de l'électricité | $/kWh 0,060 $ à 0,125 $ |
Comme il existe un degré élevé de variabilité entre les systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité, des renseignements détaillés concernant l'évaluation du cycle de vie, les émissions de GES pendant les phases de conversion de l'énergie, les exigences en matière de capacité pendant le fonctionnement et l'entretien et tout l'éventail des préoccupations environnementales doivent être soigneusement pris en considération à l'avenir. Comme les technologies liées à l'énergie renouvelable, la décision de soutenir la production combinée de chaleur et d'électricité est adaptée à la situation et aux besoins et devrait être prise pendant les phases de planification communautaire de l'énergie, de faisabilité préalable et de faisabilité du développement.