Évaluation de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest (Stratégie des zones protégées)
Rapport final
Date : Avril 2013
Numéro de projet : 10018
Format PDF (564 Ko, 89 pages)
Table des matières
- Liste des sigles
- Sommaire
- Réponse et plan d'action de la direction
- 1. Introduction
- 2. Méthodologie de l'évaluation
- 3. Constatations de l'évaluation - Pertinence
- 4. Constatations de l'évaluation - Conception et exécution
- 5. Constatations de l'évaluation - Rendement (efficacité/réussite)
- 6. Conclusion
- Annexe A : Diagramme du processus lié aux zones protégées
- Annexe B : Grille pour l'évaluation des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord Ouest
- Annexe C : Modèle logique du Programme
- Annexe D : Carte de la SZP-TNO
- Annexe E : Écorégions terrestres des T.N.-O
- Annexe F : Bibliographie
Liste des sigles
| AADNC |
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada |
|---|---|
| DGEMRE |
Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen |
| SZP |
Stratégie des zones protégées |
| SZP-TNO |
Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest |
| T.N.-O. |
Territoires du Nord-Ouest |
Sommaire
Portée et éléments de l'évaluation
Ce rapport présente les résultats et les recommandations de l'évaluation de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest. L'Initiative appuie la Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (SZP-TNO) et a pour but d'établir, de développer et d'exploiter jusqu'à six réserves nationales de faune fédérales et un lieu historique national, de mener des consultations et de réaliser une étude de faisabilité qui pourraient entraîner l'établissement d'une réserve de parc national (Thaidene Nene), et de faciliter la mise en valeur responsable des ressources à l'appui de la SZP-TNO. L'évaluation rend compte des résultats des exercices financiers 2008-2009 à 2011-2012 et aborde cinq questions fondamentales soulignées dans la Politique sur l'évaluation (2009) du Conseil du Trésor : la pertinence (besoin continu de la SZP-TNO, conformité aux priorités du gouvernement fédéral, harmonisation avec les rôles et responsabilités du gouvernement) et le rendement (réalisation des résultats escomptés, démonstration d'efficience et d'économie). Elle aborde aussi la conception et l'exécution, les pratiques exemplaires et les leçons apprises.
Contexte du programme
La SZP-TNO favorise et soutient la création et l'établissement d'un réseau de zones protégées dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O). Approuvée par le gouvernement du Canada et celui des T.N.-O. en 1999, elle est établie par la collectivité et pour la collectivité. Les principaux objectifs de la SZP-TNO sont de protéger : a) des zones naturelles et culturelles particulières; b) les principales zones représentatives de chaque écorégion des T.N.-O. La démarche de planification en 8 étapes de la StratégieNote de bas de page 1 et l'approche équilibrée pour l'établissement de zones protégées constituent ses grands principes directeurs.
Méthodologie d'évaluation
La méthodologie d'évaluation comportait quatre éléments d'information : a) analyse documentaire; b) examen de documents et de dossiers; c) 29 entrevues structurées auprès d'informateurs clés; d) deux études de cas avec 11 participants. Au total, 40 participants ont été interrogés, y compris des représentants d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), d'Environnement Canada, de l'Agence Parcs Canada, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, de groupes/collectivités autochtones, d'associations de l'industrie et d'entreprises de l'industrie des ressources. La disponibilité de certains participants en raison de conflits d'horaire figure parmi les limites.
Principales constatations de l'évaluation
I. Pertinence
La preuve démontre clairement le besoin continu d'un réseau de zones protégées dans les T.N.-O. Cela s'explique par : a) un intérêt accru et la multiplication des activités de développement économique et des ressources dans les T.N.-O., de même que leurs répercussions sur les Premières Nations, la faune et l'habitat; b) la façon dont l'initiative vient compléter la planification régionale de l'aménagement du territoire. La Stratégie est également conforme aux priorités du gouvernement du Canada (p. ex. la gestion des ressources, des terres et de l'environnement dans le Nord) et est dûment harmonisée avec les rôles et responsabilités du gouvernement fédéral (p. ex. responsabilités législatives et réglementaires relatives aux terres de la Couronne). Toutefois, au moment de la rédaction du rapport d'évaluation (décembre 2012-janvier 2013), il était difficile de voir comment et dans quelle mesure le transfert des responsabilitésNote de bas de page 2 concernant les terres et les ressources dans les T.N.-O. pourrait influer sur les rôles et responsabilités du gouvernement du Canada dans le cadre de la SZP-TNO.
II. Conception et exécution
La SZP-TNO est adéquatement conçue pour offrir aux intervenants l'occasion d'y participer positivement et de mettre en commun leurs intérêts et priorités, tout en développant des relations. Cela s'explique en grande partie par l'engagement en matière de communication, de collaboration et de consultation (structure de gouvernance) qui facilitera la démarche en 8 étapes nécessaire pour établir et maintenir les zones protégées. Toutefois, il reste encore d'importants défis à relever, comme la communication verticale (entre la SZP-TNO et les hauts fonctionnaires fédéraux à l'administration centrale) ainsi que l'atteinte d'un quorum lors des rencontres du Comité directeur. Il faut revoir et préciser les rôles et responsabilités du Comité directeur et du Secrétariat et favoriser une meilleure compréhension de la relation entre la SZP-TNO et la conservation des zones marines. Les rôles et responsabilités du Comité directeur devront aussi évoluer (p. ex. offrir une orientation et des conseils plus stratégiques), particulièrement en ce qui concerne la surveillance et la gestion des zones protégées.
En ce qui concerne l'exécution de la Stratégie, l'initiative offre aux intervenants des soutiens financiers, techniques, scientifiques et administratifs suffisants pour qu'ils puissent participer à la démarche de la SZP-TNO. Cependant, il importe d'améliorer les mécanismes de transfert financier, puisque ceux-ci sont imprévisibles et constituent par conséquent un fardeau administratif inutile en plus de créer de l'incertitude lors de la planification. Rien n'indique que des mécanismes de mesure du rendement ont été adoptés. L'atténuation de ces problèmes liés à l'exécution du programme permettrait d'accroître l'efficacité et l'efficience de l'initiative.
III. Rendement (efficacité, efficience et économie)
Le gouvernement du Canada n'a encore établi aucune des six réserves nationales de faune demandées. L'approbation pour l'achèvement de ces lieux a été reportée dans le processus d'autorisation. Actuellement, il n'existe qu'un seul lieu historique national (Saoyú-?ehdacho) régi par l'Agence Parcs Canada. Quant à Environnement Canada (Environnement Canada), quatre réserves nationales de faune candidates bénéficient d'un statut de protection intérimaire (Edéhzhíe, Ts'ude niline Tu'eyeta, Ka'a'gee Tu et Sambaa K'e), et une autre est en attente d'autorisation (Kwets'oòtł'àà). Selon le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats 2008, le résultat immédiat ciblé, de trois autres zones bénéficiant d'un statut de protection intérimaire en 2011 et d'un maximum de quatre autres d'ici 2013, n'a pas été atteint.
Les habitants des T.N.-O. connaissent la SZP-TNO et cette Stratégie est gérée de manière à permettre la participation des organisations et des collectivités. Comme il n'y a pas suffisamment de données pertinentes, il est difficile de déterminer s'il y a eu une sensibilisation accrue à la Stratégie chez les habitants des T.N.-O. ou une augmentation de leur capacité à participer. Parallèlement, de nombreux comités ainsi que la plupart des intervenants soutiennent davantage la SZP-TNO, et ce, de manière continue.
Enfin, les données financières et qualitatives laissent entendre que la SZP-TNO a réussi à minimiser les ressources financières et matérielles tout en maximisant les résultats. Toutefois, en se penchant sur les questions de capacité à l'échelon de la collectivité et en renvoyant le rôle du Comité directeur et les mécanismes actuels de financement, il sera possible de renforcer la capacité en ressources humaines des régions éloignées et d'améliorer les résultats.
IV. Pratiques exemplaires et leçons tirées
L'évaluation a permis de relever un certain nombre de pratiques exemplaires. Celles-ci comprennent : la participation des Autochtones dès le départ; la participation à la démarche de la SZP-TNO; la forte insistance sur les partenariats et la collaboration multipartites; les efforts importants et dynamiques en matière de communication grâce à des réunions périodiques avec le Comité directeur et le groupe de travail, à des bulletins, etc.; le recours aux connaissances traditionnelles autochtones, lesquelles facilitent la compréhension globale de la culture, de l'histoire, de l'habitat, etc.
Les données probantes révèlent de nombreuses leçons apprises : avertir rapidement les intervenants de la possibilité que la démarche en 8 étapes nécessite plus de temps que prévu; préciser les échéanciers d'autorisation ministérielle; favoriser une meilleure communication entre les hauts fonctionnaires fédéraux (administration centrale) de la SZP-TNO (p. ex. le sous-ministre adjoint et le sous-ministre); indiquer aux intervenants toutes les options de protection des terres disponibles avant d'aller de l'avant avec la Stratégie.
Recommandations
Il est recommandé que les ministères et organismes participants, en collaboration les uns avec les autres :
- abordent la question des limites de capacité à l'échelle de la collectivité en travaillant avec les partenaires communautaires concernés, afin de miser sur un savoir-faire et des capacités accrus dans la réalisation des activités de la SZP-TNO, tout en partageant les coûts associés aux évaluations et aux activités du groupe de travail;
- revoient et révisent le rôle du Comité directeur afin de veiller à ce qu'il assure une orientation stratégique, conformément à son mandat;
- de concert avec les ministères et organismes concernés, revoient les mécanismes de financement actuels afin d'assurer la prévisibilité des fonds et leur attribution opportune aux bénéficiaires; et
- adoptent une approche qui permettra de mieux comprendre la SZP-TNO et de mieux communiquer ses objectifs, en ce qui concerne le transfert de responsabilités sur les terres et les ressources.
Réponse et plan d'action de la direction
Titre du projet : Évaluation de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest : Stratégie des zones protégées (SZP-TNO)
No du projet : 1570-7/10018
1. Réponse de la direction
Jusqu'à présent, seule une des sept zones protégées a été créée de façon permanente au moyen des contributions que le gouvernement fédéral a affectées à la SZP-TNO aux termes d'un financement ciblé pour 2008-2009 et les années suivantes. Grâce à l'analyse et au processus entrepris jusqu'à maintenant avec la vaste participation des intervenants et des collectivités des Territoires du Nord-Ouest, d'ici une année ou deux, des investissements limités devraient produire des résultats supplémentaires.
Comme l'indique le rapport, d'autres mécanismes de conservation des terres comme l'aménagement du territoire ou les processus de conservation mis en œuvre par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peuvent également produire des résultats semblables à ceux visés par la SZP-TNO. De plus, il y a encore un intérêt pour la conservation à long terme des parcs et des réserves nationales de faune, et il faudrait continuer d'explorer les possibilités à cet égard au moyen du financement permanent affecté à cette initiative.
Les recommandations de l'évaluation se limitaient à des mesures qui pourraient être mises en œuvre au cours de l'année suivant l'approbation des évaluations, puisque le transfert des responsabilités se fera à la fin de cette période. Les plans d'action proposés tiendront compte de ces recommandations en vue d'améliorer les activités actuellement menées par le gouvernement fédéral dans le cadre de la SZP-TNO.
Aux termes du transfert des responsabilités, les activités menées par AADNC dans le cadre de la SZP-TNO seront, à partir du 1er avril 2014, en grande partie assumées par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Au cours de la période précédant le transfert, AADNC jouera un rôle clé afin d'assurer le bon déroulement du processus lorsque les responsabilités et les connaissances liées à la SZP-TNO, y compris celles concernant le Secrétariat de la SZP-TNO, seront transférées des responsables fédéraux à leurs homologues du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Environnement Canada continuera de contribuer à la production des rapports de groupe de travail au sujet des réserves nationales de faune candidates. Environnement Canada se chargera également de l'administration et de la surveillance de toutes les réserves nationales de faune aménagées. Compte tenu de l'analyse rigoureuse effectuée au sujet des zones protégées, du niveau de participation observé jusqu'à présent au sein des collectivités et parmi les intervenants ainsi que des commentaires suscités par cette évaluation, les prochaines activités de programme viseront à terminer la production des rapports de groupe de travail. Ensuite, les dernières étapes en vue de l'établissement des réserves nationales de faune pourront être mises en œuvre en fonction des décisions prises par le gouvernement fédéral et par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au sujet du transfert des responsabilités.
Parcs Canada continuera d'utiliser le financement permanent afin de créer et d'aménager le lieu historique national Saoyú-?ehdacho, conformément à l'entente conclue avec les Dénés et Métis du Sahtu, et de gérer le site. En ce qui concerne le projet de parc national Thaidene Nene, Parcs Canada continuera de collaborer avec d'autres ministères fédéraux, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Première Nation dénée de Lutsel K'e et la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest afin de délimiter la réserve de parc national tout en tenant compte du transfert des responsabilités. Parcs Canada financera les activités liées à l'établissement des limites définitives et à la négociation des ententes requises. Parcs Canada se penchera également sur les moyens d'obtenir les fonds nécessaires à la création, à l'aménagement et à la gestion de la réserve de parc national, puisque la SZP-TNO ne prévoit pas les fonds nécessaires pour cet aspect du projet de parc national Thaidene Nene.
2. Plan d'action
Il est recommandé que les ministères participants :
| Recommandations | Actions | Gestionnaire responsable (Titre/Secteur) | Dates de commencement et d'achèvement prévues |
|---|---|---|---|
| 1. abordent la question des limites de capacité à l'échelle de la collectivité en travaillant avec les partenaires communautaires concernés, afin de miser sur un savoir-faire et des capacités accrus dans la réalisation des activités de la SZP-TNO, tout en partageant les coûts associés aux évaluations et aux activités du groupe de travail. | Dans le contexte du transfert des responsabilités, les responsabilités jusque-là assumées par AADNC à l'égard de la mise en œuvre et du financement permanent de la SZP-TNO seront transférées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à partir du 1er avril 2014. Cependant, chacun des responsables fédéraux concernés (AADNC et Environnement Canada) continuera d'appuyer cette initiative dans les limites de son secteur de responsabilité et de son niveau de ressources actuel. | AADNC – directeur général régional des Territoires du Nord-Ouest | Date de commencement : Mars 2013 |
| Depuis avril 2013, le financement accordé par AADNC pour les activités liées à la SZP-TNO est considérablement réduit. AADNC et Environnement Canada travailleront en collaboration, dans le respect de leur mandat respectif, afin d'accroître la participation, l'expertise et le partage des coûts dans le cadre des réunions de groupe de travail auxquelles participent les membres de la collectivité, et ils veilleront à la production des rapports sur les zones candidates. | Environnement Canada – directeur régional de la région des Prairies et du Nord; gestionnaire du Service de conservation du Nord | Achèvement : Avril 2014 |
|
| 2. revoient et révisent le rôle du Comité directeur afin de veiller à ce qu'il assure une orientation stratégique pour clarifier les rôles et les responsabilités liés aux discussions en cours concernant le transfert des responsabilités et d'assurer une participation adéquate des partenaires, conformément à son mandat. | En collaboration avec Environnement Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, AADNC examinera le plan de travail et le mandat du Comité directeur d'ici au transfert des responsabilités (avril 2014). Toutes les options seront examinées, y compris l'établissement d'un nouveau rôle et d'un nouveau mandat pour le Comité directeur ou la dissolution du Comité directeur si ce dernier n'est plus jugé nécessaire. Il sera essentiel de consulter le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au sujet des changements à apporter au Comité directeur, car c'est ce gouvernement qui sera responsable du financement du Comité directeur après le transfert des responsabilités. | AADNC – directeur général régional des Territoires du Nord-Ouest Environnement Canada – directeur régional de la région des Prairies et du Nord; gestionnaire du Service de conservation du Nord |
Date de commencement : Avril 2013 |
| 1) Première discussion dans le cadre d'une réunion du Comité directeur au sujet des changements au Comité directeur proposés à la suite de l'examen de son plan de travail 2013-2014. | Achèvement : 1) Février 2013 |
||
| 2) Réunion de suivi du Comité directeur afin de discuter du rôle actuel du Comité. | 2) Mai 2013 | ||
| 3) Prise des décisions concernant l'avenir du Comité directeur et communication de celles-ci. | 3) Avril 2014 | ||
| 3. de concert avec les ministères et organismes concernés, revoient les mécanismes de financement actuels afin d'assurer la prévisibilité des fonds et leur attribution opportune aux bénéficiaires. | Date de commencement : Mars 2013 |
||
| 1) Le financement qu'AADNC consacre aux activités de la SZP pour 2013-2014 et les années suivantes est considérablement réduit, au point où il exclura probablement le financement des bénéficiaires. Lorsque les responsabilités seront transférées, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest assumera les responsabilités et le financement liés aux activités actuellement menées dans le cadre de la SZP-TNO. Conformément à la Politique sur les paiements de transfert, AADNC continuera d'assurer la prévisibilité des fonds et la prestation rapide pour les bénéficiaires. |
1) AADNC – directeur général régional des Territoires du Nord-Ouest | Achèvement : 1) Avril 2014 |
|
| 2) Dans le cas où la réserve de parc national Thaidene Nene proposée se révèle possible, et les ententes nécessaires sont convenues avec succès, Parcs Canada se penchera sur les moyens d'obtenir de nouveaux fonds à la création, à l'aménagement et à la gestion de la réserve de parc national Thaidene Nene, puisque la SZP-TNO ne prévoit pas les fonds nécessaires pour cet aspect du projet. | 2) Agence Parcs Canada – directeur, Direction de l'établissement des aires protégées | 2) Avril 2014 | |
| 4. adoptent une approche qui permettra de mieux comprendre la SZP-TNO et de mieux communiquer ses objectifs, en ce qui concerne le transfert des responsabilités sur les terres et les ressources. | Dans le contexte du transfert des pouvoirs concernant les terres et les ressources, AADNC et Environnement Canada travaillent actuellement avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin d'élaborer une approche qui facilitera la transition et permettra de mieux comprendre les activités et les objectifs liés à la SZP-TNO après le transfert des responsabilités. Voici les mesures prises jusqu'à présent : | AADNC – directeur général régional des Territoires du Nord-Ouest, avec la collaboration du directeur général, Ressources naturelles et environnement Environnement Canada – gestionnaire de la région de la capitale nationale responsable des zones protégées; Direction générale de la politique stratégique; région des Prairies et du Nord |
Date de commencement : Février 2013 |
| Achèvement : Pour l'ensemble des mesures : D'ici avril 2014 |
|||
| 1) Correspondance ministérielle entre AADNC, Environnement Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin de clarifier et d'approuver les modalités qui permettront le bon déroulement du transfert des responsabilités; et | 1) Février 2013 | ||
| 2) Participation aux réunions de groupe de travail et élaboration d'un message commun. | 2) Mars 2013 | ||
| Il y a aura d'autres communications entre Environnement Canada et AADNC d'ici au transfert des responsabilités. L'Agence Parcs Canada travaillera avec AADNC et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest sur des messages de communication communs portant sur Thaidene Nene |
Agence Parcs Canada – directeur, Direction de l'établissement des aires protégées AADNC - directeur général, Ressources naturelles et environnement |
Débuté juin 2013 |
Au nom des équipes d'évaluation des trois organisations, je recommande au Comité de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen d'AADNC d'approuver cette réponse de la direction et ce plan d'action :
Originale signée le 28 octobre 2013 par :
Michel Burrowes
Directeur, Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen, AADNC
J'approuve la réponse de la direction et le plan d'action qui précèdent.
Originale signée le 20 août 2013 par :
Janet King
SMA, Organisation des affaires du Nord, AADNC
J'approuve la réponse de la direction et le plan d'action qui précèdent.
Originale signée le 16 octobre 2013 par :
Mike Beale, Environnement Canada
SMA, Direction générale de l'intendance environnementale, Environnement Canada
J'approuve la réponse de la direction et le plan d'action qui précèdent.
Originale signée le 30 août 2013 par :
Rob Prosper
VP, Établissement et conservation des aires protégées, Parcs Canada
La réponse de la direction et le plan d'action concernant l'Évaluation de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest : Stratégie des zones protégées ont été approuvés par le Comité de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen.
1. Introduction
1.1 Aperçu
Ce rapport présente les résultats et les recommandations de l'évaluation de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest, à l'appui de la Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (SZP-TNO). L'évaluation a été menée en réponse à l'exigence faite par le Conseil du Trésor d'évaluer toutes les dépenses de programme directes, à l'exception des subventions et des contributions, tous les cinq ans (Politique sur l'évaluation du Conseil du Trésor, 2009). Dans le présent document, la SZP-TNO est aussi désignée par les termes « Programme », « Initiative » et « Stratégie ».
Cette évaluation horizontale, réalisée avec Environnement Canada, aborde les exigences énoncées dans la Politique sur l'évaluation du Conseil du Trésor 2009. Conformément à cette politique, elle passe en revue cinq questions fondamentales qui se rapportent à la SZP-TNO : la pertinence (besoin continu du programme, conformité aux priorités du gouvernement fédéral et harmonisation avec les rôles et responsabilités de ce dernier) et le rendement (réalisation des résultats escomptés et démonstration d'efficience et d'économie). L'évaluation porte aussi sur la conception et l'exécution, les pratiques exemplaires, les leçons apprises et, dans la mesure du possible, offre des solutions de rechange afin de guider l'élaboration future d'initiatives et de programmes similaires.
Le cadre de référence, élaboré pendant la phase de planification de l'évaluation, énonce la portée de l'évaluation, laquelle a été menée entre novembre 2011 et novembre 2012. La Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen (DGEMRE), en collaboration avec la Direction générale de la vérification et de l'évaluation d'Environnement Canada et Goss Gilroy Inc., a entrepris l'évaluation. Le travail a été achevé à l'interne par la DGEMRE, avec l'aide d'Environnement Canada et, dans une certaine mesure, de l'Agence Parcs Canada. Par exemple, l'analyse documentaire, l'examen de documents et de dossiers et l'élaboration de contextes pour les études de cas ont été réalisés par Goss Gilroy Inc., et des renseignements supplémentaires ont été fournis par la DGEMRE. La DGEMRE a mené la réalisation des études de cas et la plupart des entrevues auprès des informateurs clés, avec de l'aide d'Environnement Canada, et a rédigé le rapport final avec l'aide du groupe de travail d'évaluation (groupe de travail) (représentants d'Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada).
Le rapport est structuré de la façon suivante :
Section 1.0 – Introduction (y compris le profil de la SZP-TNO, les objectifs, la structure, la gestion, les intervenants, les bénéficiaires et les ressources)
Section 2.0 – Méthodologie de l'évaluation et limites
Section 3.0 – Constatations de l'évaluation relativement à la pertinence
Section 4.0 – Constatations de l'évaluation relativement à la conception et à l'exécution
Section 5.0 – Constatations de l'évaluation relativement au rendement (efficacité, efficience et économie)
Section 6.0 – Conclusions et recommandations
Section 7.0 – Annexes
1.2 Profil du programme
1.2.1 Contexte et description
Les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), et la vallée du Mackenzie (Vallée) en particulier, comptent de nombreuses nouvelles zones à protéger. La Vallée couvre un vaste territoire de forêts boréales vierges abritant une faune riche et diversifiée, dont plus de 100 espèces d'oiseaux migratoires et plusieurs espèces en péril, et contenant d'importants lieux historiques qui documentent les modes de vie et l'aménagement territorial traditionnels des Autochtones. Parallèlement, elle présente un potentiel de développement pour les ressources non renouvelables.
En 1974, le gouvernement du Canada a demandé à la Commission Berger d'étudier les répercussions sociales, environnementales et économiques du Projet gazier Mackenzie proposé, lequel devait compter parmi les plus importants projets d'infrastructure pour l'exploitation de ressources non renouvelables de l'histoire du Canada. Bien que le Projet gazier Mackenzie se limite à la production et au transport du gaz naturel depuis le delta du Mackenzie, il pourrait entraîner la mise en exploitation d'un bassin ainsi que la prospection et le développement de nouvelles ressources dans d'autres régions de la Vallée. Ainsi, des répercussions directes non désirées seraient ressenties dans 16 des écorégions des T.N.-O., et les effets à long terme du Projet gazier Mackenzie de même que des projets connexes pourraient s'étendre à l'ensemble des 42 écorégions. Le rapport de la Commission (1977) a conclu que ce pipeline constituerait un risque important pour l'environnement et n'offrirait que quelques avantages économiques à long terme aux collectivités du Nord. Plus précisément, la Commission a soulevé des préoccupations au sujet des Autochtones : elle a recommandé que le Projet gazier Mackenzie soit reporté de 10 ans et que tout développement soit précédé d'un règlement en matière de revendications territoriales et de l'établissement de zones protégées.
Des recommandations semblables ont été faites en 1996; pendant l'évaluation environnementale de la mine de diamants de la BHP proposée, le Fonds mondial pour la nature a menacé d'intenter des poursuites judiciaires contre le gouvernement fédéral à moins qu'un engagement soit pris pour élaborer une stratégie concernant les zones protégées dans les T.N.-O. S'en est suivie une collaboration entre les gouvernements fédéral et territorial, les industries, les collectivités, les organisations autochtones et les organisations non gouvernementales de l'environnement, ce qui a donné lieu à la création de la SZP-TNO en 1999.
La SZP-TNO comporte deux objectifs principaux : protéger les zones naturelles et culturelles importantes et représenter chacune des 42 écorégions des T.N.-O. La SZP-TNO prévoit un processus de mobilisation de la collectivité en 8 étapes, s'appuyant sur les meilleures connaissances disponibles sur les traditions, l'écologie, les ressources et l'économie pour la prise de décisions sur l'aménagement du territoire. Ces 8 étapes comprennent : la détermination de zones candidates; l'élaboration de propositions; diverses évaluations écologiques, sociales/culturelles, économiques et des ressources; la planification de la gestion; la protection intérimaire et définitive; la gestion, la surveillance et les activités d'application continues (voir l' annexe A).
En 2003, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (ancien nom) a demandé qu'un plan soit élaboré afin d'aborder les préoccupations soulevées concernant la possibilité que le Projet gazier Mackenzie proposé empêche la mise en place du réseau de zones protégées envisagé par la SZP-TNO dans la vallée du Mackenzie. En réponse à cette demande, le plan d'action quinquennal de la vallée du Mackenzie (Mackenzie Valley Five Year Action Plan – Conservation Planning for Pipeline Development) a été élaboré. Le plan d'action arrive après la SZP-TNO; il a pour but de désigner les zones protégées avant ou pendant la construction du pipeline.
D'ici 2008, trois zones protégées candidates (Edéhzhíe (plateau Horn), Sambaa K'e (lac Trout) et Ts'ude niline Tu'eyeta (Ramparts)) ont été proposées dans le cadre de la SZP-TNO, mais une seule, Saoyú-?ehdacho, a obtenu une protection permanente en tant que lieu historique national. Afin de suivre une approche plus équilibrée quant au développement et à la conservation, le gouvernement du Canada a décidé de réserver, dans le budget 2007, 25 millions de dollars sur cinq ans et 4 millions de dollars par année suivante pour créer ou élargir des zones protégées dans les T.N.-O., à l'appui de la Stratégie des zones protégées (SZP).
La SZP-TNO repose sur la législation actuelle. Par conséquent, seuls Environnement Canada, l'Agence Parcs Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peuvent parrainer les zones protégées. Il existe deux impératifs concernant le parrainage de zones protégées : la zone candidate doit s'inscrire dans les résultats prévus et les priorités des programmes mandatés et il doit exister une source de fonds disponibles pour permettre la poursuite des activités.
1.2.2 Objectifs/activités du programme et résultats attendus
L'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest appuie la SZP-TNO. Elle a pour objectif d'établir, de créer et d'exploiter un maximum de six réserves nationales de faune régies par Environnement Canada, ce qui comprend : la mise en place d'un lieu historique national; la réalisation d'une étude de faisabilité et de consultations pouvant mener à l'établissement d'une réserve de parc national (Thaidene Nene), lesquelles seront achevées par l'Agence Parcs Canada; l'aide au développement responsable des ressources à l'appui de la SZP-TNO. AADNC doit fournir un soutien continu (aide technique) aux parrains des zones protégées (Environnement Canada, Agence Parcs Canada et gouvernement des Territoires du Nord-Ouest). Le Ministère offre aussi un appui financier et de l'aide à la coordination au Secrétariat de la SZP, et est responsable de la gestion des terres dans les T.N.-O.
En outre, le rôle d'AADNC consiste à appuyer l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada d'aider les collectivités autochtones à satisfaire leur volonté d'une plus grande autonomie. AADNC offre ses programmes suivant les résultats stratégiques suivants : les gens; le gouvernement; les terres et l'économie; le Nord; les opérations régionales et le Bureau de l'interlocuteur fédéral. L'initiative contribue particulièrement au résultat « le Nord », lequel concerne l'utilisation durable des terres et des ressources par les Premières Nations, les Inuits et les habitants du Nord, selon des méthodes axées sur une meilleure gestion et intendance de l'environnement
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
En tant que ministère responsable de l'administration des terres de la Couronne dans le Nord, AADNC s'acquitte de plusieurs fonctions relatives à l'établissement de zones protégées dans les T.N.-O. Ces fonctions comprennent : la participation aux consultations avec les intervenants; la réalisation d'évaluations de zones candidates; la mise en place de l'inaliénabilité provisoire des terres; le transfert des terres à l'organisme responsable de la zone protégée.
En partenariat avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, AADNC assure un leadership stratégique, entre autres en appuyant le Secrétariat de la SZP-TNO, dont le personnel est composé de représentants d'AADNC et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Le Secrétariat est le point de contact pour le public et fournit un soutien (offert par AADNC) pour la coordination et le financement ainsi que de l'assistance technique et administrative aux collectivités pour la détermination de zones candidates et l'élaboration de propositions.
Environnement Canada
Selon l'initiative, le rôle d'Environnement Canada dans cette Stratégie consiste à mettre en place six réserves nationales de faune. Les réserves nationales de faune protègent des habitats importants qui soutiennent des espèces fauniques ou des écosystèmes en péril. Les lois d'Environnement Canada ont pour but d'offrir aux collectivités le type de protection permanente qu'elles souhaitent pour les zones candidates. Actuellement, Environnement Canada travaille à l'établissement de cinq réserves nationales de faune. Les trois emplacements les plus près d'atteindre le statut de protection permanente sont les suivants : Edéhzhíe, Ka'a'gee Tu et Ts'udeniline Tu'eyeta. Environnement Canada continuera également de collaborer avec les collectivités et les intervenants afin de poursuivre les efforts de planification, de manière à ce que les attentes du public relativement aux autres réserves nationales de faune puissent être satisfaites dans l'avenir.
La SZP-TNO contribue au résultat stratégique d'Environnement Canada qui vise à s'assurer que « l'environnement naturel du Canada est préservé et restauré pour les générations actuelles et futures ». Ce résultat sera atteint principalement grâce à une activité de programme : « Biodiversité – Espèces sauvages et habitat ». Pour soutenir ces efforts, Environnement Canada a établi un objectif propre à la durabilité des écosystèmes qui consiste à « élaborer et mettre en œuvre des stratégies, des programmes et des partenariats novateurs pour s'assurer que le capital naturel du Canada est préservé pour la présente génération et les générations à venir ».
Les activités d'Environnement Canada sont orientées vers :
- le travail avec les collectivités et les intervenants, afin d'achever les activités de planification de la SZP-TNO qui mèneront à l'établissement des réserves nationales de faune;
- la gestion des six réserves nationales de faune, y compris la surveillance et la prise de l'inventaire des ressources naturelles, la gestion des espèces en péril, la planification de la gestion, la conservation des ressources, l'exécution de programmes d'éducation et de sensibilisation, l'application des règlements et l'administration des zones.
Une décision du Cabinet est nécessaire pour la création d'une réserve nationale de faune. La désignation officielle à titre de réserve nationale de faune exige la modification du règlement pris en vertu de la Loi sur les espèces sauvages au Canada. Dans le cadre de ce processus, il faut mener des consultations auprès des organisations autochtones (à l'échelle communautaire et régionale) et d'autres intervenants. Un résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR), un plan de communication, un certificat de localisation des terres et des documents d'information figurent parmi les documents requis. Le ministre de l'Environnement et le Cabinet reçoivent la proposition finale, l'ébauche de plan de gestion, le REIR et l'évaluation environnementale stratégique aux fins d'examenNote de bas de page 3. Il revient au Cabinet de décider de la création d'une réserve nationale de faune et du moment de celle-ci. Le processus législatif d'établissement des réserves nationales de faune comprend aussi la publication dans la Gazette du Canada et l'ajout à la liste de l'annexe I du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages.
Agence Parcs Canada
Les lois de l'Agence Parcs Canada prévoient la création de parcs nationaux en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, de lieux historiques nationaux en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques et d'aires marines nationales de conservation en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. En vertu de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation, l'Agence Parcs Canada reçoit des fonds pour évaluer la faisabilité de la proposition de parc national Thaidene Nene (bras oriental du Grand lac des Esclaves) et pour créer et exploiter le lieu historique national Saoyú-?ehdachoNote de bas de page 4. Elle a aussi utilisé de ses propres fonds pour la protection de la réserve de parc national Nááts'ihch'oh afin de préserver le cours supérieur de la rivière Nahanni Sud – cet emplacement avait d'abord été repéré dans le cadre de la SZP-TNO.
De façon générale, conformément au cours normal de ses activités, l'Agence Parcs Canada travaille séparément d'AADNC et d'Environnement Canada pour mener l'ensemble des activités associées à ces deux zones candidates. Toutefois, ces ministères et l'Agence Parcs Canada collaborent dans le cadre des évaluations des ressources minérales, du retrait des terres et des négociations sur les revendications territoriales. L'évaluation et l'établissement de la réserve de parc national Thaidene Nene supposent une étude de faisabilité, la consultation des collectivités et la préparation de produits de communication et de promotion. Le financement relatif à cette autorisation ne vise que l'évaluation de la faisabilité de la proposition de réserve de parc national Thaidene Nene. Quant à la création et à l'exploitation du lieu historique national Saoyú?ehdacho, sept des huit étapes de la SZP ont été menées à bien, y compris le transfert des terres. Le financement de ce lieu historique national porte sur la mise sur pied et le financement d'un centre de visiteurs, l'entretien du lieu historique national et l'offre d'un appui financier à la Première Nation de Déline pour la cogestion de la zone.
Pour ce qui est des approbations concernant l'Agence Parcs Canada, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada formule des recommandations au ministre de l'Environnement au sujet des activités de commémoration des lieu historique national.
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Travaillant en étroite collaboration avec AADNC, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (par l'entremise du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles et du ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement) offre un soutien au Secrétariat de la SZP-TNO qui, à son tour, appuie les collectivités et les organismes régionaux dans la réalisation des huit étapes de la SZP-TNO (pour la protection des terres en vertu des lois territoriales (Loi sur les parcs territoriaux et Loi sur la faune)).
1.2.3 Modèle logique
Le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats et le Cadre de vérification axé sur les risques de l'initiative comportent un modèle logique. Ce Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats/Cadre de vérification axé sur les risques précise les activités, les extrants ainsi que les résultats immédiats, intermédiaires et finaux attendus. Les résultats attendus pour l'initiative, lesquels sont présentés à l'annexe C, comprennent : le soutien des intervenants et de la collectivité à l'égard des zones protégées candidates et de la protection intérimaire (immédiat); la désignation d'emplacements importants sur le plan écologique et de la protection permanente (intermédiaire); la protection d'emplacements importants sur les plans culturels et écologiques, sans compromettre le développement des ressources (long terme).
1.3 Gestion de programme, principaux intervenants et bénéficiaires
1.3.1 Gestion de programme
La SZP-TNO suppose une collaboration entre les collectivités, les organismes autochtones régionaux, les gouvernements, les groupes environnementaux et les groupes de l'industrie. Elle est dirigée par un comité directeur multipartite, lequel guide et facilite le processus de mise en œuvre dans le but d'offrir une tribune pour la mise en commun d'information et de présenter des orientations stratégiques aux ministères fédéraux et territoriaux sur la mise en œuvre de la SZP-TNO, y compris le plan d'action quinquennal de la vallée du Mackenzie. Comme il s'agit d'une initiative en milieu communautaire, les intervenants des collectivités et des régions jouent un rôle important à toutes les étapes du processus, y compris : la détermination des emplacements; l'élaboration de propositions pour d'éventuels organismes parrains; la participation aux groupes de travail sur les zones candidates ainsi qu'aux organes de gestion pour les zones établies.
La SZP-TNO bénéficie des services d'un administrateur délégué qui relève du Comité directeur et est guidé par celui-ci en ce qui concerne la mise en œuvre de la Stratégie, avec l'appui de l'équipe multipartite de la SZP-TNO. Le Comité directeur et l'administrateur délégué bénéficient du soutien du Secrétariat, assuré par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et AADNC.
Personnel et représentants du programme/SZP
- Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (Industrie, Tourisme et Investissement; Environnement et Ressources naturelles)
- Gouvernement fédéral : AADNC/Environnement Canada (bureaux régionaux et administration centrale)
- Personnel du Secrétariat de la SZP/coordonnateurs communautaires
- Administrateur délégué, SZP
Comité directeur de la SZP-TNO
Le Comité directeur est composé de 14 organismes qui guident la mise en place de la SZP-TNO. Il prodigue des conseils stratégiques aux ministres territoriaux et fédéraux quant à la meilleure façon d'établir un réseau de zones protégées à l'échelle des T.N.-O. Voici les membres du Comité directeur :
Huit groupes et gouvernements autochtones
- Gouvernement de l'Akaitcho
- Premières Nations du Deh Cho
- Conseil tribal des Gwich'in
- Société régionale inuvialuite
- Alliance des Métis de North Slave
- Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest
- Secrétariat du Sahtu
- Gouvernement thicho
Deux groupes de l'industrie
- Association canadienne des producteurs pétroliers
- Chambre des mines des T.N.-O. et du Nunavut
Deux organisations non gouvernementales de l'environnement
- Société pour la nature et les parcs du Canada, section des T.N.-O.
- Canards Illimités Canada
Gouvernements fédéral et territorial
- Gouvernement du Canada (AADNC et Environnement Canada)
- Gouvernement des T.N.-O.
Secrétariat de la SZP-TNO
Le personnel d'AADNC (administration centrale et région des T.N.-O.) est responsable de la coordination de la SZP-TNO, travaille en étroite collaboration avec ses homologues du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et a mis sur pied le Secrétariat de la SZP. Le Secrétariat est chargé de coordonner et de favoriser la coopération entre les collectivités, les organismes régionaux, les organismes responsables des revendications territoriales, les intervenants et les institutions gouvernementales. Il est également responsable de la surveillance et de la communication des progrès relativement aux engagements pris dans le cadre de la SZP et du plan d'action quinquennal de la vallée du Mackenzie.
Administrateur délégué
La SZP-TNO dispose des services d'un administrateur délégué qui appuie le Secrétariat en supervisant la mise en œuvre de la SZP-TNO et du plan d'action quinquennal de la vallée du Mackenzie, ce qui comprend la coordination et la planification des activités, la préparation d'un plan de mise en œuvre annuel ainsi que la surveillance et la communication des progrès. Le tout se fait en étroite consultation avec les membres du Secrétariat et les approbations sont obtenues auprès du Comité directeur de la SZP-TNO. L'administrateur délégué relève du Comité directeur.
1.3.2 Principaux intervenants et bénéficiaires
Les ministères et organismes du gouvernement fédéral, les autres ordres de gouvernement ainsi que d'autres entités non fédérales, publiques ou privées, et diverses organisations et personnes ont un intérêt dans la SZP-TNO :
- les ministères fédéraux (AADNC, Environnement Canada, Agence Parcs Canada)
- le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
- les groupes et les collectivités autochtones
- l'industrie
- les organisations non gouvernementales de l'environnement
Intervenants (participant directement à la SZP-TNO ou participant à la protection des terres)
- Certaines collectivités du Nord représentées dans les études de cas sur lesquelles se penchent les groupes de travail sur les zones candidatesNote de bas de page 5
- Organismes de protection des terres de la vallée du Mackenzie (p. ex. l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie)
- Conseils de l'aménagement des territoires des Gwich'in et du Sahtu
- Organisations régionales
- Société régionale inuvialuite
- Conseil tribal des Gwich'in
- Secrétariat du Sahtu
- Premières Nations du Deh Cho
- Gouvernement tłįcho
- Gouvernement de l'Akaitcho
- Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest
- Alliance des Métis de North Slave
- Représentants de l'industrie membres du Comité directeur de la SZP-TNO ou groupes de travail sur les zones candidates
- Association canadienne des producteurs pétroliers
- Chambre des mines des T.N.-O.
- Association of Mackenzie Mountain Outfitters
- Brabant Lodge
- Deghanni Lake Lodge
- Enodah Wilderness Travel
- Hay River Hunters and Trappers Association
- Société des transports du Nord Limitée
- Norwal Northern Adventures
- Rabesca's Resources Tamerlane Ventures
- True North Safaris
- Représentants des organisations non gouvernementales de l'environnement au sein du Comité directeur de la SZP-TNOou du groupe de travail sur les zones candidates
- Canards Illimités Canada
- Fonds mondial pour la nature
- Société pour la nature et les parcs du Canada, section des T.N.-O.
- Conservation de la nature Canada
- Autres organismes parrains
Bénéficiaires
La mise en œuvre de la SZP-TNO favorise l'équilibre entre la préservation des terres et le développement des ressources, et une fois terminée, elle devrait profiter à plusieurs groupes des T.N.-O. et d'ailleurs. Par exemple, la protection des sites traditionnels et des espèces sauvages aidera à préserver la culture des Premières Nations. Les avantages écologiques des zones protégées devraient aussi permettre de s'assurer que les zones pourront continuer de fournir aux Premières Nations et aux habitants du Nord de la nourriture, de l'eau douce et d'autres biens et services écologiques. De plus, les industries fondées sur les ressources naturelles bénéficieront d'une plus grande clarté concernant les terres réservées à l'exploitation des ressources. Une augmentation de l'exploitation des ressources engendrera à son tour des retombées favorables pour les Premières Nations, qui percevront des redevances, et dans l'ensemble pour les résidants du Nord, en termes d'emploi et de développement économique. De façon générale, tous les Canadiens tireront parti de la protection des diverses écorégions canadiennes.
1.4 Ressources du programme
Contributions pour promouvoir l'utilisation sécuritaire, le développement, la conservation et la protection des ressources naturelles du Nord (Autorisation de financement 334) : il s'agit de l'autorisation de financement qui a permis d'appuyer la mise en œuvre de la contribution d'AADNC à la SZP-TNO.
Afin qu'ils puissent respecter les engagements pris dans le cadre de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest, AADNC, Environnement Canada et l'Agence Parcs Canada ont eu accès à 25 millions de dollars de 2008-2009 à 2012-2013. Les dépenses de programme prévues pour chacun des trois ministères s'élèvent à 8,4 millions de dollars sur cinq ans (environ 1,7 M$ par année). Le tableau 1 ci-dessous illustre le fait que le financement est réparti de manière relativement égale pour toute la période de financement de cinq ans (période couverte par l'évaluation). Il est à noter qu'Environnement Canada recevra un financement continu considérablement accru pour mener à bien notamment ses activités continues de sensibilisation, d'administration et de surveillance des réserves de la faune.
| Dépenses – En milliers de dollars |
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | Total sur 5 ans |
Permanent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Environnement Canada | 1 310 | 1 370 | 2 230 | 1 830 | 1 780 | 8 520 | 2 900 |
| Affaires indiennes et du Nord Canada | 1 130 | 1 982 | 2 150 | 1 950 | 1 210 | 8 422 | 350 |
| Agence Parcs Canada | 1 894 | 2 056 | 1 905 | 1 189 | 1 014 | 8 058 | 750 |
| Total | 4 334 | 5 408 | 6 285 | 4 969 | 4 004 | 25 000 | 4 000 |
Le tableau suivant présente en détail les dépenses prévues des trois partenaires fédéraux des T.N.-O. au cours de la période de financement de cinq ans.
| AANDC | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | Total sur 5 ans |
Permanent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total – Salaires (y compris le fonctionnement et entretien) | 898 934 | 1 682 849 | 1 850 849 | 1 633 349 | 964 849 | 7 030 830 | 305 630 |
| Total – Subventions et contributions | 187 500 | 232 500 | 232 500 | 250 000 | 178 500 | 1 081 000 | 15 000 |
| Locaux de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 43 566 | 66 651 | 66 651 | 66 651 | 66 651 | 310 170 | 29 370 |
| Total global – AADNC | 1 130 000 | 1 982 000 | 2 150 000 | 1 950 000 | 1 210 000 | 8 422 000 | 350 000 |
| Environnement Canada | |||||||
| Total – Salaire total (y compris le fonctionnement et entretien) | 1 196 062 | 1 240 858 | 2 121 246 | 1 722 932 | 1 673 141 | 7 954 271 | 2 740 380 |
| Dépenses totales en capitaux | 45 000 | 60 000 | 105 000 | ||||
| Locaux de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 68 908 | 69 142 | 108 754 | 107 068 | 106 857 | 460 729 | 159 62 |
| Total global – Environnement Canada | 1 310 000 | 1 370 000 | 2 230 000 | 1 830 000 | 1 780 000 | 8 520 000 | 2 900 000 |
| Agence Parcs Canada | |||||||
| Total – Salaire total (y compris le fonctionnement et entretien) | 1 340 610 | 1 443 860 | 1 634 110 | 831 500 | 806 500 | 6 056 580 | 696 786 |
| Dépenses totales en capitaux | 390 000 | 398 750 | 107 500 | 357 500 | 207 500 | 1 461 250 | 53 214 |
| Total – Subventions et contributions | 150 000 | 200 000 | 150 000 | 500 000 | |||
| Locaux de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 40 170 | |||
| Total global – Agence Parcs Canada | 1 894 000 | 2 056 000 | 1 905 000 | 1 189 000 | 1 014 000 | 8 058 000 | 750 000 |
| Total des nouveaux fonds (tous les ministères) | 4 334 000 | 5 408 000 | 6 285 000 | 4 969 000 | 4 004 000 | 25 000,000 | 4 000 000 |
2. Méthodologie de l'évaluation
2.1 Portée et calendrier de l'évaluation
La portée de l'évaluation couvre les exercices financiers 2008-2009 à 2011-2012 et est centrée sur les activités, les rôles et les responsabilités du gouvernement ainsi que sur l'atteinte des résultats relativement à cette initiative. Le financement global est de 25 millions de dollars sur cinq ans (AADNC reçoit 8,4 millions de dollars pour cette même période). L'évaluation tient également compte de la nature horizontale, interministérielle/organisme de l'initiative. L'évaluation ne porte pas sur la création de parcs territoriaux et les activités liées à la faune qui sont en cours dans le cadre de la SZP générale. Le cadre de référence a été approuvé par le Comité de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen d'AADNC en novembre 2011, et des travaux sur le terrain ont été réalisés en octobre 2012.
2.1.1 Objectifs de l'évaluation
L'objectif principal est d'évaluer le rendement et la pertinence de la Stratégie conformément à la Politique sur l'évaluation du Conseil du Trésor (2009).
2.2 Problèmes et questions connexes à l'évaluation
L'évaluation de la SZP-TNO aborde les questions d'évaluation fondamentales suivantes :
Pertinence :
Point 1 : Besoin continu du programme;
Point 2 : Conformité aux priorités du gouvernement;
Point 3 : Harmonisation avec les rôles et responsabilités du gouvernement fédéral.
Rendement (efficacité, efficience et économie)
Point 4 : Réalisation des résultats escomptés (efficacité);
Point 5 : Démonstration d'efficience et d'économie.
L'évaluation tient aussi compte de la conception et de l'exécution ainsi que des solutions de rechange, des leçons apprises et des pratiques exemplaires. La conception et l'exécution sont centrées sur la mesure dans laquelle la conception du programme a contribué à l'atteinte des résultats attendus.
Questions d'évaluation
Une série de questions d'évaluation, accompagnée d'indicateurs connexes et de sources de données, a été élaborée (voir la grille d'évaluation à l'annexe B). D'autres questions ont également été rédigées. Les dix questions contenues dans le cadre d'évaluation ont été rigoureusement posées et, ensemble, ont permis d'examiner les cinq questions d'évaluation fondamentales susmentionnées.
Phase 1 – Évaluation préalable
La démarche et la méthodologie d'évaluation étaient étayées par les résultats d'une évaluation préalable, laquelle comprenait une étude des données et de la disponibilité, ainsi que par la tenue de consultations avec des intervenants des ministères et organismes fédéraux. Ensuite, un rapport de méthodologie a été produit, lequel fait état des orientations générales (p. ex. les rôles et responsabilités des ministères participants) de la deuxième phase de l'évaluation (l'exécution de l'étude d'évaluation).
Approche collaborative
L'évaluation préalable a démontré que l'initiative supposait la participation d'AADNC, d'Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada, mais que seuls AADNC et Environnement Canada s'appuyaient sur le Comité directeur de la SZP-TNO et le Secrétariat pour la coordination et la production de rapports. Le rôle de l'Agence Parcs Canada dans l'exécution/la mise en œuvre de l'initiative est très différent, car l'Agence utilise ses propres processus (qui datent d'avant l'évaluation) et, par conséquent, sa participation à l'évaluation était plus limitée. Ainsi, une évaluation horizontale avec la participation d'Environnement Canada a été jugée comme étant la démarche la plus efficace, la DGEMRE jouant le rôle de chef de l'évaluation. L'Agence Parcs Canada a été mise au courant de tous les faits nouveaux et les occasions d'échange d'information entre les ministères étaient bien accueillies.
Mesure du rendement
L'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest dispose d'un Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats et d'un Cadre de vérification axé sur les risques pour l'établissement des zones protégées fédérales dans les T.N.-O. Ces cadres ont été élaborés en mai 2008.
Phase 2 – Étude d'évaluation
Après la phase 1, l'équipe d'évaluation a peaufiné son plan de travail afin qu'il reflète les résultats de l'évaluation préalable. Les évaluateurs ont amorcé les travaux suivants :
- Élaboration d'un questionnaire détaillé avec la participation des membres du groupe de travail d'évaluation au besoin (p. ex. études de cas); ces questionnaires ont été transmis à l'avance aux participants aux entrevues, accompagnés d'une lettre de présentation de la DGEMRE leur demandant leur consentement à être interrogés.
- Planification et tenue des entrevues avec les représentants d'AADNC, d'Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada par téléphone ou en personne, dans la langue officielle choisie par la personne interrogée.
- Analyse de l'information recueillie pendant la phase 1; la phase 2 comprenait l'expression de l'importance des résultats, les conclusions et la formulation de recommandations relatives aux questions d'évaluation.
- Production d'un rapport d'évaluation provisoire et mise en commun avec Environnement Canada et l'Agence Parcs Canada (divisions de l'évaluation) ainsi qu'avec les représentants des programmes d'AADNC et d'Environnement Canada aux fins de commentaires.
- Examen du rapport provisoire en regard des commentaires reçus d'Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada (divisions de l'évaluation) et des représentants des programmes d'AADNC.
- Examen par les pairs de l'ébauche de rapport final, effectué par les évaluateurs de la DGEMRE.
- Production d'un rapport final.
Évaluation – Sources de données
Les résultats et les conclusions de l'évaluation sont fondés sur l'analyse et la validation des multiples éléments d'information suivants :
Analyse documentaire
L'objet de l'analyse documentaire était d'explorer les principales questions liées à la pertinence et au rendement de la Stratégie ainsi qu'aux leçons apprises, aux pratiques exemplaires et aux solutions de rechange. Au total, 28 sources secondaires ont été revues, y compris, sans toutefois s'y limiter, des articles spécialisés ainsi que des rapports et des publications du gouvernement.
Les représentants du programme ont relevé et fourni à l'équipe d'évaluation des documents aux fins d'examen et ont proposé de la documentation provenant de sources internationales qui pourraient s'ajouter à l'information générale pertinente. L'examen de la documentation nationale et internationale a permis d'étayer les pratiques exemplaires et d'évaluer la question de l'efficience et de l'économie. L'information a été systématiquement extraite de la documentation au moyen d'un modèle d'examen élaboré par les évaluateurs de la DGEMRE.
Examen de documents et de dossiers
Cette collecte de données avait pour but d'acquérir une solide compréhension de la SZP-TNO en vue d'aborder d'autres questions (p. ex. réussite, conception et exécution du programme). Les évaluateurs de la DGEMRE, en collaboration avec Goss Gilroy Inc., ont relevé et examiné les documents et les dossiers pertinents pendant la phase d'évaluation préalable, et ils les ont complétés pendant la phase de collecte de données. La documentation clé relative à la SZP-TNO qui a été examinée comprenait les rapports de réalisation de la SZP-TNO, les propositions, les rapports de comité, les cadres de travail, les lignes directrices, les rapports annuels, le mandat du Comité directeur et les plans stratégiques. Au total, 27 documents et dossiers ont été examinés. L'analyse de ces documents a porté sur les produits et les publications de la SZP-TNO, les partenaires, les conférences et les présentations animées par la SZP-TNO, etc.
Les documents et les dossiers examinés ont fourni de l'information générale aux évaluateurs, avant qu'ils amorcent leur travail sur le terrain, et les ont aidés à tirer des conclusions et à formuler des recommandations de manière éclairée. L'information a été systématiquement extraite de chaque document et dossier, au moyen d'un modèle d'examen élaboré par les évaluateurs de la DGEMRE.
Entrevues auprès d'informateurs clés
Les entrevues auprès d'informateurs clés ont aidé les chercheurs à mieux comprendre les perceptions et les opinions des gens qui ont joué un rôle important dans l'initiative de la SZP-TNO ou qui ont de l'expérience à cet égard. Les entrevues ont principalement été menées par des évaluateurs de la DGEMRE. Toutefois, les évaluateurs de la DGEMRE ont aidé à la tenue des entrevues auprès des dirigeants et du personnel de programme d'Environnement Canada, lesquelles étaient menées par le personnel de la Division de l'évaluation d'Environnement Canada. Des 45 informateurs clés figurant dans la première liste, 29 étaient disponibles pour des entrevues (menées entre juillet et novembre 2012).
Les entrevues ont été réalisées en personne, sauf si les participants n'étaient pas disponibles; dans ces cas particuliers, les entrevues ont eu lieu par téléphone. Les questionnaires d'entrevue ont été envoyés par courriel ou par télécopieur aux informateurs, avant l'entrevue. Lorsqu'il n'était pas possible de joindre les informateurs clés une première fois pour fixer un rendez-vous pour une entrevue, dix autres tentatives au maximum étaient faites, par téléphone, par courriel ou par télécopieur. Parmi les informateurs clés, il y avait des représentants de :
- AADNC (n=6)
- Environnement Canada (n=6)
- Agence Parcs Canada (n=2)
- Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (n=7)
- Comité directeur de la SZP-TNO (n=6)
- Organisations non gouvernementale de l'environnement (n=2)
*La liste ci-dessus n'inclut pas les représentants des Premières Nations (n=11) qui ont été interrogés dans le cadre des études de cas (voir ci-dessous); de plus, les représentants de l'industrie (n=2) ont été interrogés en tant que représentants du Comité directeur de la SZP-TNO.
Analyse
Après les entrevues, les données ont été stockées dans des fichiers MS Word individuels. La répétition d'un thème a été quantifiée, le cas échéant. L'information a été saisie de manière systématique, conformément à la grille d'évaluation et les thèmes générés ont été mis en commun par les évaluateurs. Cette façon de faire a permis d'assurer la précision des intervieweurs en ce qui concerne l'information recueillie.
Études de cas
L'objectif des études de cas était d'offrir un apport direct externe aux questions d'évaluation. Les résultats ont facilité l'interprétation et la validation des constatations et ont fourni une perspective externe sur le rapport d'évaluation. Du 22 au 26 octobre 2012, les évaluateurs d'AADNC se sont rendus dans l'une des collectivités visées par la SZP-TNO et une autre entrevue d'étude de cas a été réalisée par téléconférence le 29 octobre 2012. Le protocole de visite pour les études de cas a été utilisé pour orienter la collecte de données au sein de ces collectivités autochtones. Deux évaluateurs d'AADNC ont effectué la visite.
La sélection des études de cas se fondait sur des critères comme : la couverture géographique; des considérations budgétaires et les bénéficiaires liés aux projets. Goss Gilroy Inc. et la DGEMRE ont préparé un profil contextuel pour les études de cas, en fonction des dossiers de projet (rapports annuels, propositions) et d'autres renseignements tirés du Web. La DGEMRE (avec l'aide des agents régionaux d'AADNC) a ensuite élaboré les questions des études de cas. Les constatations préliminaires sur la conception, la mise en œuvre, les résultats, les répercussions, les leçons apprises et les défis proviennent de ces dossiers de projet. Les résultats des entrevues menées lors des visites ont étayé la description des contextes de projet ainsi que toutes les questions d'évaluation. Deux études de cas ont été réalisées, pour un total de 11 personnes interrogées.
Considérations, forces et limites
Forces
- Éléments d'information multiples
Le recours à plusieurs éléments d'information a permis de compenser la faiblesse de certaines sources d'information, par exemple, lorsque les participants refusaient de faire l'entrevue ou ne se présentaient pas. - Coordination de l'évaluation avec l'Agence Parcs Canada
Dans la mesure du possible, une partie de la collecte de données pour cette évaluation s'est faite parallèlement à l'évaluation qu'a faite l'Agence Parcs Canada de la sous-activité « création et expansion de parcs nationaux » de Parcs Canada, qui sera présentée à la réunion du comité d'évaluation de l'Agence Parcs Canada au début de 2013. L'évaluation de l'Agence Parcs Canada comprend une étude de cas sur la proposition de parc Thaidene Nene. Bien que ces deux évaluations demeurent distinctes, cette coordination a permis de réaliser des économies et de faciliter la mise en commun d'information entre les deux études.
Limites
- Disponibilité des informateurs clés interrogés
Parmi un total de 45 informateurs clés potentiels, la moitié ont refusé de participer ou n'ont simplement pas répondu à l'invitation.
Atténuation : Suivi auprès des participants aux entrevues et réalisation de certaines entrevues par téléphone. Toutefois, les intervieweurs disposaient de peu de temps pour chercher à obtenir des réponses plus approfondies et ce manque de temps les a aussi empêchés de remarquer des indices non verbaux. Un suivi a été fait auprès des individus afin d'obtenir des précisions; l'étude s'appuyait aussi sur la validation des données.
2.3 Rôles, responsabilités et assurance de la qualité
Afin d'assurer la qualité de ses évaluations (p. ex. préparation de produits d'évaluation fiables, utiles et acceptables), la DGEMRE emploie une combinaison d'outils de contrôle de la qualité, comme des groupes de travail et l'évaluation par les pairs.
Groupe de travail d'évaluation
Un groupe de travail d'évaluation, auquel participent des représentants des secteurs de programme d'Environnement Canada, de l'Agence Parcs Canada et d'AADNC, a été formé afin d'offrir des connaissances et une expertise concernant la SZP-TNO. Le mandat du groupe de travail était de prodiguer des conseils de manière continue à l'équipe d'évaluation (p. ex. rapport de méthodologie, proposition de sources de données et d'intervenants clés, commentaires sur les constatations d'évaluation, etc.).
Examen interne par les pairs
Les évaluateurs de la DGEMRE qui ne participent pas directement au projet d'évaluation ont mené des examens internes par les pairs (p. ex. vérification de la mesure dans laquelle les rapports finaux respectent le cadre de référence de l'évaluation et les rapports de méthodologie). Le travail des examinateurs est orienté par les guides d'examen par les pairs de la DGEMRE. Ces guides comprennent des questions, qui tiennent compte des normes du Conseil du Trésor relatives à la qualité des évaluations et de ses lignes directrices pour les rapports finaux.
3. Constatations de l'évaluation - Pertinence
L'évaluation a permis d'examiner le besoin continu de la SZP-TNO et la mesure dans laquelle cette stratégie est en harmonie avec les priorités actuelles d'AADNC et du gouvernement fédéral, ainsi qu'avec les rôles et responsabilités de ce dernier.
D'après les conclusions de l'évaluation, la nécessité de maintenir en place la SZP-TNO est claire, particulièrement en ce qui concerne le réseau de zones protégées dans les T.N.-O. La Stratégie est harmonisée avec les priorités et les objectifs stratégiques actuels du gouvernement du Canada, d'AADNC et d'Environnement Canada, y compris la Stratégie pour le Nord du gouvernement du Canada. L'initiative s'aligne également sur les responsabilités d'AADNC en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, laquelle favorise l'approfondissement des connaissances du Nord canadien, ainsi que ses activités de développement. En outre, le rôle du gouvernement fédéral dans la SZP-TNO est pertinent et étroitement lié à ses priorités et objectifs stratégiques, dans le respect des engagements nationaux et internationaux. Les activités de la SZP-TNO viennent de plus compléter la planification de l'aménagement du territoire régional des T.N.-O. et ne recoupent pas d'autres activités semblables réalisées dans les T.N.-O. ou offertes par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
3.1 Besoin continu
3.1.1 Est-il nécessaire d'instaurer un réseau de zones protégées dans les Territoires du Nord-Ouest?
Constatation : Un réseau de zones protégées pour les espèces sauvages et de parcs naturels est requis dans les T.N.-O. Cela est en grande partie imputable a) à un intérêt accru et la multiplication des activités sur le plan du développement économique et des ressources dans les T.N.-O. de même que les répercussions subséquentes sur les Premières Nations, la faune et l'habitat; b) à la complémentarité relativement à la planification régionale de l'aménagement du territoire.
Les T.N.-O., où se trouvent certains des stocks de ressources les plus riches et les plus diversifiés du Canada, ont suscité au cours des dernières années un intérêt accru pour le développement des ressources et l'activité économique, particulièrement dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et de l'exploitation pétrolière et gazière. Par exemple, les dépenses annuelles pour l'exploration pétrolière et gazière seulement ont plus que doublé, passant de 130 millions de dollars en 1999 à 325 millions de dollars en 2008, alors que les dépenses en capital destinées à l'extraction minière, pétrolière et gazière ont pour leur part triplé pendant cette même période, passant de 264 millions de dollars à 789 millions de dollarsNote de bas de page 6. La construction proposée du pipeline de la vallée du Mackenzie, qui s'étendrait d'Inuvik jusqu'à la frontière nord-ouest de l'Alberta, pourrait générer des revenus de 2,2 milliards de dollars par annéeNote de bas de page 7, mais présente d'importants risques pour l'environnementNote de bas de page 8. Parallèlement, les T.N.-O. abritent également des écosystèmes, une flore et une faune uniques ainsi que de nombreuses espèces en péril, y compris le caribou de Peary, la grue blanche, l'ours polaire et le carcajou, lesquels sont tous très sensibles aux changements environnementauxNote de bas de page 9.
Les entrevues auprès des informateurs clés, les études de cas, l'analyse documentaire et l'examen des documents et dossiers révèlent que l'augmentation du nombre d'activités de développement et des pressions exercées présente non seulement une véritable menace pour la durabilité future de la biodiversité des T.N.-O., mais aussi pour la préservation de la culture, des traditions et de l'histoire des Premières Nations. Par exemple, les participants aux études de cas ont soulevé la question des paysages modifiés par l'activité humaine ainsi que la diminution des populations animales et son impact sur l'environnement et la culture autochtone, tandis que l'analyse documentaire et l'examen des documents et dossiers indiquent une fragmentation effrénée des terresNote de bas de page 10 et des effets néfastes connexes sur l'habitat des plantes et des animaux. L'une des attentes de la SZP-TNO consiste à préserver l'environnement et la culture, les traditions et l'histoire des Autochtones, tout en répondant aux besoins des collectivités, de l'ensemble des Canadiens et des générations futures. Par exemple, il est prévu que la protection permanente à Saoyú-?ehdacho entraînera « [traduction] des répercussions importantes et positives pour les Sahtugot'ine, grâce à la protection des ressources culturelles, traditionnelles et éducationnellesNote de bas de page 11 ». Cela comprend la préservation et le transfert des connaissances traditionnellesNote de bas de page 12 et la préservation d'un « [traduction] rare paysage culturelNote de bas de page 13».
Les plus grandes préoccupations exprimées par les participants des Premières Nations aux entrevues et aux études de cas étaient la croissance continue et prévue du développement économique et des ressources dans les T.N.-O. ainsi que les répercussions négatives qu'elle pourrait avoir sur les modes de vie autochtones, y compris sur les activités sociales, culturelles et économiques d'importance capitale que bon nombre d'entre eux continuent de pratiquer (p. ex. la chasse, la cueillette et les pratiques médicinales). Les participants aux études de cas ont indiqué que leurs collectivités avaient déjà observé un grand nombre de ces répercussions, mais aucun n'a fourni d'exemple précis. Vu le contexte général de la Stratégie, il semble nécessaire, selon l'évaluation, d'assurer une mesure de protection environnementale ainsi qu'un écosystème durable, surtout que 51 % de la population du territoire est autochtoneNote de bas de page 14; autrement, les peuples autochtones pourraient perdre leur lien avec la terre.
Recoupement
La question du besoin continu en soulève une autre, celle du recoupement. L'évaluation a révélé que la SZP-TNO ne recoupe aucune autre mesure de protection dans les T.N.-O. La Stratégie n'est semblable qu'aux plans d'aménagement du territoire régionaux, dans la mesure où ils établissent tous deux des conditions pour contrôler l'utilisation des terres, mais ils sont différents concernant trois points particuliers :
- Durée de la protection – la planification de l'aménagement du territoire offre généralement une protection à court terme, souvent pour une période de cinq ans, après quoi le scénario de protection peut être revu et éventuellement renouvelé; la désignation de zone protégée peut offrir quant à elle une protection à long terme.
- Type de protection – la planification de l'aménagement du territoire offre une protection plus souple; les réserves nationales de faune, les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux offrent par ailleurs une protection moins souple. En vertu des lois s'appliquant à la protection à long terme, il est difficile de modifier des éléments comme les frontières ou le type d'activité permis.
- Nature complémentaire de la relation entre la SZP-TNO et la planification de l'aménagement du territoire – La SZP-TNO repère et recueille un large éventail de renseignements au sujet de zones particulières de terres destinées à la protection. La planification de l'aménagement du territoire utilise les renseignements obtenus dans le cadre de la démarche de la SZP-TNO pour faire avancer une zone dans le processus, et inversement.
Il est à noter que, bien que la planification de l'aménagement du territoire puisse être exigée dans les régions/zones en vertu d'un accord sur les revendications territoriales, la SZP-TNO offre aux collectivités n'ayant pas de revendication territoriale globale, l'occasion d'établir aussi des objectifs de conservation et de gestion des ressources. La différence a été particulièrement remarquée par les participants aux études de cas; les collectivités ne détenant pas d'accord sur les revendications territoriales globales n'auraient autrement aucun autre outil pour mener à bien les efforts de conservation envisagés. Par conséquent, l'évaluation a révélé que la SZP-TNO comble un important écart que la planification de l'aménagement du territoire régionale laisse vide, c'est-à-dire l'établissement de zones protégées dans les cas où les revendications territoriales ne sont pas réglées. Dans les régions visées par un règlement, la SZP-TNO et les plans d'aménagement du territoire régionaux constituent des processus complémentaires.
Tous les éléments d'information démontrent que les besoins suivants existent : un développement économique durable; un réseau de zones protégées pour les espèces sauvages et de parcs naturels dans les T.N.-O. (la notion de parc naturel est présentée plus en détail au point 3.2.1); la protection d'emplacements importants sur les plans écologique et culturel dans les T.N.-O., puisque la Stratégie peut être appliquée dans les régions où les revendications territoriales ne sont pas réglées, comblant ainsi l'écart laissé par les plans d'aménagement du territoire régionaux.
3.2 Conformité aux priorités du gouvernement
3.2.1 La SZP-TNO est-elle en conformité avec les priorités du gouvernement fédéral?
Constatation : La Stratégie est harmonisée avec les priorités du gouvernement du Canada ainsi qu'avec celles d'AADNC, d'Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada.
Confirmant la nécessité d'assurer un équilibre entre la protection environnementale et le développement économique dans les T.N.-O., le Bureau du vérificateur général du Canada a indiqué en 2010 que « [l]e gouvernement fédéral a des obligations précises en matière de gouvernance efficace, de protection de l'environnement et de développement des capacités, et ce, afin d'assurer le développement durable des Territoires du Nord-Ouest. S'il manque à ses obligations, des occasions de développement économique pourraient être manquées, l'environnement pourrait subir des dommages et les problèmes sociaux pourraient se multiplier dans les collectivités des Territoires du Nord-OuestNote de bas de page 15. » Bien avant la mise sur pied de la SZP-TNO en 1999, le gouvernement du Canada a indiqué que le développement durable constitue une priorité, et ce, en ratifiant de nombreux engagements internationaux et nationaux. Les engagements internationaux sont la Convention sur la diversité biologique (1992) et la Déclaration d'Inuvik (1996), et les obligations et plans nationaux comprennent le Plan vert du Canada (1990), l'Engagement formel de compléter le réseau canadien des aires protégées (1992), l'Initiative minière de Whitehorse (1994), le Groupe d'étude mixte de la conservation de l'environnement du Nord (1994), la politique des minéraux et des métaux (1996), la Politique fédérale relative aux eaux, la Stratégie canadienne de la biodiversité (1996) et l'Entente-cadre sur les eaux transfrontalières du bassin du Mackenzie (1997).
De la même manière, les gouvernements fédéral et des T.N.-O. se sont engagés à assurer une gestion et un développement durables des ressources naturelles qui suppose des engagements stratégiques visant un resserrement de la réglementation des industries qui souhaitent exploiter des ressources naturelles aux T.N.-O. Parmi ces initiatives, il y a le Plan d'action au nord du 60e parallèle (2001), la stratégie de développement durable du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (1993), la Stratégie de développement des ressources non renouvelables (1998), l'Amélioration de l'environnement opérationnel dans le Nord (2001), ainsi que le Cadre de gérance environnementale et la Stratégie de gérance des eaux des Territoires du Nord-Ouest (2010). Les études de cas, les entrevues, l'analyse documentaire et l'examen des documents et dossiers révèlent également que la SZP-TNO est conforme aux priorités des trois organismes parrains : AADNC, Environnement Canada et Agence Parcs Canada.
En outre, les participants aux entrevues et aux études de cas ont fait mention de l'importance du soutien fédéral à l'égard de l'initiative, surtout que la capacité des collectivités, de l'industrie et des autres tiers à participer au programme serait très limitée s'il en était autrement. Ils ont aussi indiqué que les collectivités n'auraient pas les moyens financiers de participer aux réunions du groupe de travail et du Secrétariat, ni au processus plus vaste de la SZP-TNO, puisque leurs ressources sont très limitées. Les participants aux entrevues ont aussi exprimé des inquiétudes quant à la capacité future des organisations non gouvernementales de l'environnement au sein de la SZP-TNO si elles ne peuvent pas compter sur un soutien fédéral, et ce, puisque leur capacité a considérablement diminué depuis la récente crise financière mondiale; ils ont cité particulièrement le retrait consécutif du soutien qui était offert à l'initiative par le Fonds mondial pour la nature.
AADNC et la SZP-TNO
La SZP-TNO sert à appuyer le mandat général d'AADNC dans le Nord. Le ministre a pour mandat, de par la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, de superviser les ressources et les activités des trois territoires du Canada. L'objectif stratégique consiste à soutenir le développement durable des ressources naturelles du Nord, tout en protégeant les écosystèmes arctiques afin que les générations futures puissent en profiter.
AADNC est responsable de gérer et d'administrer toutes les terres des T.N.-O. appartenant à la Couronne et est également tenu d'accorder l'inaliénabilité provisoire des terres et, par conséquent, joue un rôle essentiel dans la SZP-TNO. En collaboration avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le Ministère offre des ressources financières aux collectivités et contribue à la coordination des efforts visant à trouver, à évaluer et à obtenir des parrains pour les zones protégées. Par exemple, AADNC procède à des évaluations des ressources non renouvelables afin de déterminer le potentiel minéral et pétrolier des zones protégées candidates, dans le but de tirer parti des occasions futures de développement économique et de conservation.
Environnement Canada et la SZP-TNO
Le résultat stratégique d'Environnement Canada qui consiste à s'assurer que « l'environnement naturel du Canada est préservé et restauré pour les générations actuelles et futures » ainsi que le mandatNote de bas de page 16 du Service canadien de la faune indique également une harmonisation avec la SZP-TNO. En outre, Environnement Canada a des engagements à l'égard de la Stratégie ministérielle de développement durable (2012) et présente des rapports à la Convention sur la diversité biologique, à la Commission mondiale des aires protégées de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature et à l'Organisation de coopération et de développement économiques en ce qui concerne l'état des efforts de conservation au Canada.
L'Agence Parcs Canada et la SZP-TNO
Les priorités de l'Agence Parcs Canada sont aussi directement liées à la SZP-TNO. Plus particulièrement, ses lois prévoient la création de parcs nationaux (en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada) ainsi que de lieux historiques nationaux (en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques). Une évaluation entreprise par l'Agence Parcs Canada révèle que l'établissement et l'élargissement des parcs nationaux sont conformes au mandat et aux priorités de l'Agence (s'inscrivant dans la sous-activité « Création et expansion des parcs nationaux », Activité de programme 1 : Création de lieux patrimoniaux), et demeurent une priorité pour l'Agence Parcs Canada, comme le reflètent ses plans généraux. L'établissement de parcs nationaux représentatifs des 39 régions naturelles du Canada est demeuré un engagement continu depuis la publication du premier Plan de réseau des parcs nationaux au début des années 1970. La Politique sur les parcs nationaux de l'Agence Parcs Canada renforce cet engagement, particulièrement en affirmant que les efforts déployés pour établir de nouveaux parcs seront centrés sur les régions naturelles qui n'ont pas de parc national, comme les Bas-Plateaux boréaux du Nord dans les T.N.-O. (région qui sera représentée par l'établissement de la réserve de parc national Thaidene Nene).
En outre, la Loi sur l'Agence Parcs Canada (1998) indique qu'il est « dans l'intérêt national de protéger les exemples significatifs — du point de vue national — du patrimoine naturel et culturel du Canada dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux » et « d'inclure des exemples représentatifs des diverses régions naturelles terrestres et marines dans le réseau des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation ». En outre, la Loi mentionne la nécessité d'un plan à long terme pour les parcs nationaux et confirme le rôle de l'Agence Parcs Canada dans la négociation et la recommandation de l'établissement de nouveaux parcs nationaux au ministre.
3.3 Harmonisation avec les rôles et responsabilités du gouvernement fédéral
3.3.1 La SZP-TNO est-elle harmonisée avec les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral?
Constatation : Bien que la SZP-TNO ne soit pas adéquatement harmonisée avec les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral, il est difficile de savoir actuellement comment et dans quelle mesure le transfert des responsabilités pourrait influencer les rôles du gouvernement fédéral.
L'information obtenue auprès des informateurs clés et dans le cadre des études de cas, de l'analyse documentaire et de l'examen des documents et dossiers laisse entendre que les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral sont correctement harmonisés avec la SZP-TNO, à la lumière des priorités fédérales et ministérielles énoncées au point 3.2.1, et particulièrement en ce qui concerne la contribution à la réalisation des engagements environnementaux internationaux et des efforts de conservation dans les T.N.-O.
Le gouvernement du Canada est membre de l'Union internationale pour la conservation de la nature, le plus grand réseau environnemental international au monde, lequel a adopté des catégories de gestion des zones protégées pour classer les zones protégées en fonction de leurs objectifs de gestion. Les parcs nationaux du Canada s'inscrivent dans la catégorie II, Parcs nationaux, selon laquelle il s'agit d'une : « zone naturelle, terrestre et/ou marine, désignée : (a) pour protéger l'intégrité écologique dans un ou plusieurs écosystèmes pour le bien des générations actuelles et futures; (b) pour exclure toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la désignation; et (c) pour offrir des possibilités de visite, à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques, tout en respectant le milieu naturel et la culture des collectivités locales. » Selon les Lignes directrices pour les catégories de gestion des aires protégées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (1994), la propriété et la gestion de ces zones doivent normalement être assurées par la plus haute autorité compétente du pays, maintenant la compétence sur ces responsabilités. Plus récemment, les lignes directrices de l'Union internationale pour la conservation de la nature (2008) ont reconnu que la responsabilité des parcs nationaux pourrait également être dévolue à un autre ordre de gouvernement, à un conseil autochtone, à une fondation ou à une autre entité légalement constituée.
Soulignant l'importance du rôle que joue le gouvernement fédéral, les informateurs clés indiquent que l'absence de législation en matière de parrainage fédéral suppose des obstacles majeurs à la protection des terres, y compris en ce qui concerne les ressources et la réglementation financières. Autrement dit, d'après les entrevues auprès des informateurs clés, les capacités législatives locales et des collectivités régissant la SZP-TNO sont limitées. En conséquence, la responsabilité du gouvernement fédéral en matière de législation, à titre de gestionnaire des terres de la Couronne pour le bénéfice à long terme des habitants du Nord et de tous les Canadiens, s'avère importante.Parallèlement, la Stratégie vient compléter d'autres mesures de protection appliquées dans les T.N.-O. Plus particulièrement, la Stratégie accompagne les plans d'aménagement du territoire, lesquels sont présentés plus en détail au point 3.1.1. Les désignations « parc national » et « lieu historique national » de l'Agence Parcs Canada, et la désignation « refuge d'oiseaux migrateurs » du Service canadien de la faune d'Environnement Canada sont compatibles avec la SZP-TNO.
La SZP-TNO et le transfert des responsabilités
La Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien désigne AADNC en tant que ministère fédéral principal pour le Nord. Par l'entremise de l'Organisation des affaires du Nord, le Ministère est chargé d'un mandat qui comprend deux programmes distincts, d'égale importance : le Programme des affaires indiennes et inuites et le Programme des affaires du Nord. Le mandat de l'Organisation des affaires du Nord comprend : les responsabilités légales, politiques et constitutionnelles du gouvernement fédéral dans le Nord et l'administration de la plupart des terres dans le Nord (sauf celles pour lesquelles la responsabilité est dévolue aux gouvernements territoriaux ou aux Premières Nations autonomes). Les priorités de l'Organisation des affaires du Nord concernent notamment la Stratégie pour le Nord et le transfert des responsabilités. Le transfert des responsabilités consiste en un transfert des pouvoirs depuis le gouvernement du Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest négocient depuis plusieurs années la question du transfert des responsabilités. L'évaluation a révélé qu'il régnait de l'incertitude, au moment de la rédaction du rapport d'évaluation (décembre 2012-janvier 2013) en ce qui a trait au transfert des responsabilités et à sa relation avec la SZP-TNO ou son incidence sur celle-ci. Plus particulièrement, les perspectives diffèrent quant aux rôles et aux responsabilités du gouvernement fédéral et à la façon dont ceux-ci s'harmoniseront avec la SZP-TNO au moment où le transfert des responsabilités concernant les terres et les ressources entrera en vigueur dans les T.N.-O. Selon AADNC, « les ministères fédéraux ayant un rôle pancanadien à jouer pour ce qui est de la gestion des terres et des ressources comme l'Office national de l'énergie, Ressources naturelles Canada, Environnement Canada et Parcs Canada pourraient constater des changements dans la manière dont ils conduisent leurs activités dans les T.N.-O. à la suite du transfert des responsabilitésNote de bas de page 17 ».
Les informateurs clés maintiennent deux positions différentes : la première étant que a) les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral continueront d'être adéquatement harmonisés avec le programme, surtout qu'il faudra un certain temps au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour créer de meilleurs outils de protection des terres pour les zones protégées; et selon la seconde b) le rôle du gouvernement du Canada dans les revendications territoriales et la planification de l'aménagement du territoire est mis en doute, soulignant que le rôle est actuellement flou (étant centré sur le développement économique tout en favorisant la protection de l'environnement) et qu'il n'existe pas de chemin clairement défini à emprunter pour aborder la démarche de la SZP-TNO dans l'éventualité d'un transfert de responsabilités. Toutefois, il est important de mentionner que ce dernier groupe d'intervenants clés a exprimé son soutien du rôle du gouvernement du Canada concernant les efforts de conservation généraux auxquels le gouvernement du Canada s'est engagé, par exemple la Loi sur les espèces sauvages au Canada, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.
L'initiative de transfert des responsabilités aux T.N.-O. devrait permettre une dévolution des pouvoirs sur les terres et les ressources de la Couronne fédérale (publiques), y compris les droits relatifs à l'eau, du gouvernement du Canada au gouvernement des Territoires du Nord-OuestNote de bas de page 18. L'examen des documents souligne l'espérance que, à la suite du transfert des responsabilités, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest se verra transférer des pouvoirs « de type provincial » : administration des terres de la Couronne (publiques) et pouvoir sur celles-ci, y compris la gestion des ressources non renouvelables/terres, les actifs, les fonds et le personnel, l'influence sur les questions économiques/environnementales et la conservation de certains rôles sociaux/économiques résiduels. Ainsi, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest sera en mesure d'accorder des intérêts en tant que propriétaire de terres et de ressources, comme le fait actuellement le gouvernement fédéral. Par conséquent, même si sont augmentés les pouvoirs décisionnels quant à la façon dont les terres, les ressources et les cours d'eau publics sont gérés et à la façon dont l'économie est développée et l'environnement est protégé, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, les gouvernements autochtones et les habitants des T.N.-O auront plus d'occasions de travailler ensemble aux stratégies de gestion des terres et de gérance des ressources naturelles. D'après les documents du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, « [traduction] cela signifie que les décisions prises sur le développement et l'environnement refléteront davantage les besoins et les priorités du NordNote de bas de page 19 », mais au départ, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest copiera les lois et les processus fédéraux actuels afin d'assurer une transition harmonieuse.
Même s'il est important que les procédures et les politiques de programme soient à jour et complètes avant le transfert des responsabilités, l'évaluation révèle que le transfert des responsabilités constitue un enjeu important qui s'inscrit dans la sphère plus générale que constitue le gouvernement fédéral, lequel comprend d'autres ministères fédéraux. L'étude montre que l'incidence du transfert des responsabilités sur les rôles et responsabilités demeure floue. Par conséquent, la nature des responsabilités fédérales restantes au sein du gouvernement fédéral (du moins à AADNC) n'a pas encore été clairement définie et précisée par les agents d'AADNC, au bénéfice des intervenants.
4. Constatations de l'évaluation - Conception et exécution
La présente section porte sur la mesure dans laquelle la conception de l'initiative répond efficacement aux besoins auxquels elle est censée répondre (p. ex. si elle a été mise en œuvre comme prévu ou si des mesures de rendement pertinentes étaient en place pour communiquer les résultats) et sur l'analyse des renseignements sur les pratiques exemplaires et les leçons apprises.
4.1 Conception et exécution
4.1.1 L'initiative est-elle conçue pour répondre aux besoins relatifs à la création d'un réseau de zones protégées?
Constatation 1 : La Stratégie est adéquatement conçue (p. ex. structure de gouvernance) pour répondre aux besoins et aux contextes des organisations régionales et des collectivités en ce qui a trait à la création d'un réseau de zones protégées.
Les études de cas, les entrevues et l'examen des documents et des dossiers révèlent que la SZP-TNO est conçue de manière à répondre adéquatement aux besoins et aux contextes des organisations régionales et des collectivités, en grande partie à cause de sa structure de gouvernance. En ce qui concerne les besoins (notamment les intérêts, les priorités et la planification régionale de l'aménagement du territoire), les participants aux entrevues ont indiqué que les groupes de travail, tout particulièrement, ont donné aux personnes, aux collectivités et aux organisations régionales l'occasion de participer à la démarche en 8 étapes, d'exprimer leurs intérêts, leurs priorités et leurs points de vue ainsi que de développer des relations. La SZP-TNO a été spécialement conçue pour assurer l'inclusion de divers intervenants dans chaque processus, afin de permettre une prise de décisions plus éclairée et d'en arriver à une entente générale sur certaines questions.
En outre, les personnes interrogées ont aussi souligné que la SZP-TNO est bien adaptée aux différents contextes (y compris les contextes politique, législatif, écologique, économique et culturel), principalement en raison de sa souplesse d'adaptation aux zones et dimensions variées des T.N.-O. Par exemple, elles ont indiqué que la SZP-TNO peut s'appliquer dans les zones peuplées comme dans les zones non peuplées visées par des revendications territoriales et que ses processus peuvent être adaptés pour assurer une conformité avec les lois fédérales et territoriales. L'évaluation a révélé que même si la démarche en 8 étapes est appliquée de la même manière à l'échelle du territoire, le niveau de complexité connexe (p. ex. tenue de consultations) dépend du degré de certitude quant aux droits fonciers et à la priorité accordée aux intérêts des différents intervenants, comme la relation entre la conservation et le développement.
Constatation 2 : La structure de gouvernance du programme a contribué à l'atteinte des résultats, particulièrement en raison de l'engagement du Comité directeur à l'égard de la mise en commun de l'information. Toutefois, il est nécessaire de revoir et d'améliorer quatre secteurs préoccupants : 1) la clarté des rôles et des responsabilités du Comité directeur et du Secrétariat; 2) la nécessité de développer davantage la structure et le mandat du Comité directeur; 3) la nécessité de préciser l'avenir de l'initiative après le transfert des responsabilités; 4) le besoin de favoriser une compréhension accrue de la relation entre la SZP-TNO et la conservation des zones marines.
La structure de gouvernance de la SZP-TNO (8 étapes, groupe de travail, Comité directeur et Secrétariat) est conçue de manière à répondre aux besoins et aux contextes de nombreux intervenants en ce qui concerne la faune et la création de parcs et de zones protégées. Elle a également contribué à l'atteinte de résultats, en partie à cause de trois forces clés associées à la structure de gouvernance de la SZP-TNO.
D'abord, le Comité directeur s'engage clairement à faire preuve de transparence ainsi qu'à mettre en commun et à diffuser l'information. Plus particulièrement, l'analyse documentaire et l'examen des documents et des dossiers ont démontré que le Comité directeur a offert « [traduction] une tribune pour la communication entre les intervenants et le public, par la mise à jour des lignes directrices de la SZP-TNO au besoin et par l'approbation du plan de travail et du budget annuels de la SZP-TNONote de bas de page 20 ». Les entrevues auprès d'informateurs clés de même que les études de cas reprennent ces propos, mais soulignent également la valeur du Comité directeur en termes d'inclusion, ce qui comprend la communication, la participation et le développement de relations. Ensuite, les groupes de travail (généralement formés de membres de la collectivité ainsi que d'aînés et de représentants des gouvernements autochtones, fédéral et territorial, d'organisations non gouvernementales de l'environnement et de l'industrie) facilitent la diffusion et la communication de l'information parmi les intervenants, contribuant ainsi à l'atteinte d'objectifs comme « le renforcement des communications » et « le développement des capacitésNote de bas de page 21 ». Toutefois, les études de cas montrent que les groupe de travail pourraient être davantage représentatifs des Premières Nations vivant à l'intérieur des frontières de la zone protégée candidate. Enfin, les personnes interrogées ont fait état du rôle actif et vigilant du Secrétariat ainsi que de la façon dont il favorise le partage des coûts et l'atteinte d'objectifs communs.
Parallèlement, l'information obtenue auprès des personnes interrogées et l'examen des documents et dossiers laissent entendre qu'il existe trois secteurs à améliorer concernant la façon d'exécuter la SZP-TNO. Premièrement, près de la moitié des participants aux entrevues ont cité le besoin de revoir les rôles et responsabilités du Comité directeur et du Secrétariat, en raison d'une mauvaise compréhension de leurs fonctions, soulignant particulièrement le fait que le Comité directeur exécute certaines des tâches du Secrétariat. Cependant, aucune des personnes interrogées n'a fourni de détails précis sur cette question. Deuxièmement, la structure et le mandat du Comité directeur doivent évoluer en termes de gestion et de surveillance des zonesNote de bas de page 22, et le Comité directeur doit fournir une orientation et des conseils plus stratégiques afin de demeurer pertinent, surtout à la lumière du transfert imminent des responsabilités (voir la discussion sur le transfert des responsabilités au point 3.3.1). Par exemple, l'évaluation a révélé que le Comité directeur est une plateforme d'information (des personnes mettent en commun de l'information au sujet d'autres initiatives en cours) plutôt qu'un organisme offrant une orientation et des conseils stratégiques, ce qui ne colle pas à son mandat. Troisièmement, le rôle de la SZP-TNO sur le plan de la conservation des zones marines doit être mieux défini (présenté plus en détail plus loin).
La conservation des zones marines et la SZP-TNO
La SZP-TNO a pour but d'établir des réserves nationales de faune (y compris les six découlant de la présente initiative) dans 17 des 42 écorégions des T.N.-O., en partenariat avec les gouvernements respectifs, les Premières Nations et les ministères. Comme il en est question dans les documents de programme, les réserves nationales de faune sont non seulement conçues pour préserver les écosystèmes terrestres du Canada aux fins de la protection des habitats essentiels des espèces sauvages et des oiseaux migratoires, mais aussi pour préserver les écosystèmes marins et d'eau douce.
La gérance de l'eau étant perçue comme une priorité importante pour les collectivités au moment de proposer des zones à protéger, il importe d'être clair en ce qui concerne le rôle de la SZP-TNO sur le plan des aires marines de conservation et de la protection des eaux douces. Par exemple, les personnes interrogées dans le cadre des études de cas, tout particulièrement, ont dit vouloir que la SZP-TNO protège l'eau. Toutefois, il semble y avoir une confusion générale relativement à la relation entre la SZP-TNO et les aires marines de conservation et relativement à la question de savoir si les étendues d'eau à l'intérieur des zones proposées sont protégées par les réserves nationales de faune.
D'après l'Agence Parcs Canada, « les aires marines nationales de conservation divisent les océans du pays et les Grands Lacs en 29 régions marines, chacune étant un regroupement distinct de caractéristiques physiques et biologiques ». L'Agence Parcs Canada définit les aires marines de conservation comme comportant « les terres submergées, l'eau qui les recouvre et les espèces qui y habitent. Elles peuvent également comprendre les terres humides, les estuaires, les îles et d'autres terres côtièresNote de bas de page 23 ».
Le document fondateur de la SZP-TNO, A Balanced Approach to Establishing Protected Areas in the Northwest Territories (approche équilibrée pour l'établissement de zones protégées dans les Territoires du Nord-Ouest) (1999), indique que la conservation des zones terrestres et marines s'inscrit dans son cadre de travail, soulignant que les « [traduction] réserves nationales de faune offrent un outil relativement adaptable pour la protection des zones et de la faune qui y habite [et] elles peuvent être établies sur des terres canadiennes, dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales », ce qui peut comprendre n'importe quel habitat (p. ex. forêts, zones humides, montagnes, zones marines, etc.). Le document indique également ceci : « [traduction] Les institutions fédérales ayant pour mandat d'établir et de gérer des zones protégées dans des écosystèmes marins et d'eau douce travailleront en collaboration entre elles et avec les collectivités, les organismes régionaux et les organismes de revendication territoriale pour préparer des plans définissant leurs intentions d'établir des zones protégées dans les écosystèmes marins et d'eau douce des T.N.-O. »
Réitérant la position du document fondateur, le récent plan intitulé Establishment Action Plan 2010-2015: Fulfilling the Promise of the Northwest Territories Protected Areas Strategy (plan d'action d'établissement de la Stratégie des zones protégées des T.N.-O. pour 2010-2015 : remplir la promesse de la Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest), préparé par le Comité directeur de la SZP-TNO, affirme que « [traduction] la SZP a été envisagée pour contribuer à orienter l'attention sur la nécessité de créer des zones marines et d'eau douce protégées ». Le ministère des Pêches et des Océans et l'Agence Parcs Canada y sont désignés « [traduction] comme les deux parrains fédéraux ayant utilisé leurs propres processus de planification et ressources pour évaluer, établir et gérer les zones marines protégées et les aires marines de conservation ». Le plan d'action constitue un document clé, lequel s'applique à l'ensemble des T.N.-O. Il a pour but de coordonner les activités de la SZP jusqu'en mars 2015. Son objectif est le suivant : « [traduction] Améliorer la mise en œuvre de la Stratégie des zones protégées en faisant preuve de coordination et de coopération. »
Puisque les aires marines de conservation constituent un outil de préservation des zones marines et ne font pas partie de la SZP-TNO, il s'avère nécessaire d'aborder cette confusion en précisant auprès des intervenants et dans les documents sources que les engagements à l'égard des aires marines de conservation n'ont pas été précisément pris en regard des activités de programme de la SZP-TNO. De plus, bien que la SZP-TNO protège les étendues d'eau par l'entremise des réserves nationales de faune dans les zones proposées, son rôle est différent de celui des aires marines de conservation, lesquelles consistent en un outil particulier utilisé par l'Agence Parcs Canada afin d'atteindre des résultats en matière de conservation/protection. La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada confère au ministre de l'Environnement le pouvoir d'établir des zones marines nationales de conservation pour la protection et la conservation de zones marines.
L'évaluation révèle qu'aucune proposition d'aire marine de conservation n'a été faite à ce jour dans le cadre de la démarche de la SZP-TNO. Il est évident que les processus relatifs aux réserves nationales de faune et aux aires marines de conservations supposent tous des activités relatives à la gérance de l'eau. Ainsi, pour le grand public, le langage est semblable et, par conséquent, il y a risque de confusion malgré le fait que les résultats sont différents sur le plan de la conservation.
Constatation 3 : Il existe un lien étroit entre la SZP-TNO et le plan d'action quinquennal de la vallée du Mackenzie.
L'examen des documents et des dossiers illustre un lien étroit entre la SZP-TNO et le plan d'action quinquennal de la vallée du Mackenzie, lequel, à la demande du ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien, en 2003, devait aborder les préoccupations soulevées concernant la possibilité que le Projet gazier Mackenzie empêche la mise en place du réseau de zones protégées envisagé par la Stratégie. Plus particulièrement, la SZP-TNO a efficacement contribué à l'atteinte de la plupart des objectifs du plan d'action, grâce à la démarche en 8 étapesNote de bas de page 24. Actuellement, quatorze zones candidates pour le plan d'action du Projet gazier Mackenzie ont progressé dans le processus de la SZP-TNO. Bien que le Comité directeur guide et facilite le processus de mise en œuvre de l'initiative, il offre aussi une tribune pour la mise en commun d'information, prodigue des conseils aux ministres territoriaux et fédéraux sur la mise en œuvre ainsi que sur le plan d'action quinquennal de la vallée du Mackenzie.
4.2.1 Le programme est-il exécuté de manière à atteindre les résultats?
Constatation 1 : L'initiative offre aux collectivités, organismes régionaux et autres intervenants un soutien financier, technique, scientifique et administratif les aidant à participer au processus de la SZP-TNO. Cependant, il importe d'améliorer les mécanismes de transfert financier et de régler les trois questions qui gênent l'exécution : mobilisation insuffisante des intervenants, contraintes temporelles (évaluations et propositions) et retrait du soutien au programme par les collectivités.
L'initiative offre aux collectivités, aux organismes régionaux et aux autres intervenants un soutien financier, technique, scientifique et administratif pour l'élaboration de cartes, l'embauche d'aides locales sur le terrain et d'agents de liaison de la collectivité, et pour veiller à ce que les rapports (évaluation) soient rédigés dans un langage « simple ». Cependant, les participants aux entrevues et aux études de cas ont mentionné qu'il faudrait augmenter les ressources, mais ils n'ont fourni aucune explication détaillée pour indiquer en quoi ce changement serait optimal.
Le processus de transfert des fonds au programme était un point particulièrement inquiétant pour les participants aux entrevues. Les délais et la quantité de ressources financières demeurent imprévisibles et, par conséquent, cela génère un fardeau administratif inutile et crée de l'incertitude en ce qui concerne la planification.
Trois des questions les plus fréquemment soulevées parmi les participants aux entrevues et aux études de cas, lesquelles nuisent également à l'exécution, comprennent :
- Mobilisation insuffisante des intervenants : Les membres des divers groupes de travail, du Comité directeur et du Secrétariat ont d'autres engagements et priorités que la SZP-TNO, ce qui fait en sorte qu'à l'occasion, il est difficile pour ces personnes de participer activement à la Stratégie. Par exemple, le quorum de la plupart des réunions du Comité directeur n'est pas atteint et il n'y a que rarement des remplaçants.
- Contraintes temporelles : Certaines parties de la démarche en 8 étapes nécessitent plus de temps et de ressources que prévu; c'est particulièrement le cas des évaluations des ressources non renouvelables. L'atteinte du statut de protection intérimaire nécessite aussi plus de temps que prévu au départ, certaines collectivités attendant de nombreux mois, voire plus d'un an, pour obtenir ce statut.
- Retrait du soutien au programme par les collectivités : Dans un cas, une collectivité avait travaillé à l'étape 5 pour ensuite décider de se retirer de la démarche de la SZP et d'utiliser plutôt un plan d'aménagement du territoire comme mécanisme de conservation des terres; il ne faut pas oublier que d'importantes ressources ont été consacrées à la participation à la démarche de la SZP-TNO.
Constatation 2 : La structure de gouvernance de la SZP-TNO coordonne adéquatement et activement les activités à l'échelle des groupes d'intervenants, grâce à la collaboration, à la consultation et à la communication en vue de faciliter la démarche en 8 étapes. Cependant, il existe trois défis majeurs, y compris la communication verticale (entre la SZP-TNO et les hauts fonctionnaires fédéraux à l'administration centrale), la traduction et l'atteinte du quorum.
La SZP-TNO a été conçue pour inclure la collaboration, la consultation et la communication dans le but de faciliter la démarche en 8 étapes, comme le reflète son modèle logique. Par conséquent, la structure de gouvernance de l'initiative (particulièrement les groupes de travail et le Comité directeur) est conçue pour veiller à ce que les trois éléments soient correctement mis en place, dans le respect des membres du programme, du grand public et des autres intervenants. Par exemple, les groupes de travail comptent des membres de la collectivité (y compris les aînés), des représentants des gouvernements fédéral et territorial ainsi que des pourvoyeurs. Pour sa part, le Comité directeur comprend tous ces participants, plus des membres de l'industrie. Les études de cas ont révélé que les deux organes s'efforcent de faciliter et d'assurer la communication par l'entremise de traducteurs, par la mise en commun d'information avec d'autres groupes de travail et la diffusion d'information sur les sites Web, à la radio, dans les bulletins, dans les rapports annuels et d'évaluation, de même qu'en revoyant les ordres du jour et les documents des groupes une journée avant les réunions pour que les aînés soient mieux informés. Ces organes s'assurent aussi de la collaboration de tous en encourageant les groupes de travail à travailler étroitement avec les consultants et reconnaissent que le Comité directeur collabore aussi à des projets avec d'autres intervenants. De plus, ils contribuent à une consultation adéquate en veillant à ce que les consultants présentent des rapports au Comité directeur et aux groupes de travail, et à ce que les pratiques exemplaires et leçons apprises soient mises en commun entre les groupes de travail.
L'évaluation a permis de relever trois lacunes. D'abord, les participants aux entrevues ont parlé des difficultés relatives à la communication verticale entre la SZP-TNO et les hauts fonctionnaires fédéraux (administration centrale d'AADNC et d'Environnement Canada). Aussi, il y a des inquiétudes quant aux délais de communication dans les processus d'approbation, par exemple en ce qui concerne les explications des retards dans les autorisations provisoires, ce qui a gêné la progression de la démarche en 8 étapes. D'après les études de cas, il serait bénéfique que les groupes de travail puissent recourir à des services de traduction simultanée pour les personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, puisque cela permettrait d'économiser du temps.
L'évaluation a aussi révélé quelques défis importants relativement à l'efficacité du Comité directeur. Par exemple, en 2012, les membres de l'industrie ont participé une seule fois, car ils étaient d'avis que l'initiative n'offrait plus une approche équilibrée entre la conservation et le développement. Ils croyaient plutôt que la conservation avait été considérablement avantagée; quelques autres participants aux entrevues ne provenant pas de l'industrie ont indiqué la même chose. Cette tension avec les partenaires de l'industrie, ainsi que le fait que certains membres ne se présentent qu'une seule fois par année en raison de conflits d'horaire ou autre, pourrait avoir une incidence sur la difficulté d'atteindre le quorum lors des réunions du Comité directeur.
Constatation 3 : La mesure dans laquelle la démarche de la SZP-TNO est conforme aux normes d'évaluation d'Environnement Canada et aux pratiques exemplaires connues est : a) généralement inconnue, mais les évaluations sont informatives et représentent d'importantes ressources pour le programme et les collectivités; b) les évaluations permettent la réalisation de consultations pertinentes auprès de la collectivité. Toutefois, les deux aspects peuvent toujours être améliorés.
Sur le plan général, il n'est pas possible de garantir que les évaluations seront faites conformément aux normes d'Environnement Canada (p. ex. évaluations des ressources non renouvelables), puisque les évaluateurs n'ont pas été en mesure de revoir ces documents, étant donné les ressources limitées consacrées à leurs travaux. En ce qui concerne la question de savoir si les évaluations ont été menées selon une étendue et une portée adéquates, les réponses variaient selon le type d'évaluation visé. Par exemple :
- Évaluations écologiques : Les participants aux entrevues ont évoqué les normes et pratiques exemplaires d'Environnement Canada, mais l'information recueillie n'était qu'anecdotique.
- Évaluations des ressources renouvelables : Des lignes directrices sont fournies par le Comité directeur et elles sont régulièrement mises à jour. Les informateurs clés ont indiqué que même si le processus de réalisation des évaluations des ressources renouvelables n'était pas opportun, ces évaluations étaient généralement menées correctement quant à l'étendue et à la portée.
- Évaluations des ressources non renouvelables : les rapports d'évaluation sont généralement assez détaillés et conformes sur le plan de la profondeur et de la portée. Toutefois, les évaluations exigent beaucoup de ressources en temps (particulièrement si la zone est vaste) et en argent (il faut environ la moitié du budget d'AADNC pour la SZP-TNO). En outre, il existe un éventail de perspectives/controverses relatives aux évaluations des ressources non renouvelables. Par exemple, il a été observé lors des entrevues auprès des informateurs clés que l'industrie gagne un avantage quant au développement éventuel en profitant de données très précieuses qu'elle obtient sans frais. Les collectivités des Premières Nations, en revanche, aimeraient que les zones soient protégées en vertu de la SZP-TNO. Il a été souligné lors des entrevues que ces collectivités risquent de perdre la confiance qu'elles ont dans le processus, puisqu'elles ne comprennent pas (ou ont des incertitudes à cet égard) les raisons pour lesquelles les évaluations des ressources non renouvelables sont autorisées alors qu'elles ont indiqué vouloir la protection de ces zones en vertu de la SZP-TNO.
- Documentation culturelle : Elle se fait généralement à l'interne ou avec l'aide d'entrepreneurs, mais les collectivités participent au processus. La documentation culturelle n'est souvent pas accessible au public étant donné les questions de nature sensible et le fait qu'elle contient aussi de l'information sur les traditions. Il est difficile de commenter l'étendue et la portée appropriées de la documentation culturelle. Cependant, si cette documentation est partagée, elle permet, grâce à une perspective culturelle, une bonne compréhension des raisons pour lesquelles une collectivité ou un groupe souhaite protéger ou non une zone donnée.
- Évaluations socioéconomiques : elles sont toujours prises en considération, mais il y a à l'occasion des problèmes relatifs à la qualité du rapport (p. ex. chiffres et statistiques sans source). De plus, les rapports sont très techniques et souvent inutiles pour les collectivités ou inutilisables par celles-ci. Parallèlement, il est parfois difficile de recueillir l'information nécessaire à cause du manque d'entrepreneurs disponibles ou qualifiés. Quant à la question de savoir si les évaluations socioéconomiques sont faites selon une étendue et une portée adéquates, une seule personne a répondu par l'affirmative.
Constatation 4 : L'exécution s'est avérée lente à ce jour, puisque la mise en œuvre de la Stratégie a permis l'établissement d'un seul des sept emplacements prévus. Les systèmes de mesure du rendement de la SZP-TNO et ses programmes de surveillance et de gestion adaptative demeurent ambigus.
À ce jour, une seule zone protégée a été établie en vertu de la SZP-TNO (Saoyú-?ehdacho), par rapport à six emplacements envisagés au départ. L'information obtenue à partir des études de cas indique toutefois que les réserves nationales de faune candidates (p. ex. Ka'a'gee Tu et Kwets'ootl'aa) pourraient terminer la démarche en 8 étapes en moins d'un an.
Plusieurs facteurs ont créé des retards et ont eu une incidence sur l'exécution du programme. Les participants aux études de cas et aux entrevues auprès des informateurs clés ont indiqué que les retards s'expliquent comme suit : la complexité de la démarche en 8 étapes et la mesure dans laquelle elle dépend de la participation de nombreuses parties; la quantité importante des ressources nécessaires, particulièrement pour les discussions sur les droits d'exploitation du sol avec AADNC, lesquelles nécessitent de deux à trois ans; le temps de consultation requis pour déterminer la taille des zones candidates avec les intervenants; le long processus d'évaluation des ressources; en ce qui concerne les évaluations, la difficulté de communication entre la SZP-TNO et les hauts fonctionnaires fédéraux. De façon plus générale, les participants internes et externes aux entrevues ont souligné le fait que le nombre de zones protégées est inférieur à ce qui était prévu, étant donné que l'achèvement de ces lieux a été reporté au sein des principaux groupes de décision. Plusieurs personnes interrogées ont notamment mentionné que, même si les bonnes étapes ont été suivies pour déterminer les lieux candidats, aucune décision n'avait encore été prise. De plus, la raison donnée pour justifier les délais n'avait pas été précisée ni communiquée au personnel de la SZP-TNO ni aux intervenants.
La mesure et la communication du rendement consistent en une activité de programme distincte qui n'a pas été mise en place comme prévu. Un informateur clé travaillant étroitement au dossier de la SZP-TNO a indiqué qu'il n'existait aucun système de mesure du rendement ni aucun programme de surveillance et de gestion adaptativeNote de bas de page 25 en lien avec l'initiative. L'examen des documents a également révélé que ces questions n'ont pas été abordées, notamment, dans deux documents clés de la SZP-TNO : A Balanced Approach to Establishing Protected Areas in the Northwest Territories (1999) et le mandat du Comité directeur de la Stratégie (révisé en décembre 2011). Cet écart donne lieu à des réponses incertaines de la part des participants aux entrevues et aux études de cas. Certains n'étaient pas au courant, mais d'autres ont parlé du Secrétariat et de son rôle, soulignant qu'à tout le moins le Secrétariat veille à ce que la démarche en 8 étapes se poursuive; toutefois, personne n'a expliqué comment le Secrétariat assure le progrès continu de la démarche de la SZP. En ce qui concerne le Comité directeur, lequel rend compte des progrès, des réussites et des difficultés, des mesuresNote de bas de page 26 de protection provisoires et de la démarche holistique de la Stratégie (p. ex. l'analyse des T.N.-O. afin d'évaluer quelles zones il importe de protéger pour les collectivités des Premières Nations), la réponse était différente.
L'évaluation préalable a démontré que la collecte de données sur les indicateurs de mesure du rendement a été principalement réalisée à l'aide de rapports d'étape annuels par les bénéficiaires de financement de la SZP-TNO. L'information a aussi été communiquée dans le Rapport ministériel sur le rendement. Dans le Rapport ministériel sur le rendement de 2008-2009, AADNC indique que « pour s'acquitter de ses responsabilités de gestionnaire environnemental, AINC a procédé à l'ajout de trois sites à la liste des zones protégées et a franchi de nouvelles étapes dans l'établissement des dernières réserves nationales de fauneNote de bas de page 27 ». En outre, dans le Rapport ministériel sur le rendement de 2010-2011, il est indiqué que dans le cadre de la Stratégie du Nord, « AADNC a mis de l'avant un certain nombre d'initiatives clés en vue d'appuyer le développement de collectivités durables dans le Nord et d'améliorer le climat des affaires tout en prenant les mesures nécessaires pour protéger les fragiles écosystèmesNote de bas de page 28 ».
4.3.1 Quelles sont les pratiques exemplaires et les leçons apprises au chapitre de la conception et de l'exécution des programmes (c.-à-d. la mise en œuvre)?
Constatation : Il existe quelques pratiques exemplaires et leçons apprises qui pourraient être utiles au programme à court et à long terme.
Les études de cas, les entrevues auprès des informateurs clés, l'analyse documentaire et l'examen des documents et dossiers soulignent quatre pratiques exemplaires clés associées à la SZP-TNO. Celles-ci comprennent la participation des Autochtones; le partenariat, la collaboration et la consultation; la communication; l'utilisation des connaissances traditionnelles autochtones.
Pratiques exemplaires
- Participation des Autochtones : Les éléments d'information font état du niveau impressionnant de participation continue des Autochtones à la SZP-TNO, soulignant leur inclusion précoce et leur participation au processus, ce qui doit être préservé dans les prochaines étapes. Cette démarche favorise non seulement la prise de décisions à l'échelle de la collectivité, mais augmente la probabilité d'adoption et développe la capacité des collectivités à participer à la SZP-TNO, les aidant ainsi à concrétiser leurs aspirations en matière de conservation. Par exemple, la collaboration et la participation des Premières Nations tôt dans la démarche de la Stratégie ont entraîné l'adoption de l'initiative et un soutien continu à cet égard. La Commission mondiale des aires protégées (2004) le confirme également. Elle indique que, là où la participation des peuples autochtones à la gestion s'est faite tôt dans la démarche de planification, des avantages sont observés pour les Autochtones et les responsables de la gestion.
- Partenariat, collaboration et consultation : Les éléments d'information mentionnent l'accent marqué que met la SZP-TNO sur le partenariat et la collaboration multipartites, une démarche inclusive appuyée par le modèle logique de la SZP-TNO et son document fondateur A Balanced Approach to Establishing Protected Areas in the Northwest Territories (1999). Par exemple, les groupes de travail et le Comité directeur comptent parmi leurs membres divers intervenants (collectivités autochtones, pourvoyeurs, organisations non gouvernementales de l'environnement, industrie et gouvernements fédéral et territorial) et contribuent à la prise de décisions ainsi qu'à la surveillance de la démarche en 8 étapes. La SZP-TNO cherche aussi à optimiser les efforts de collaboration et de création de partenariats en travaillant de concert avec les consultants et les collectivités autochtones pour réaliser les évaluations requises, comme l'indique l'étape 5 de la démarche de la Stratégie.
- Utilisation des connaissances traditionnelles autochtones : Comme le confirme le document fondateur de la Stratégie, A Balanced Approach (1999), le recours aux connaissances traditionnelles autochtones dans la démarche de la SZP-TNO est perçu comme l'un de ses principes directeurs. Conscients de sa valeur, les responsables de la Stratégie cherchent activement à respecter ce principe en intégrant les connaissances traditionnelles autochtones à chaque étape de la démarche et en encourageant les Autochtones à participer aux groupes de travail, au Comité directeur et en tant que partenaires des évaluations socioéconomiques, à l'étude de la documentation culturelle et à l'évaluation des ressources renouvelables et non renouvelables, et ce, de façon à s'assurer que les meilleures décisions seront prises pour l'établissement des zones protégées.
- Communication : La communication entre le Comité directeur, le Secrétariat, les groupes de travail et le grand public est une pratique exemplaire. Cette communication est possible grâce à la tenue de réunions périodiques, à la publication de bulletins, à la production de rapports annuels et au moyen du site Web de la SZP-TNO. Plus particulièrement, il a été observé lors des entrevues que la structure de communication entre les membres des groupes de travail, le Secrétariat et le Comité directeur est bonne, comme le démontre la coopération entre les membres; toutefois il est difficile de savoir exactement si les éléments de communication pertinents sont en place entre le grand public et la Stratégie.
D'autres aspects liés à cette pratique exemplaire concernent l'approche axée sur « l'image générale » de la SZP-TNO, laquelle tient compte des besoins en matière de développement des ressources. Par exemple, là où les différents groupes autochtones et les divers intervenants ne s'entendaient traditionnellement pas, la SZP-TNO a contribué à les rapprocher au sein des groupes de travail. La démarche de mobilisation en 8 étapes, reconnue par les participants comme étant pertinente, est considérée comme une pratique exemplaire et une leçon apprise en raison du fait qu'elle tient compte des intérêts de la collectivité touchée, aborde les intérêts des diverses collectivités concernées et favorise le développement de relations entre les différents intervenants.
Leçons apprises
Les personnes interrogées ont souligné de nombreuses leçons apprises qui pourraient être utiles pour la Stratégie, à court et à long terme, et ont fourni cinq exemples : informer les intervenants du fait que la démarche de la SZP-TNO pourrait prendre plus de temps que prévu, particulièrement l'étape 5 (évaluation de la zone candidate); veiller à ce que tous les intervenants comprennent bien la Stratégie, y compris ses règles, ses procédures, ses objectifs et ses mesures de protection provisoires; préciser les échéanciers d'approbation du Ministère; favoriser une meilleure communication entre AADNC et Environnement Canada aux échelons supérieurs, puisque cela pourrait accélérer le processus; préciser toutes les options de protection des terres possibles aux intervenants, particulièrement aux collectivités, avant d'aller de l'avant avec la Stratégie, afin d'établir s'il s'agit de la meilleure procédure dans leur cas.
Les résultats indiquent que la conception de la SZP-TNO comportait des rôles et des responsabilités clairs pour AADNC et les partenaires horizontaux. En règle générale, la structure de gouvernance était efficace, y compris la structure de gestion horizontale pluriministérielle et celle des divers sous-comités (p. ex. groupes de travail). Les contraintes de temps ont eu une incidence sur l'efficience de certaines structures. La plupart des intervenants ont convenu du fait que la SZP-TNO était à l'écoute des besoins des intervenants nommés, y compris les peuples autochtones et les habitants du Nord en général. Les paramètres du programme et les critères relatifs aux projets étaient exhaustifs, et les critères d'évaluation des propositions étaient assez souples pour permettre à tous les projets admissibles d'y répondre. La SZP-TNO était généralement accessible aux intervenants et permettait d'attirer des propositions. Les critiques concernaient généralement l'acheminement des fonds, puisque certains intervenants trouvaient que l'accès était imprévisible.
5. Constatations de l'évaluation - Rendement (efficacité/réussite)
5.1 Constatations
La présente section s'attarde à déterminer dans quelle mesure les activités et les extrants de l'initiative ont contribué aux résultats attendus (soit les résultats immédiats, intermédiaires et à long terme), comme l'indique la grille d'évaluation (annexe B).
Résultat immédiat a) : Dans quelle mesure les habitants des T.N.-O. sont-ils mieux sensibilisés à la SZP-TNO et dans quelle mesure les organisations régionales et les collectivités sont-elles mieux en mesure de prendre part à cette stratégie?
Constatation : Les habitants des T.N.-O. sont relativement au courant de la SZP, et celle-ci est conçue de façon à permettre aux organisations régionales et aux collectivités d'y participer. Cependant, vu l'absence de données pertinentes, il est difficile de savoir s'il y a eu une sensibilisation accrue des habitants des T.N.-O. à la Stratégie et s'il y a une capacité accrue des collectivités à y participer.
Bien que les données insuffisantes empêchent de dire s'il y a une sensibilisation accrue à la SZP ou une plus grande capacité des collectivités à y prendre part, elles indiquent tout de même que les habitants des T.N.-O. sont au courant ou mis au courant de la SZP et qu'ils ont la capacité d'y prendre part grâce à la mise en place d'un certain nombre de mécanismes, décrits plus bas. Ces deux questions (sensibilisation et capacité) sont étroitement liées, mais un effort a été fait pour les distinguer par souci de clarté, ainsi que pour mettre en lumière leur nature complexe.
Sensibilisation
Les études de cas, les entrevues auprès des informateurs clés et l'examen de documents et de dossiers montrent trois principaux mécanismes par lesquels les habitants des T.N.-O. sont mis au courant de la SZP-TNO. Le premier est l'engagement pris dans le cadre de la Stratégie de diffuser l'information, ce qui est accompli par une équipe de communication mise sur pied dans le cadre du plan d'action quinquennal de la vallée du Mackenzie (2004-2009). Cette équipe devrait demeurer active jusqu'en 2015 en menant des activités de communication continue pour mieux sensibiliser la population. Par exemple, la Stratégie est communiquée au public par l'entremise d'un site Web, de la radio, de bulletins et de l'envoi postal des rapports annuels aux ménages des T.N.-O. Cela dit, les collectivités des T.N.-O. n'ont pas toutes accès, ou un accès fiable, à Internet pour être en mesure d'obtenir de l'information pertinente sur la Stratégie. Les groupes de travail, le Comité directeur et le Secrétariat se sont également engagés à assurer la diffusion de l'information en tenant des réunions régulières pour discuter des questions préoccupantes, faire rapport des progrès et faire le point sur certains sujets, comme les rapports d'évaluation.
Le deuxième moyen de favoriser la sensibilisation des habitants des T.N.-O. à la SZP-TNO, et de renforcer la capacité des parties intéressées à y participer par la même occasion, est l'engagement pris dans le cadre de la Stratégie de tenir des ateliers d'information à l'intention des nouveaux employés et gestionnaires, et ce, pour renforcer les équipes et assurer la formation. Selon le budget et le plan de travail des partenaires de la SZP pour les exercices 2008-2009 à 2010-2011, huit ateliers au total ont été financés par le Secrétariat de la SZP-TNO, AADNC, Environnement Canada et Canards Illimités.
Dans les documents examinés, les groupes de travail des zones candidates sont considérés comme des moyens de mieux sensibiliser les habitants des T.N.-O. à la SZP et d'accroître la capacité des parties intéressées à y participer. Les groupes de travail encouragent les gouvernements autochtones, territorial et fédéral, les représentants communautaires, les aînés, les organisations non gouvernementales de l'environnement et les représentants de l'industrie à prendre part à l'initiative. Par exemple, le groupe de travail des zones protégées pour la réserve nationale de faune Edéhzhíe se compose de représentants provenant de 16 groupes. Ainsi, les intervenants qui font partie des groupes de travail retournent dans leur collectivité, organisme ou gouvernement et transmettent l'information à d'autres parties intéressées.
Parallèlement, cette sensibilisation à l'information est liée au renforcement des capacités puisqu'elle permet à d'autres personnes de prendre part à la Stratégie et favorise une discussion plus poussée au sein des collectivités du gouvernement, des organismes non gouvernementaux et du secteur privé. Par exemple, l'évaluation permet de constater que les organismes fédéraux responsables des aires protégées (comme Environnement Canada) ont l'expérience des programmes de surveillance à long terme, des protocoles de surveillance établis et des techniques de communication et que leur expertise pourrait être utile pour le Programme de surveillance des effets cumulatifs, et vice versa. En particulier, les personnes interviewées ont indiqué que la SZP-TNO dispose d'un bon ensemble de données écologiques (et culturelles) qui peuvent s'avérer utiles pour évaluer les effets cumulatifs.
Voilà qui est particulièrement important puisque le site Web d'AADNC affirme que, dans les Territoires du Nord-Ouest, les scientifiques, les gouvernements, les Autochtones et les intervenants du secteur de l'industrie travaillent en collaboration pour surveiller les effets cumulatifs du développement sur l'environnement. Selon ce site Web, pendant que les scientifiques et les Autochtones effectuent des études sur le terrain en vue d'évaluer les tendances actuelles dans l'environnement, les aînés autochtones fournissent eux aussi des renseignements de valeur grâce à leurs connaissances traditionnelles au sujet des régimes climatiques, des terres, des plantes et des animaux, ainsi que des changements qu'ils ont subis au fil du temps. L'évaluation a également mis en lumière l'importance d'une collaboration entre la SZP-TNO et des programmes comme le Programme de surveillance des effets cumulatifs, car les fonctionnaires ministériels ont constaté qu'une gestion saine de l'environnement nécessite que tous les éléments d'un cadre de gérance environnementale soient réunis, généralement à l'intérieur d'un cadre intitulé Stratégie et cadre d'évaluation et de gestion des effets cumulatifs.
Capacité
Bien que certains enjeux concernant la capacité des individus et des organismes de participer à la SZP-TNO découlent de la discussion ayant porté sur le genre de sensibilisation à la stratégie qu'il faut assurer auprès de la population (comme mentionné plus haut), l'évaluation a permis de soulever un autre mécanisme favorisant cette capacité : les ressources financières. L'initiative offre aux collectivités des fonds pour soutenir la tenue de réunions locales et pour se rendre aux réunions tenues dans d'autres localités. Le financement permet également d'embaucher des traducteurs et des traiteurs locaux, ainsi que de doter les postes de coordonnateur communautaire à l'échelon local ou régional. Dans le cadre de la SZP-TNO, l'initiative fournit également les moyens financiers de renforcer la capacité (soit les ressources humaines) de prendre part aux consultations en vue de l'évaluation des ressources, de cerner les zones candidates et de rédiger des propositions. Les études de cas indiquent que les ressources financières fournies par l'initiative se sont avérées très utiles pour renforcer la capacité communautaire (comme mentionné au point 4.2.1), sans compter que la SZP-TNO est un instrument très important pour assurer la protection des terres publiques.
Cela dit, bien que la Stratégie vise à renforcer les capacités, force est d'admettre qu'au moment d'effectuer la présente évaluation certaines collectivités disposaient d'une capacité financière moindre que d'autres, comme c'est le cas de l'Alliance des Métis de North Slave, en raison de la non-reconnaissance de son statut. Les entrevues auprès des informateurs clés ont permis de cerner un autre obstacle à la capacité, soit le manque de participation des membres du Comité directeur, particulièrement aux réunions en raison d'autres engagements et responsabilités.
Résultat immédiat b) : Dans quelle mesure existe-t-il un soutien constant/accru des intervenants et des collectivités vis-à-vis des zones protégées?
Constatation : De nombreuses collectivités et la majorité des intervenants accordent un soutien constant, voire accru, à la SZP-TNO et aux zones protégées. Cependant, l'industrie est généralement moins encline à donner son appui, puisque sa principale préoccupation demeure l'exploitation des ressources naturelles.
Les responsables de la SZP-TNO sont résolus à travailler avec les gouvernements et organisations autochtones, ainsi qu'avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, les organisations non gouvernementales de l'environnement, l'industrie, le gouvernement fédéral et les autres intervenants afin d'établir des zones protégées dans les T.N.-O. De même, la plupart des intervenants et collectivités ont la volonté d'instaurer de telles zones protégées sur le territoire, ce qui illustre toute l'importance que revêtent la durabilité de l'environnement et la préservation de la culture, de la tradition et de l'histoire autochtones (comme mentionné au point 3.1.1).
Il y a donc un soutien constant pour la SZP-TNO en général, et pour les zones protégées en particulier, mais l'évaluation a également permis de constater que ce soutien s'est accru au fil du temps, en grande partie à la suite de la mise en place d'autres groupes de travail et zones candidates.
Par définition, le terme « zone candidate » ne peut s'appliquer qu'en présence d'un appui de la collectivité, de la région et de l'organisme parrain. L'évaluation a révélé la présence d'un soutien considérable envers les zones candidates, comme celui des Premières Nations thicho et du Deh Cho. Ce soutien à divers degrés prend la forme, entre autres mesures, d'une participation aux groupes de travail, de la mise en commun des pratiques exemplaires et autres renseignements importants avec les parties concernées, de la présence aux réunions du Comité directeur, d'une opposition aux efforts visant à réduire les limites des zones protégées candidates. Par ailleurs, la Tulita District Land Corporation de la zone protégée candidate Shúhtagot'ine Néné s'est retirée de la démarche liée à la SZP-TNO après avoir trouvé un organisme parrain. Parallèlement, certaines Premières Nations aimeraient que des régions entières soient protégées, alors que d'autres sont plutôt à la recherche d'un meilleur équilibre, notamment entre la protection des terres et les possibilités d'exploiter les ressources et d'assurer le développement économique. Quant à savoir si la SZP-TNO obtiendrait l'appui et l'adhésion des collectivités qui n'en font pas encore partie, un informateur estime que tout ce que cette stratégie peut faire est de fournir une occasion, mais qu'il revient à chaque collectivité de décider si elle veut en faire partie.
L'examen de documents permet de constater que les parties moins en faveur des zones protégées proposées préconisent l'utilisation de divers instruments pour assurer la protection des terres et des aires, dont la prise de mesures de protection officielles, comme la désignation de parcs nationaux et de réserve nationale de faune ainsi que l'aménagement du territoire, combinées au cadre de réglementation en vigueur, etc.
Plus précisément, même si l'industrie des ressources (secteur privé) semble être au courant des réserves qu'ont les collectivités à propos de l'exploitation de leurs terres et de leurs ressources, elle adhère généralement moins au processus de protection que les autres intervenants parce qu'elle le voit comme un obstacle à l'exploration et à l'exploitation de certaines terres par l'établissement de zones protégées. Elle se dit surtout en faveur d'une approche qui permettra aux décideurs de choisir une protection plus souple et à plus court terme qui peut découler des règlements en vigueur. Les principales préoccupations des représentants de l'industrie portent donc sur l'accès et la souplesse. Ceux-ci préconisent également le recours aux divers outils disponibles pour obtenir des résultats plus convenables, comme les plans d'aménagement du territoire, qui peuvent être révisés et modifiés au fil des ans, et se disent convaincus que le développement économique et l'exploitation des ressources apporteront aux collectivités des gains financiers durables. En outre, leur insatisfaction envers l'orientation du Comité directeur, en particulier, les a amenés à être moins présents aux réunions du Comité directeur. Cependant, l'industrie reconnaît certains avantages à la SZP-TNO, notamment le fait qu'elle fournit des clarifications et des conclusions dans le cadre de diverses évaluations, lesquelles offrent notamment des renseignements sur ce qui peut être fait ou non dans une zone donnée.
La SZP-TNO travaille de concert avec les offices et comités d'aménagement du territoire pour veiller à ce que les zones à protéger dans le cadre de la démarche liée à la SZP soient indiquées avec exactitude dans les plans d'aménagement du territoire régionaux; l'inverse est aussi vrai : les zones désignées importantes du point de vue écologique ou culturel dans un plan d'aménagement peuvent également être soumises à une évaluation dans le cadre de la SZP-TNO en vue d'une protection et d'une gestion en vertu de la loi. De plus, puisque la SZP vient compléter la planification de l'aménagement du territoire (et tout autre instrument pouvant servir à l'atteinte des objectifs en matière de conservation, comme la désignation de sites ou de rivières du patrimoine), ses gestionnaires fournissent des renseignements et des conseils en matière de représentation écologique aux offices et comités d'aménagement du territoire. Les plans d'aménagement du territoire précisent les règles à suivre pour gérer certaines zones géographiques de manière à assurer une meilleure conservation, ainsi qu'à encadrer l'exploitation et l'utilisation appropriées des terres, des eaux et des autres ressources.
À partir des exemples susmentionnés, l'évaluation permet de conclure qu'il faut nouer un partenariat plus solide, surtout avec l'industrie. Selon les observations, les responsables de la SZP-TNO sont résolus à travailler avec les gouvernements et organisations autochtones, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, l'industrie et les organisations non gouvernementales de l'environnement afin de progresser vers l'obtention de l'ultime résultat, soit l'établissement de six réserves nationales de faune, d'un parc national et d'un lieu historique dans les T.N.-O. Jusqu'à présent, le gouvernement du Canada n'a toujours pas instauré les réserves nationales de faune exigées.
Résultat immédiat c) : Qu'en est-il de la protection provisoire établie pour les zones candidates?
Constatation : À l'heure actuelle, quatre réserves nationales de faune candidates font l'objet d'une protection provisoire : Edéhzhíe, Ts'ude niline Tu'eyeta, Ka'a'gee Tu et Sambaa K'e. Le résultat immédiat visé – offrir une protection provisoire à trois autres zones en 2011 et à un maximum de quatre autres d'ici 2013 – n'a pas été atteint, en grande partie en raison d'une communication verticale difficile (entre la SZP-TNO et les hauts fonctionnaires fédéraux de l'administration centrale). Cette constatation est également faite au sujet du résultat intermédiaire d) de ce rapport.
AADNC et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest se partagent la responsabilité de mettre en œuvre la SZP-TNO. Ils travaillent en partenariat avec d'autres ministères fédéraux (Environnement Canada et l'Agence Parcs Canada), les collectivités, les organismes régionaux, les organismes de revendication territoriale, les organisations non gouvernementales de l'environnement et l'industrie. Une inaliénabilité provisoire des terres est appliquée à une zone aux termes de la Loi sur les terres territoriales et au moyen d'un décret fédéral. Le gouvernement a recours à la protection provisoire ou à l'inaliénabilité provisoire des terres comme outil pour protéger les terres contre toute exploitation et autres activités pendant un certain temps. En ce qui concerne la SZP-TNO, la période initiale est d'au plus cinq ans, bien qu'elle soit généralement de deux ans, et elle peut être renouvelée pour deux autres années. Pendant cette période, aucun nouveau droit minier ne peut être inscrit et aucun nouveau droit d'extraction du pétrole ni d'exploitation du gaz ne peut être accordé, alors que les droits existants sont maintenus.
Selon la SZP-TNO, la protection provisoire renvoie à un retrait temporaire des terres (à l'intérieur de l'aire d'étude d'une zone candidate à protéger) contre tout nouvel intérêt lié à l'exploitation de la surface ou du sous-sol. Les réserves nationales de faune candidates peuvent faire l'objet d'une protection provisoire contre toute exploitation en surface seulement, contre toute exploitation en sous-sol seulement, ou un retrait de l'exploitation en surface et en sous-sol. La SZP-TNO exige qu'une protection provisoire soit appliquée pour veiller à ce que l'établissement de nouveaux intérêts liés à l'exploitation en surface ou en sous-sol ne vienne compromettre la valeur naturelle et culturelle d'une zone candidate durant le processus de planification des zones protégées. La quatrième étape de la démarche, qui en compte huit, demande à ce que les partenaires prenant part au processus de planification envisagent des mesures de protection provisoires et, au besoin, les prennent. Il faut au préalable obtenir le soutien des collectivités, des organismes régionaux ou des organismes de revendication territoriale, ainsi qu'établir un partenariat avec un organisme parrain. Une lettre d'appui du gouvernement territorial, des organismes régionaux ou des organismes de revendication territoriale est généralement requise lorsque le gouvernement fédéral demande une inaliénabilité provisoire des terres.
Les renseignements sur la protection provisoire proviennent principalement de l'analyse documentaire et de l'examen de documents. Selon le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats/Cadre de vérification axé sur les risques 2008 de l'initiative visant la promotion des intérêts liés à la conservation dans les T.N.-O., des mesures d'inaliénabilité des terres ont déjà été prises pour les réserves nationales de faune Edéhzhíe, Sambaa K'e et Ts'ude niline Tu'eyeta, tandis que les terres du lieu historique national Saoyú-?ehdacho font l'objet d'une inaliénabilité permanente et que celles du projet de réserve de parc national Thaidene NeneNote de bas de page 29, d'une inaliénabilité provisoire. L'évaluation a déterminé qu'il y a maintenant quatre réserves nationales de faune candidates sous protection provisoireNote de bas de page 30, soit Edéhzhíe, Ts'ude niline Tu'eyeta, Ka'a'gee Tu et Sambaa K'e.
Kwets'oòtł'àà est en attente d'une approbation du Ministère ou du Cabinet pour qu'elle soit protégée par une inaliénabilité provisoire de la surface et du sous-sol de ses terres pendant deux ans. Cette consultation a pris fin en juillet 2012, et la demande subséquente devrait obtenir l'approbation ministérielle d'ici mars 2013.
Selon les documents reçus de la SZP-TNO, la plupart des réserves nationales de faune connaissent une progression constante dans le cadre de la démarche en 8 étapes et devraient finir par obtenir une protection d'ici 2015. Plus particulièrement, les personnes interviewées lors des études de cas estiment que les zones candidates Kwets'ootl'aa et Ka'a'gee Tu parviendront à l'étape finale dans un an. Cela dit, même s'il était précisé dans le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats, le résultat immédiat voulant qu'une protection provisoire soit accordée à trois autres zones avant 2011, puis à jusqu'à quatre autres d'ici 2013, n'a pas été atteint.
Résultat intermédiaire d) : Qu'en est-il de la désignation des lieux d'importance écologique?
Constatation : Quatre réserves nationales de faune candidates font actuellement l'objet d'une protection provisoire et une attend l'approbation d'une inaliénabilité provisoire de ses terres. Le lieu historique national (Saoyú-?ehdacho) est la seule zone fédérale protégée qui a été établie dans le cadre de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les T.N.-O.
Les zones représentatives sur le plan écologique renferment des échantillons de tous les êtres vivants et de divers milieux d'une écorégion, et toutes les zones à protéger possèdent une valeur culturelle, écologique et économique. La SZP-TNO vise à protéger les zones centrales représentatives de chaque écorégion, ainsi que les zones naturelles et culturelles particulières.
Pour faciliter l'atteinte de ces objectifs, un groupe de travail a été chargé de l'étude d'une zone d'intérêt précise, puis de l'analyse de sa représentation écologique. Selon cette analyse, la zone d'intérêt est évaluée afin de déterminer si elle représente adéquatement les caractéristiques écologiques d'une écorégion en particulier. Dans le même ordre d'idées, l'équipe de la SZP-TNO fournit également des renseignements et des conseils sur la représentation écologique aux offices et comités d'aménagement du territoire. Une zone d'intérêt désignée comme d'importance écologique ou culturelle dans un plan d'aménagement peut également être soumise à une évaluation dans le cadre de la SZP-TNO en vue de profiter d'une protection et d'une gestion en vertu de la loi.
Parallèlement, la démarche adoptée dans le cadre de la SZP-TNO nécessite d'entreprendre une évaluation approfondie des attributs écologiques, culturels et économiques d'une zone. Pour ce faire, il faut (une fois la zone candidate cernée) évaluer les ressources renouvelables et non renouvelables qui existent dans la zone étudiée, puis cerner les possibilités économiques qu'offrent ces ressources, tout en mettant en lumière les lacunes. La désignation des lieux d'importance écologique constitue un résultat intermédiaire qui exige six réserves nationales de faune d'ici 2013 et jusqu'à quatre autres réserves nationales de faune après 2013.
À l'heure actuelle, il y a quatre réserves nationales de faune candidates sous protection provisoireNote de bas de page 31, soit Edéhzhíe, Ts'ude niline Tu'eyeta, Ka'a'gee Tu et Sambaa K'e.
- Edéhzhíe
La réserve Edéhzhíe comprend le plateau Horn, la rivière Horn, le lac Mills et la rivière Willowlake. Edéhzhíe s'étend sur 14 250 km2, selon la superficie recommandée par le groupe de travail d'Edéhzhíe, et elle a été parrainée par Environnement Canada en tant que réserve nationale de faune candidate en 2002. Selon le site Web de la SZP-TNO, le 21 décembre 2011, un décret a accordé l'inaliénabilité provisoire de ses terres en ce qui concerne les droits d'exploitation de sa surface et de son sous-sol jusqu'en mai 2013. La réserve est maintenant presque à la fin de l'étape 6 de la démarche liée à la SZP, et une demande officielle a été faite pour que le lieu devienne une zone protégée en permanence. À ce jour, le gouvernement du Canada est à examiner le projet d'établissement. AADNC est également à examiner la demande d'Environnement Canada de prolonger l'inaliénabilité provisoire des terres de la réserve au-delà de mai 2015. - Ts'ude niline Tu'eyeta
Ts'ude niline Tu'eyeta (ou rivière Ramparts et ses terres humides) consiste en quelque 15 000 km2 de forêt boréale nordique de qualité supérieure. Il s'agit d'une zone d'une richesse culturelle qui s'étend à l'ouest du fleuve Mackenzie et de la collectivité de Fort Good Hope. Les limites recommandées par le groupe de travail sont de 10 103 km2, et la zone a été parrainée par Environnement Canada en tant que réserve nationale de faune candidate. Le groupe de travail de Ts'ude niline Tu'eyeta a mis la dernière main à son rapport de recommandations en mars 2012. La zone est protégée par un retrait provisoire des terres en vertu d'un décret qui expire en novembre 2013. La prochaine étape consiste à demander officiellement à Environnement Canada de conseiller au gouvernement du Canada de faire de la réserve Ts'ude niline Tu'eyeta une réserve nationale de faune selon les recommandations finales. - Ka'a'gee Tu
Parrainée par Environnement Canada, la zone candidate Ka'a'gee Tu fait quelque 9 600 km2 et est située dans la partie sud-est de la région du Deh Cho; elle comprend une grande portion du bassin versant de la rivière Kakisa. Selon les données affichées sur le site Web de la SZP-TNO et les documents du programme, la plus grande partie de la zone candidate Ka'a'gee Tu fait l'objet d'une protection provisoire en vertu de l'Entente sur les mesures provisoires des premières nations du Deh Cho, qui prévoit une inaliénabilité provisoire des terres de surface et du sous-sol jusqu'en novembre 2013. - Sambaa K'e
La zone candidate Sambaa K'e, qui s'étend sur environ 10 600 km2, est située dans la partie centrale-sud de la région du Deh Cho. Sambaa K'e en est à la 5e étape de la démarche de la SZP-TNO, qui consiste à faire des recommandations sur la désignation, les limites et la gestion de la zone. Sambaa K'e est temporairement protégée aux termes de l'Entente sur les mesures provisoires des premières nations de Deh Cho, qui prévoit une inaliénabilité provisoire des terres de surface et du sous-sol jusqu'en novembre 2013. - Kwets'ootł'àà
Kwets'ootł'àà est une zone d'environ 590 km2 située dans la partie nord du bras supérieur du bassin versant du Grand lac des Esclaves; elle a été parrainée par Environnement Canada en tant que réserve nationale de faune candidate. Elle est actuellement en attente de l'approbation du gouvernement du Canada pour que ses terres en surface et son sous-sol fassent l'objet d'une inaliénabilité provisoire de deux ans, ce qui devrait être accordé en mars 2013.
Résultat intermédiaire e) : Qu'en est-il de la protection des zones candidates aux termes de la loi?
Constatation 1 : À l'heure actuelle, la seule zone protégée établie en vertu des lois fédérales est le lieu historique national Saoyú-?ehdacho. La loi protégera les zones candidates, surtout lorsque la protection provisoire sera retirée.
Afin de protéger les terres, la démarche liée à la SZP-TNO se sert de diverses lois, dont les lois fédérales et territoriales en vigueur. Les lois offrent une protection à long terme qu'il est difficile de modifier ou de retirer aux termes de leurs dispositions. L'examen de documents a permis de constater que, en matière de protection des terres, il existe trois catégories de dispositions législatives dans les T.N.-O. : les lois fédérales portant sur les zones protégées (p. ex. Loi sur les espèces sauvages au Canada, Loi sur les parcs nationaux du Canada), les lois territoriales portant sur les zones protégées (p. ex. Loi sur la faune) et les mesures législatives régionales s'appliquant aux zones protégées (dont les zones protégées en vertu des revendications territoriales et des plans d'aménagement du territoire). Les plans d'aménagement du territoire régionauxNote de bas de page 32 sont en mesure de délimiter des zones en vue de leur conservation. À la lumière de l'évaluation, les conditions qui permettront la mise en œuvre réussie de la SZP-TNO, notamment la protection contre l'activité humaine environnante, comprennent de tels cadres législatifs qui se complètent.
Se trouve actuellement visé par la SZP-TNO un lieu historique national (Saoyú-?ehdacho), protégé aux termes de la Loi sur les lieux et monuments historiques et de la Loi sur les terres territoriales. Le gouvernement fédéral et la société foncière de Déline y possèdent l'ensemble des droits de surface et d'exploitation du sous-solNote de bas de page 33. Le projet de parc national Thaidene Nene exigerait également la propriété fédérale des droits sur la surface et le sous-sol. De leur côté, les réserves nationales de faune proposées seraient protégées en vertu de la Loi sur les espèces sauvages au Canada. L'examen de la documentation portant sur les activités d'Environnement Canada a permis de comprendre le but des réserves nationales de faune : elles sont créées et gérées pour assurer la recherche sur la faune, ainsi que la conservation et l'interprétation des oiseaux migrateurs, des espèces en péril et des autres espèces sauvages (Service canadien de la faune), de même que pour « assurer la protection d'habitats essentiels aux oiseaux migrateurs et aux autres espèces sauvages, particulièrement les espèces en péril ». À ce jour, Environnement Canada n'a pu établir aucune des six réserves nationales de faune prévues à son mandat.
Sous l'autorité du ministre de l'Environnement, qui est également le ministre responsable de l'Agence Parcs Canada, Environnement Canada est habituellement l'organisme parrain des zones à protéger, et le Service canadien de la faune en est l'administrateur. Les droits de surface sont détenus par Environnement Canada, qui, aux termes de la Loi sur les terres territoriales, peut demander à ce que les droits d'exploitation du sous-sol soient inaliénables de façon permanente. Le ministre de l'Environnement peut faire cette demande au ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien au nom des collectivités et du Ministère. Les informateurs clés admettent que, sans les dispositions législatives portant sur le parrainage fédéral, les obstacles à la protection des terres seraient insurmontables.
La démarche prévue par la SZP-TNO est axée sur les décisions des collectivités et vise en fin de compte une protection juridique permanente des zones candidates. À cette fin, une approche législative visant la protection de ces zones et de leurs attributs, laquelle nécessite le poids législatif des gouvernements, est considérée comme complémentaire aux autres processus et utile pour cerner et protéger les zones candidates. Dans une certaine mesure, les dispositions législatives devraient protéger les zones candidates, particulièrement lorsqu'aucune protection provisoire n'est en place.
Bien que les diverses lois se complètent, elles viennent également ajouter foi aux engagements et obligations du Canada sur la scène internationale en ce qui a trait aux zones protégées. Cela dit, l'évaluation a révélé que l'expiration de la protection provisoire, surtout pour les zones candidates, ouvre la voie à la conduite de certaines activités humaines (p. ex. l'exploitation des ressources). Ce n'est que lorsqu'une protection provisoire supplémentaire est accordée (ce qui peut prendre plusieurs mois) que la zone candidate peut être exempte d'activité humaine. Comme le démontre le lieu historique national (Saoyú-?ehdacho) jusqu'à présent, la loi garantit bel et bien une protection contre l'activité humaine environnante, ce qui n'est pas le cas en son absence. Voilà qui explique très bien pourquoi les collectivités et parties intéressées prenant part à la démarche préconisée par la SZP-TNO tiennent à se rendre à l'étape 7 (approuver et désigner la zone protégée en permanence) et à l'étape 8 (gérer et surveiller la zone protégée établie).
Constatation 2 : Les opinions sont mitigées quant à savoir si la protection des zones candidates aura les retombées prévues sur les plans écologique, social et économique.
Les entrevues auprès des informateurs clés et les études de cas révèlent des réactions mitigées quant aux répercussions écologiques, sociales et économiques que pourrait avoir la protection des zones. Le premier groupe (divers intervenants) est d'avis que, même si la SZP-TNO doit trouver un équilibre entre diverses retombées possibles, l'initiative est en bonne voie d'avoir des retombées. Selon ces intervenants, les retombées sont surtout attribuables à la démarche en 8 étapes et aux discussions menées lors des réunions du Comité directeur et des groupes de travail. Les informateurs font remarquer que si la SZP-TNO réussit à créer au moins cinq zones protégées au cours des prochaines années, elle parviendra à concrétiser sa vision en matière de protection, ce qui entraînera les retombées écologiques, sociales et économiques escomptées. Par exemple, les études de cas donnent à penser que, pour ce qui est des retombées écologiques, les espèces en péril et d'autres animaux survivront dans une zone protégée et prospéreront sur plusieurs générations. Sur le plan social, les études de cas indiquent que les peuples autochtones seront en mesure de conserver leur mode de vie, tout en préservant et en protégeant leur histoire, leur culture et leur tradition pour les générations à venir; alors que sur le plan économique, les peuples et les collectivités autochtones auront « la maîtrise d'autres initiatives », comme l'écotourisme et la prévention de l'exploration et de l'exploitation des ressources au détriment de l'environnement. Cependant, certains participants à l'initiative craignent que les habitants des T.N.-O. ne sachent pas ce qui arrivera à la fin, lorsqu'une zone sera bel et bien protégée. Par exemple, les Autochtones s'inquiètent à l'idée de perdre leurs droits, leurs traditions et leur culture. Ils ont également des réserves quant à la façon dont les terres seront gérées par les autorités et se demandent si toutes les valeurs autochtones seront protégées.
Par ailleurs, l'autre groupe d'intervenants n'a pas directement parlé des répercussions écologiques, sociales et économiques que devrait avoir la protection des zones candidates, mais s'est plutôt concentré sur deux éléments : le développement durable et les connaissances traditionnelles autochtones. Même s'ils ne savent pas si l'initiative permettra le développement durable, les informateurs admettent qu'elle fait partie d'un plan à plus grande échelle pour y parvenir (p. ex. volet d'un régime de saine gestion des terres). Cela dit, ils reconnaissent également que l'atteinte du développement durable dans les T.N.-O. excède de beaucoup la portée de la SZP. Quelques informateurs ont exprimé leur point de vue à ce sujet : certains croient que le développement durable ne sera possible que dans certaines parties du territoire, alors que d'autres estiment que le développement durable ne se fera pas du tout, en raison des intérêts divergents, de l'absence d'une définition commune et d'une confusion quant à la signification qu'a le développement durable pour les gens qui travaillent dans d'autres domaines, comme l'exploitation minière, les revendications territoriales, etc. Parallèlement, un autre petit groupe de répondants est d'avis que l'initiative ne parviendra pas à un équilibre, surtout pour l'industrie, puisqu'il sera plus difficile pour celle-ci de mener ses activités.
Les entrevues auprès des informateurs clés et les études de cas ont également porté sur la question de l'utilisation des connaissances traditionnelles, qui fournissent de précieux renseignements et d'importantes orientations pour les activités de gouvernance. Les parties intéressées disent que la présence d'un savoir traditionnel permet de réfléchir à la meilleure façon de faire participer les habitants à la prise de décisions et laisse présager que la protection d'une zone aura les résultats escomptés lorsqu'elle sera établie. Les connaissances traditionnelles autochtones sont examinées plus en détail en tant que pratique exemplaire au point 4.3.1. Même si l'évaluation cherchait à établir dans quelle mesure il est probable que la SZP-TNO débouche sur la protection des lieux d'importance culturelle et écologique sans compromettre l'exploitation des ressources, seuls deux informateurs ont répondu à la question, en adoptant deux perspectives contradictoires. Par contre, l'évaluation a permis de constater que la discussion portant sur le développement durable (ci-dessus) cherchait à déterminer si la protection des lieux culturels et écologiques importants sans compromettre l'exploitation des ressources est possible.
Autres résultats g) : Y a-t-il eu des résultats imprévus, positifs ou négatifs?
Constatation : La SZP-TNO a engendré deux principaux résultats imprévus positifs et neuf résultats imprévus négatifs.
Résultats imprévus positifs
Les participants aux études de cas et aux entrevues mentionnent deux principaux résultats imprévus qui s'avèrent positifs. Même si certaines répercussions semblent avoir été volontairement prévues, elles sont mises en évidence par les deux sources de données en raison de leur très lourde incidence sur l'initiative et les collectivités. Premièrement, les entrevues auprès des informateurs clés et les études de cas font état de la grande connaissance des terres qu'il a été possible d'acquérir en communiquant avec les aînés et les autres Autochtones, savoir qui demeurera au sein des collectivités pour qu'elles en profitent longtemps. Non seulement ces connaissances, mais aussi la quantité et la qualité des données tirées des diverses évaluations, ainsi que les connaissances acquises au sein des groupes de travail et du Comité directeur, offrent d'énormes avantages pour la démarche de la SZP-TNO en général et pour les parties intéressées en particulier. Un tel savoir permet aux collectivités d'être mieux informées qu'elles auraient pu l'être autrement; elles sont ainsi en mesure de combler leurs lacunes et de se servir de ce savoir dans le cadre des négociations sur les revendications territoriales. Par exemple, certains rapports de nature écologique et culturelle ont réitéré l'importance des oiseaux migrateurs et des espèces en péril. Deuxièmement, la démarche adoptée dans le cadre de la SZP-TNO a amené les collectivités, le gouvernement, les organisations non gouvernementales de l'environnement et l'industrie à travailler ensemble, ce qui leur a permis de resserrer les liens qui les unissent.
Résultats imprévus négatifs
Selon les entrevues menées, il y aurait neuf principaux résultats imprévus négatifs découlant de la SZP-TNO. Le premier concerne le temps : la démarche liée à la SZP-TNO prend beaucoup plus de temps que prévu au départ, ce qui pourrait éventuellement susciter certaines frustrations chez les participants. Le deuxième résultat imprévu négatif concerne les perceptions jugées trompeuses et controversées au sujet de la SZP, comme l'opposition au développement, la taille trop imposante des zones candidates et l'idée fausse que les zones protégées deviendront un parc national.
Quant à l'évaluation des ressources non renouvelables, certains font remarquer qu'il est parfois arrivé que les collectivités abandonnent la SZP après avoir fait cette évaluation, pour plutôt explorer les possibilités d'exploitation des ressources. Étroitement liés à ce résultat imprévu négatif sont les cas où l'industrie a reçu (sans frais) des données provenant de l'évaluation des ressources non renouvelables (p. ex. minéraux, pétrole et gaz), données qu'elle aurait eu du mal à trouver autrement et qu'elle aurait dû payer. Bien que ce ne soit pas la seule retombée des évaluations, les personnes interviewées estiment que, lorsque les collectivités décident de procéder à l'exploitation des ressources, l'industrie est ainsi en mesure de mieux concentrer ses activités, sans compter l'avantage technologique qu'elle possède déjà.
Le quatrième résultat se rapporte à l'évaluation des ressources non renouvelables et découle d'intérêts opposés et de l'éternelle nécessité de trouver un juste équilibre entre la protection et le développement. Lorsqu'il s'agit de l'évaluation des ressources non renouvelables, la perception est qu'elle offre un avantage indu pour l'industrie, en ce sens que même si le but ultime de la SZP-TNO est la protection des terres, elle n'exclut pas le développement.
Le cinquième résultat négatif a trait à l'inaliénabilité provisoire des terres : il arrive parfois que l'évaluation des ressources non renouvelables se fasse sans la participation des collectivités et que la protection provisoire soit levée, ce qui, comme l'évaluation a permis de le constater, suscite de la méfiance au sein des collectivités. Par exemple, il arrive qu'AADNC prenne des décisions de façon unilatérale, sans tenir de consultations au préalable. Même si les personnes interviewées n'ont pas donné d'exemples précis, il semble que ces propos concernent l'inaliénabilité provisoire des terres d'Edéhzhie, qui a fait l'objet d'un litige au cours de la présente évaluation. Ce cas particulier s'est finalement soldé par un règlement entre les parties en mars 2013.
De nombreux intervenants se sont également dits très préoccupés par l'absence d'un financement stable de la SZP-TNO, ce qui ne permet pas de prévoir la somme dont elle disposera ni le moment où les fonds seront obtenus. Cette situation a nui à la planification future des activités de la SZP. Les personnes interviewées estiment également que même si l'initiative tente d'établir un degré élevé de collaboration et de communication, l'industrie ne s'est pas montrée très enthousiaste de participer à la SZP-TNO. Ces deux questions ont été abordées en détail au point 4.2.1 de la section Conception et exécution et dans la description du résultat immédiat b) de la section Rendement du présent rapport d'évaluation.
Finalement, les parties intéressées craignent que les collectivités n'aient aucun mot à dire ni aucun pouvoir sur la zone candidate une fois protégée dans le cadre de l'initiative, comme l'explique en détail la description du résultat immédiat e) de la section Rendement. En résumé, ce résultat imprévu est lié à un manque de communication sur les rôles et responsabilités futurs précis de toutes les parties concernées par les zones protégées.
5.2.1 Dans quelle mesure le programme a-t-il réussi à optimiser ses processus, ainsi que la quantité et la qualité de ses produits ou services pour parvenir aux résultats attendus? (efficience)
Constatation : Dans l'ensemble, le programme a donné certains des résultats attendus. Il y a encore place à l'amélioration pour accroître l'efficience de l'exécution du programme, notamment en ce qui concerne les aspects suivants : clarté du rôle de la SZP-TNO en ce qui concerne la conservation des milieux marins, constance du financement et versement des fonds en temps opportun, clarification des structures de gouvernance et accroissement de la capacité des collectivités à prendre part à la démarche de la SZP-TNO.
Le personnel de la SZP-TNO a réussi à coordonner les activités de la SZP, ce qui est un bon indicateur de son efficience. En outre, l'évaluation a permis de constater que l'utilisation des structures prévues dans la SZP (p. ex. groupes de travail, bureaux régions d'AADNC et d'Environnement Canada) a également entraîné des économies. Par exemple, les données montrent une harmonisation entre la démarche en 8 étapes de la SZP et les pratiques et procédures des ministères fédéraux. Les répondants indiquent également que cette démarche en 8 étapes est efficiente en raison de sa souplesse, de sa rentabilité (p. ex. optimisation des ressources) et de la reconnaissance des intérêts de toutes les parties intéressées. De plus, l'évaluation n'a trouvé aucun chevauchement des efforts.
Parallèlement, les entrevues auprès d'informateurs clés, l'examen des documents et les études de cas ont permis de cerner un ensemble d'aspects qui peuvent être améliorés pour accroître l'efficacité de la SZP à exécuter le programme. Certains points à améliorer présentés ici ont déjà été mentionnés dans d'autres parties du rapport. Les voici en bref : accélérer l'approbation des mesures visant l'inaliénabilité provisoire des terres, clarifier le rôle de la SZP en matière de conservation des milieux marins, favoriser la constance du financement et le versement des fonds en temps opportun, collaborer avec les autres intervenants (p. ex. Programme de surveillance des effets cumulatifs), clarifier les structures de gouvernance et accroître la capacité des parties intéressées à prendre part aux réunions du Comité directeur.
5.3.1 En se fondant sur la comparaison de la SZP-TNO avec l'établissement de parcs et de zones protégées ailleurs, est-il possible d'opter pour une autre approche afin d'obtenir des résultats semblables?
Constatation : L'évaluation ne permet pas de conclure qu'une autre stratégie que la SZP conviendrait mieux aux T.N.-O.
Une comparaison entre la SZP-TNO et les initiatives similaires menées dans d'autres territoires, provinces et pays fournirait des données intéressantes, mais les risques de mal les interpréter sont grands, ce qui peut mener à des conclusions erronées. L'évaluation permet de constater que, même si chaque initiative est unique, toute comparaison doit être envisagée avec discernement, et les données, interprétées avec prudence.
Dans le cas de la SZP, une comparaison est faite avec l'établissement de zones protégées dans les autres provinces et territoires, ainsi qu'avec des initiatives semblables menées dans les T.N.-O. Par exemple, l'analyse documentaire a permis de trouver au Canada des stratégies de conservation comparables à la SZP-TNO. Ainsi, au Yukon, le gouvernement territorial a adopté la Wild Spaces and Protected Places: A Protected Areas Strategy en 1998 en vue de protéger les zones centrales et les lieux spéciaux dans chacune de ses 23 écorégionsNote de bas de page 34. Au Nunavut, le gouvernement travaille actuellement à élaborer le Programme des parcs du Nunavut, qui sera suivi de la mise en œuvre du plan lié au réseau des parcs et des zones de conservation, ce qui aboutira en fin de compte à une stratégie des zones protégées. Parallèlement, chaque province dispose d'une initiative de conservation comparable, notamment l'Alberta (Alberta Special Places), le Manitoba (Initiative des zones protégées) et Terre-Neuve (Natural Areas Plan)Note de bas de page 35.
En outre, certaines initiatives de conservation menées au sein des régions désignées des T.N.-O. viennent compléter la SZP-TNO. Par exemple, la région désignée des Inuvialuit a établi la zone de protection marine Tarium Niryutait dans le delta du Mackenzie aux termes de la Loi sur les océans du ministère des Pêches et Océans Canada, laquelle est presque terminée, ainsi que la région désignée des Gwich'in, à l'aide du plan d'aménagement du territoire des Gwich'in, qui est le seul plan régional approuvé au sein des T.N.-O. précisant des zones de conservation, des zones spéciales de gestion et de conservation du patrimoine ainsi que des zones d'utilisation générale.
Même s'il existe d'autres initiatives de conservation au sein des régions désignées des T.N.-O. et dans tout le pays, l'analyse de chacune de ces initiatives pour explorer d'autres façons de faire dépasse la portée de l'évaluation. Puisque les sources de données disponibles n'abordaient pas suffisamment la question, l'évaluation ne permet pas de conclure qu'une autre stratégie que la SZP aurait été plus efficace dans les T.N.-O. Cette dernière s'est avérée souple et complémentaire aux plans d'aménagement du territoire (p. ex. il est permis de mener l'initiative sur des terres faisant l'objet de revendications territoriales non réglées, alors que les plans régionaux d'aménagement du territoire ne le peuvent pas), ce qui témoigne de son unicité.
Les données provenant de la plupart des entrevues auprès des informateurs clés et des études de cas donnent à penser que la SZP-TNO est unique (qu'aucun programme ne lui ressemble), mais certains estiment que les plans d'aménagement du territoire pourraient être une bonne solution de rechange. Cependant, cette proposition doit être envisagée avec grande prudence puisque les plans et la SZP comportent des différences marquées. En particulier, les plans d'aménagement du territoire ont le pouvoir de modifier les limites des zones, alors que ces limites sont considérées comme permanentes dans le cadre de la SZP-TNO. De plus, les plans sont beaucoup plus longs à mettre en œuvre par rapport à la SZP. Autre différence entre ces deux mécanismes : il n'y a aucun fonds de gestion lié aux zones de conservation décrétées en vertu des plans, contrairement aux réserves nationales de faune candidates établies dans le cadre de la SZP. En revanche, la SZP-TNO convient à l'obtention de résultats immédiats et, jusqu'à ce qu'il y ait des revendications territoriales, l'inaliénabilité provisoire des terres est d'une importance capitale pour faire obstacle à toute activité industrielle non souhaitée.
De l'avis de certains informateurs clés, il serait utile d'apporter quelques modifications à la démarche de la SZP-TNO, notamment pour y préciser la taille maximale d'une zone protégée dès le départ, au lieu d'avoir à en étendre les limites de façon progressive; cela suscite des craintes chez certains intervenants. Parallèlement, des informateurs clés affirment que de nombreuses solutions de rechange ont été examinées au moment d'établir la SZP-TNO et qu'il a fallu beaucoup de temps pour peaufiner la démarche, qui comporte maintenant de nouveaux aspects et diverses valeurs.
5.4.1 Quelles sont les perceptions quant aux défis à relever et aux possibilités à exploiter pour obtenir les résultats immédiats?
Constatation : Les principaux défis et possibilités mentionnés sont la nécessité de disposer des ressources humaines adéquates et d'assurer une entrée de fonds constante pour pouvoir participer efficacement à tous les échelons de la prise de décisions.
Principaux défis
La présente section aborde trois principaux défis qui ont déjà été mentionnés dans le rapport, ce qui souligne encore une fois l'importance d'en discuter. Le premier défi concerne le temps indu qu'il faut pour obtenir l'inaliénabilité provisoire des terres d'une zone candidate, ce qui retarde et prolonge la démarche de la SZP. Le deuxième défi concerne la question de la capacité. Il est particulièrement important pour la SZP-TNO de disposer des ressources humaines et financières suffisantes pour prendre part à tous les échelons de la prise de décisions et ainsi refléter les valeurs et le point de vue des personnes concernées. Selon les personnes interviewées, les intervenants ont peu de ressources et de temps à consacrer à certains aspects de la démarche (comme assister aux réunions du Comité directeur) en raison d'autres engagements. Certains interprètent cette situation comme un manque de volonté ou d'intérêt à participer (voir le point 4.2.1 de la section Conception et exécution).
Le troisième principal défi concerne l'absence d'un acheminement efficace des fonds à la SZP-TNO. Encore une fois, les personnes interviewées estiment que les bénéficiaires ne savent pas avec précision la somme qui leur sera versée ni le moment où elle leur sera versée, ce qui nuit à la planification de leurs activités (voir le point 4.2.1 de la section Conception et exécution).
Possibilités
Selon ce qui ressort des entrevues auprès des informateurs clés, la SZP-TNO est un excellent exemple de participation des collectivités. L'initiative offre aux collectivités et aux groupes les outils appropriés pour prendre part au programme s'ils le souhaitent et quand ils sont prêts à le faire.
5.5.1 Le programme a-t-il utilisé le minimum de ses ressources (financières, humaines et matérielles), tout en optimisant les extrants et les résultats? (économie)
Constatation : La SZP-TNO a réussi à réduire au minimum les ressources financières et matérielles nécessaires, tout en optimisant les résultats. Cela dit, les ressources humaines et les résultats peuvent être améliorés.
Dans l'ensemble, la SZP-TNO a respecté le budget prévu au cours des quatre derniers exercices (soit de 2008-2009 à 2011-2012)Note de bas de page 36, et ce, malgré les compressions budgétaires, comme le démontre le tableau 3. Ce fait est particulièrement notable compte tenu des coûts élevés qu'il faut assumer pour faire des affaires dans le Nord, notamment les frais élevés de déplacement vers des lieux éloignés, une saison d'activité plus courte, etc. Le Comité directeur revoit régulièrement le budget afin de faire le meilleur usage possible des fonds, qui proviennent de multiples sources (voir le tableau 5)Note de bas de page 37. Les tableaux 3 et 4 ne comportent pas les données financières de l'Agence Parcs Canada puisque, à titre d'organisme parrain de certaines zones, l'Agence Parcs Canada avait ses propres procédés avant l'instauration de la SZP-TNO. Le tableau 5 présente les données financières de l'Agence Parcs Canada.
| Exercice | Financement alloué |
Fonds dépensés |
|---|---|---|
| 2008-2009 | 4 095 501 | 3 929 634 |
| 2009-2010 | 3 142 822 | 3 105 276 |
| 2010-2011 | 2 716 411 | 2 551 296 |
| 2011-2012 | 2 160 691 | 1 916 685 |
Source : Budget et plan de travail des partenaires (toutes les parties intéressées) de la SZP présentés par le programme. |
||
| 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloué | Dépensé | Alloué | Dépensé | Alloué | Dépensé | Alloué | Dépensé | Alloué | Dépensé | |
| AADNC | 1 910 120 | 1 910 120 | 1 759 513 | 1 755 649 | 1 455 445 | 1 455 445 | 1 105 500 | 1 083 943 | 6 230 578 | 6 205 157 |
| Environnement Canada | 674 000 | 674 000 | 274 000 | 274 000 | 207 000 | 191 000 | 267 500 | 255 300 | 1 422 500 | 1 394 300 |
| Autres sourcesNote de bas de page 38 | 1 525 139 | 1 345 524 | 1 109 309 | 1 075 627 | 1 053 966 | 904 851 | 787 691 | 577 442 | 4 476 105 | 3 903 434 |
| Total | 4 109 259 | 3 929 634 | 3 142 822 | 3 105 276 | 2 716 411 | 2 551 296 | 2 160 691 | 1 916 685 | 12 129 183 | 11 502 891 |
Source : Budget et plan de travail des partenaires de la SZP. | ||||||||||
Selon le tableau 5 ci-dessous, l'Agence Parcs Canada n'a pas dépensé tous les fonds de l'enveloppe allouée. Certains délais ont retardé l'avancement du projet, mais l'Agence va tout de même de l'avant avec l'opérationnalisation du lieu historique national Saoyú-?ehdacho et l'évaluation de la faisabilité du projet de réserve de parc national Thaidene Nene, quoique plus lentement dans ce cas. Les fonds ont été reportés pour terminer les projets prévus. Par exemple, le projet de lieu historique national Saoyú-?ehdacho en est à l'étape de la construction d'une cabane traditionnelle en bois rond qui servira à de multiples usages, notamment des rassemblements culturels. En ce qui concerne le projet de réserve de parc national Thaidene Nene, le travail continue à se concentrer sur l'établissement de relations et la négociation avec les groupes autochtones, la réalisation de l'évaluation socioéconomique, l'achèvement de l'évaluation des ressources minérales et énergétiques, sans compter la consultation publique qui devrait commencer sous peu.
| Année | Fonds alloués à l'Agence Parcs Canada | Lieu historique national Saoyú-?ehdacho | Réserve de parc national Thaidene Nene | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 1 894 000 $ | 28 260 $ | 216 615 $ | 244 875 $ |
| 2009-2010 | 2 056 000 $ | 320 500 $ | 266 767 $ | 587 267 $ |
| 2010-2011 | 1 905 000 $ | 345 500 $ | 587 619 $ | 933 119 $ |
| 2011-2012 | 1 189 000 $ | 499 100 $ | 628 615 $ | 1 127 715 $ |
| 2012-2013Note de bas de page 39 | 1 014 000 $ | 478 100 $ | 417 024 $ | 895 124 $ |
| Total | 8 058 000 $ | 1 671 460 $ | 2 116 640 $ | 3 788 100 $ |
Source : Responsable du programme, Agence Parcs Canada |
||||
Le tableau 6 donne un exemple de la répartition des fonds dans le cadre de la SZP-TNO.
| Exercice | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds alloués | Fonds dépensés | Fonds alloués | Fonds dépensés | Fonds alloués | Fonds dépensés | Fonds alloués | Fonds dépensés | |
| Comité directeur et personnel | 1 113 682 $ | 1 102 126 $ | 696 953 $ | 651 108 $ | 411 421 $ | 472 778 $ | 599 909 $ | 571 223 $ |
| Représentation écologique | 118 850 $ | 66 850 $ | 71 576 $ | 71 576 $ | 115 000 $ | 75 000 $ | 159 097 $ | 176 596 $ |
| Cartographie/planification des ressources non renouvelables / examen des politiques | 1 129 314 $ | 1 129 314 $ | 1 133 476 $ | 1 128 574 $ | 1 070 000 $ | 1 070 000 $ | 112 584 $ | 172 484 $ |
| Élaboration et examen des politiques | 45 520 $ | 49 352 $ | 115 737 $ | 103 737 $ | 0 $ | 0 $ | 24 000 $ | 1 170 $ |
| Communications | 96 410 $ | 90 710 $ | 96 518 $ | 91 602 $ | 35 500 $ | 41 700 $ | 30 378 $ | 42 838 $ |
| Initiatives sur les zones protégées par région | 1 592 725 $ | 1 477 534 $ | 1 028 561 $ | 1 058 679 $ | 1 084 490 $ | 891 819 $ | 1 234 723 $ | 952 375 $ |
| Total | 4 095 501 $ | 3 915 886 $ | 3 142 822 $ | 3 105 276 $ | 2 716 411 $ | 2 551 296 $ | 2 160 691 $ | 1 916 685 $ |
Source : Budget et plan de travail des partenaires de la SZP |
||||||||
L'une des constatations de l'évaluation au sujet des coûts, laquelle a été confirmée par les entrevues auprès des informateurs clés et les études de cas, concerne la répartition inégale des ressources consacrées aux évaluations. Comme l'indique le tableau 7, 84 % des fonds qu'AADNC a versés à l'évaluation des réserves nationales de faune candidates ont été alloués à l'évaluation des ressources non renouvelables.
| Évaluations financées par AADNC | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Évaluations culturelles | 15 961 | 5 300 | 48 892 | 70 153 | |
| Évaluations écologiques | 59 426 | 476 | 59 902 | ||
| Évaluations des ressources non renouvelables | 386 328 | 1 095 200 | 1 020 000 | 110 484 | 2 612 012 |
| Évaluations des ressources renouvelables | 64 191 | 14 229 | 32 400 | 110 820 | |
| Évaluations socioéconomiques | 37 159 | 84 481 | 136 106 | 267 681 | |
| Total | 563 065 | 1 193 910 | 1 193 806 | 169 787 | 3 120 568 |
Source : Responsables du programme |
|||||
Le tableau 8 présente une ventilation détaillée des sommes versées par AADNC qui ont été consacrées à l'évaluation des ressources non renouvelables. Ainsi, en 2008-2009, la somme dépensée pour ce type d'évaluation atteint 1 129 314 $. Bien que ce montant ne cesse de diminuer au fil des ans, pour atteindre 172 484 $ en 2011-2012, les fonds consacrés à ce type d'évaluation par rapport aux autres types sont importants. La présente évaluation n'a pas permis de savoir la raison de cette diminution, même s'il est connu que la somme consacrée à l'évaluation des ressources non renouvelables repose lourdement sur la taille de la zone à l'étude, ainsi que sur son emplacement et les données existantes. Au cours des années où des zones plus petites ou moins éloignées sont évaluées, la somme dépensée pour l'évaluation des ressources non renouvelables diminue. Certaines années, plus d'une évaluation de ce type est menée, ce qui hausse la somme dépensée à cette fin.
Selon certaines personnes interviewées, cette répartition disproportionnée des fonds est contrebalancée par la mine de renseignements découlant de ces évaluations. AADNC est le principal bailleur de fonds de cette activité et y a consacré 3 494 072 $ au cours des exercices 2008-2009 à 2011-2012. Une comparaison entre les fonds d'AADNC consacrés à l'évaluation des ressources non renouvelables (tableau 8) et le financement total réel d'AADNC (tableau 4) montre combien de fonds disponibles ont servi à l'évaluation des ressources non renouvelables.
| 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| AADNC | 1 129 314Note de bas de page 40 | 1 122 274 | 1 070 000 | 172 484 | 3 494 072 |
| Autres sources (Canards Illimités Canada) | 6 300 | 6 300 | |||
| Total | 1 129 314 | 1 128 574 | 1 070 000 | 172 484 | 3 500 372 |
Source : Budget et plan de travail des partenaires de la SZP soumis par le programme |
|||||
L'évaluation a également permis de constater que les ressources provenant d'autres sources ne sont pas nombreuses, comme cela est précisé dans le budget et plan de travail des partenaires de la SZP (tableau 4). Le montant obtenu d'autres sources au cours de l'exercice 2008-2009 (voir la note du tableau 4) était de 22 376 $; aucune donnée n'était disponible pour les autres exercices. Les informateurs clés disent également qu'à certains moments, à cause de l'entrée inconstante des fonds du gouvernement fédéral, la SZP-TNO devait emprunter de l'argent aux organisations non gouvernementales de l'environnement pour poursuivre ses activités. Ils estiment qu'un accord de financement pluriannuel conviendrait bien à ce programme parce que le montant attendu serait indiqué avec précision, il y aurait moins de retards et l'efficience, l'économie et la rentabilité de la SZP-TNO s'en trouveraient améliorées.
Les informateurs ne s'entendent pas quant au niveau de ressources humaines et financières (quantité et qualité) qu'il faut pour atteindre les résultats, mais les parties intéressées sont en général satisfaites des produits et services offerts par la SZP-TNO. Celles-ci invoquent particulièrement l'optimisation des ressources que permet l'initiative. Cela dit, de l'avis d'autres intervenants, il y a place à l'amélioration. Les études de cas révèlent que les membres des groupes de travail ne sont pas entièrement satisfaits de la qualité de l'évaluation des ressources. Par exemple, les rapports d'évaluation des ressources (rédigés par des consultants) pourraient, selon les personnes interviewées, renfermer des données de qualité supérieure et ne sont pas toujours du meilleur calibre (c'est-à-dire qu'ils manquent parfois de renseignements importants). Les entrevues auprès des informateurs clés ont révélé que les problèmes de qualité semblent être attribuables au manque de connaissances sur les T.N.-O. (des gens, de la culture, de la géographie) de la part du consultant, ce qui vient miner la crédibilité du processus au sein de la collectivité.
D'autres personnes interviewées sont d'avis que plus de fonds devraient être consacrés aux évaluations socioéconomiques parce qu'elles permettent de cerner toutes les organisations, collectivités et autres parties qui pourraient avoir des intérêts à l'intérieur et autour de la zone candidate, de déterminer la situation socioéconomique passée et présente des collectivités pouvant être concernées et finalement d'estimer la valeur économique et autre des diverses ressources qui se trouvent dans la zone candidate. De plus, les personnes interviewées mentionnent que les rapports produits ne sont pas toujours présentés aux groupes de travail et que les membres des collectivités sont rarement consultés sur les questions liées aux terres, aux animaux, aux ressources, etc.
Pour ce qui est du personnel, les répondants estiment qu'il s'efforce de faire preuve de transparence et de collaboration et qu'il est passionné par son travail. Toutefois, ils font remarquer qu'il pourrait y avoir plus de ressources humaines, surtout en raison du roulement qui a contribué au manque de cohérence de la démarche de la SZP-TNO. Le roulement du personnel est attribué à la nature du travail, au lieu de travail et au type d'accord de financement en place. À partir des documents examinés et des entrevues, l'évaluation n'a pas pu déterminer le nombre exact d'employés embauchés dans le programme ou qui l'ont quitté.
L'étape 5 (évaluations) est également mise en évidence comme aspect pouvant être mieux doté en ressources, que ce soit en financement ou en expertise propre à certaines évaluations (notamment en embauchant des anthropologues culturels dans le cadre des évaluations culturelles, des économistes pour mener les évaluations socioéconomiques, etc.). En ce qui concerne la représentativité des groupes de travail, les opinions divergent. Selon les personnes interviewées, certains membres des groupes de travail croient que le nombre de représentants est approprié, alors que d'autres estiment que les groupes de travail devraient comprendre plus de représentants des collectivités, surtout de celles qui se trouvent dans la zone candidate. D'autres problèmes liés à la capacité sont abordés au point 4.2.1. La plupart des informateurs affirment que, sans le financement de la SZP-TNO, certaines collectivités ne pourraient pas prendre part aux diverses étapes de la démarche de la SZP-TNO.
Les entrevues auprès des informateurs clés et les études de cas ont révélé que, concernant la question des ressources réduites consacrées aux évaluations, les plans d'aménagement du territoire constituent la seule solution de rechange pour parvenir aux résultats. Les répondants admettent d'emblée que même si la SZP-TNO et les plans présentent certaines similarités, ils ont chacun des aspects uniques. Par exemple, l'analyse documentaire et l'examen des documents et dossiers permettent de constater que les plans d'aménagement du territoire et la SZP-TNO édictent des règles sur la façon de gérer certaines zones géographiques afin d'assurer la conservation, le développement ainsi que l'utilisation des terres, des eaux et des autres ressources. Selon l'examen des documents et dossiers, l'élaboration de plans peut être légalement exigée dans le cadre de revendications globales ou de dispositions législatives ou demandée par les gouvernements et les peuples autochtones. Il convient de noter que les zones désignées importantes sur le plan écologique ou culturel dans un plan d'aménagement du territoire peuvent également faire l'objet d'une évaluation dans le cadre de la SZP-TNO en vue d'une protection et d'une gestion conformes à la loi.
Constatation 2 : La rentabilité de la SZP-TNO demeure inconnue.
Compte tenu que les nombreuses sources de données n'offrent pas de preuves suffisantes pour déterminer si l'initiative est rentable, l'évaluation ne permet pas de tirer de solides conclusions à ce sujet. Ce qu'il est possible de conclure sur la foi de l'analyse faite dans le cadre de l'évaluation est qu'il est difficile d'accorder une valeur pécuniaire à l'atteinte d'un objectif de conservation donné avec des ressources limitées. D'autant plus que cette difficulté est aggravée par les limites de l'évaluation que sont les contraintes de ressources et de temps. Pour entreprendre une analyse coût-efficacité, il faut notamment comprendre les aspects biologiques de la conservation ou les complexités liées à toute une superficie de masse terrestre. Les défis inhérents à cette estimation sont nombreux, par exemple la désagrégation de coûts qui se recoupent puisque plusieurs des mesures prises pour désigner une zone protégée permettent d'atteindre plusieurs objectifs (p. ex. de nouvelles zones transfrontalières peuvent améliorer la connectivité, la représentativité et les services de protection des principaux écosystèmes). Si, en plus, le degré de recoupement est inconnu, il devient très difficile de démêler les coûts qui se recoupent ou de distinguer certains coûts entre eux, etc.
En outre, pour déterminer la rentabilité, il faut très bien connaître les divers types de coûts de la conservation, notamment des variables comme les frais de gestion (soit ceux liés à la gestion d'un programme de conservation, comme établir et maintenir un réseau de zones protégées), les frais d'acquisition/transaction (soit le prix pour acquérir ou transférer les droits de propriété d'une certaine parcelle de terre, lequel comprend les coûts pour négocier avec les propriétaires et obtenir l'approbation du transfert des titres), le coût des dommages (dommages aux activités économiques découlant des programmes de conservation, par exemple les dommages aux moyens de subsistance du fait que les animaux sauvages vivant dans une zone protégée voisine à un établissement humain peuvent représenter une perte de revenu importante) ou les coûts d'opportunité (soit le coût des occasions ratées, qui est une mesure du revenu qui aurait pu être gagné par la meilleure utilisation d'une ressource après la conservation si celle-ci n'avait pas été mise en place).
Cela dit, certaines données empiriques donnent à penser que la plupart des informateurs croient à la rentabilité de la SZP-TNO, puisqu'elle utilise les fonds dont elle dispose pour optimiser les résultats et, de ce fait, offre aux collectivités qui y participent de très bonnes chances de réussite, comme certaines l'ont vécu. Les informateurs font remarquer que la démarche permet de faire le travail à « faible coût ». Sans les fonds de la SZP-TNO comme levier financier, les collectivités ne seraient pas en mesure de prendre part à la démarche. Les informateurs clés et les personnes interviewées dans le cadre des études de cas soulignent également les grands avantages d'une protection provisoire des zones à protéger, citant notamment la prévention de l'exploitation des ressources dans les zones où elle n'est pas nécessaire, la durabilité des terres, la préservation de la culture, de la tradition et de l'histoire autochtones, la protection d'un milieu/écosystème unique pour la collectivité, les générations à venir, l'ensemble des Canadiens et le monde entier.
6. Conclusion
6.1 Conclusion
À la suite de l'évaluation, il est possible de conclure que la contribution fédérale à la SZP-TNO est pertinente et permet généralement d'atteindre les objectifs à court terme, mais elle n'a pas donné les résultats prévus à long terme. Par conséquent, les recommandations sont formulées dans le but d'orienter les améliorations à apporter. Le présent chapitre se divise en deux parties. La première présente les constatations en fonction de la pertinence, de la conception et de l'exécution et du rendement. La seconde présente les recommandations qui ressortent de l'évaluation.
Pertinence
Les données probantes démontrent le besoin continu d'instaurer un réseau de zones fauniques protégées dans les T.N.-O. Cette nécessité s'explique surtout par un intérêt accru pour le développement économique et l'exploitation des ressources du territoire, ainsi que par une plus grande activité dans ce domaine, et son éventuelle incidence sur les Premières Nations, la faune et l'habitat. Parallèlement, un tel réseau est complémentaire aux plans d'aménagement du territoire régionaux.
Puisque les enjeux environnementaux qui ont mené à la création de la SZP-TNO sont toujours d'actualité, il y a un besoin continu d'outils, de mécanismes, de politiques, d'un leadership, d'une coordination et d'une collaboration avec les organismes gouvernementaux et les collectivités pour aborder plus facilement ces enjeux. À cet égard, le maintien de la SZP-TNO est nécessaire.
En outre, l'initiative est conforme aux priorités du gouvernement du Canada puisque AADNC gère les ressources, les terres et l'environnement dans le Nord. La SZP-TNO est également en harmonie avec les rôles et responsabilités fédéraux puisqu'elle assume des responsabilités de nature législative et réglementaire envers les terres publiques. Cependant, il est difficile de savoir précisément comment et dans quelle mesure le transfert des terres et des ressources dans les T.N.-O. pourrait affecter les rôles et responsabilités du gouvernement du Canada par rapport à la SZP-TNO.
Conception et exécution
Selon l'évaluation, la SZP-TNO est adéquatement gérée. Cela dit, même si sa structure de gouvernance est claire et offre un bon modèle de prise de décisions tenant compte des nombreux intérêts, le rôle du Comité directeur soulève des inquiétudes chez les parties intéressées, qui estiment que ce dernier doit fournir une orientation stratégique et évoluer, surtout en vue du transfert des terres. Ainsi, cela aiderait la SZP-TNO à se préparer à répondre aux questions liées à ce transfert. C'est pourquoi, selon l'évaluation, il est nécessaire non seulement de revoir le rôle et l'approche du Comité directeur, mais aussi de le faire évoluer, surtout en ce qui concerne la gestion et la surveillance des zones protégées.
Dans l'ensemble, l'évaluation a permis de constater que les ressources financières de la SZP-TNO suffisent pour soutenir la démarche qui s'y rattache, notamment la prise de décisions, le soutien administratif et la conduite des évaluations. Cela dit, les fonds attendus n'ont pas été versés avec constance, ce qui a nui aux efforts de planification et de gestion. Il est donc considéré comme particulièrement pertinent d'assurer une entrée constante de fonds et une capacité renforcée en ressources humaines, tant pour le moment que pour les années à venir, puisque le nombre de projets d'exploitation industrielle des ressources (p. ex. mines et énergie) devrait augmenter. De plus, aucune donnée ne permet de conclure à l'existence de mécanismes de mesure du rendement.
L'évaluation a permis de soulever une question importante au sujet de la mise en œuvre et de la supervision de la SZP-TNO en ce qui a trait aux aires marine de conservations. Plus précisément, rien n'indique que des efforts sont consentis pour assurer la conservation des milieux marins. Cela met en lumière une importante lacune des activités de la SZP-TNO puisque les documents du programme signalent que ce dernier vise la conservation des milieux terrestres et marins, sans compter le fait que les réserves nationales de faune sont conçues pour protéger les terres et les eaux.
Rendement
La contribution fédérale à la SZP-TNO a permis d'atteindre quelques-uns de ses objectifs. Par exemple, les habitants des T.N.-O. connaissent l'initiative, et celle-ci est gérée de façon à ce que les organismes régionaux et les collectivités puissent y prendre part. Le programme n'a pas donné le résultat immédiat visant la protection provisoire de trois autres zones avant 2011 et jusqu'à quatre autres zones avant 2013, comme l'indique le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats, et il n'a réussi à établir aucune des six réserves nationales de faune prévues à son mandat aux termes des lois fédérales. À l'heure actuelle, il n'en existe qu'une seule : Saoyú-?ehdacho. Les principaux résultats intermédiaires et à long terme, surtout l'établissement d'une protection en vertu de la loi pour sept zones candidates avant 2013, n'ont pas non plus été atteints. Des problèmes d'exécution du programme (p. ex. complexité, intensité d'utilisation des ressources, retards dans les approbations) ainsi que la communication sur les raisons des retards sont invoqués quand il s'agit de cerner les obstacles à l'atteinte des résultats intermédiaires et à long terme.
Comme l'ont souligné de nombreux intervenants, l'évaluation a permis de confirmer que seuls d'importants changements à la SZP-TNO parviendront à améliorer de manière significative et durable son efficience et son efficacité. Ces changements sont notamment une collaboration et une coordination avec d'autres programmes existants, comme le Programme de surveillance des effets cumulatifs, pour réduire la durée et le coût des évaluations, tant en renforçant la capacité, ainsi que la refonte du Comité directeur pour en faire un solide pivot central et assurer une meilleure coordination avec les hauts fonctionnaires fédéraux de l'administration centrale. L'évaluation donne à penser que la SZP-TNO a pris des mesures pour utiliser le minimum de ressources financières et matérielles, tout en optimisant ses résultats. Cependant, en raison d'un manque de données, il est impossible de confirmer si elle est rentable.
6.2 Recommandations
Il est recommandé que les ministères et organismes participants, en collaboration les uns avec les autres :
- abordent la question des limites de capacité à l'échelle de la collectivité en travaillant avec les partenaires communautaires concernés, afin de miser sur un savoir-faire et des capacités accrus dans la réalisation des activités de la SZP-TNO, tout en partageant les coûts associés aux évaluations et aux activités du groupe de travail;
- revoient et révisent le rôle du Comité directeur afin de veiller à ce qu'il assure une orientation stratégique, conformément à son mandat;
- de concert avec les ministères et organismes concernés, revoient les mécanismes de financement actuels afin d'assurer la prévisibilité des fonds et leur attribution opportune aux bénéficiaires; et
- adoptent une approche qui permettra de mieux comprendre la SZP-TNO et de mieux communiquer ses objectifs, en ce qui concerne le transfert de responsabilités sur les terres et les ressources.
Annexe A : Diagramme du processus lié aux zones protégées
Ce diagramme a été élaboré pour cette évaluation à la suite de l'examen des documents de financement du programme)
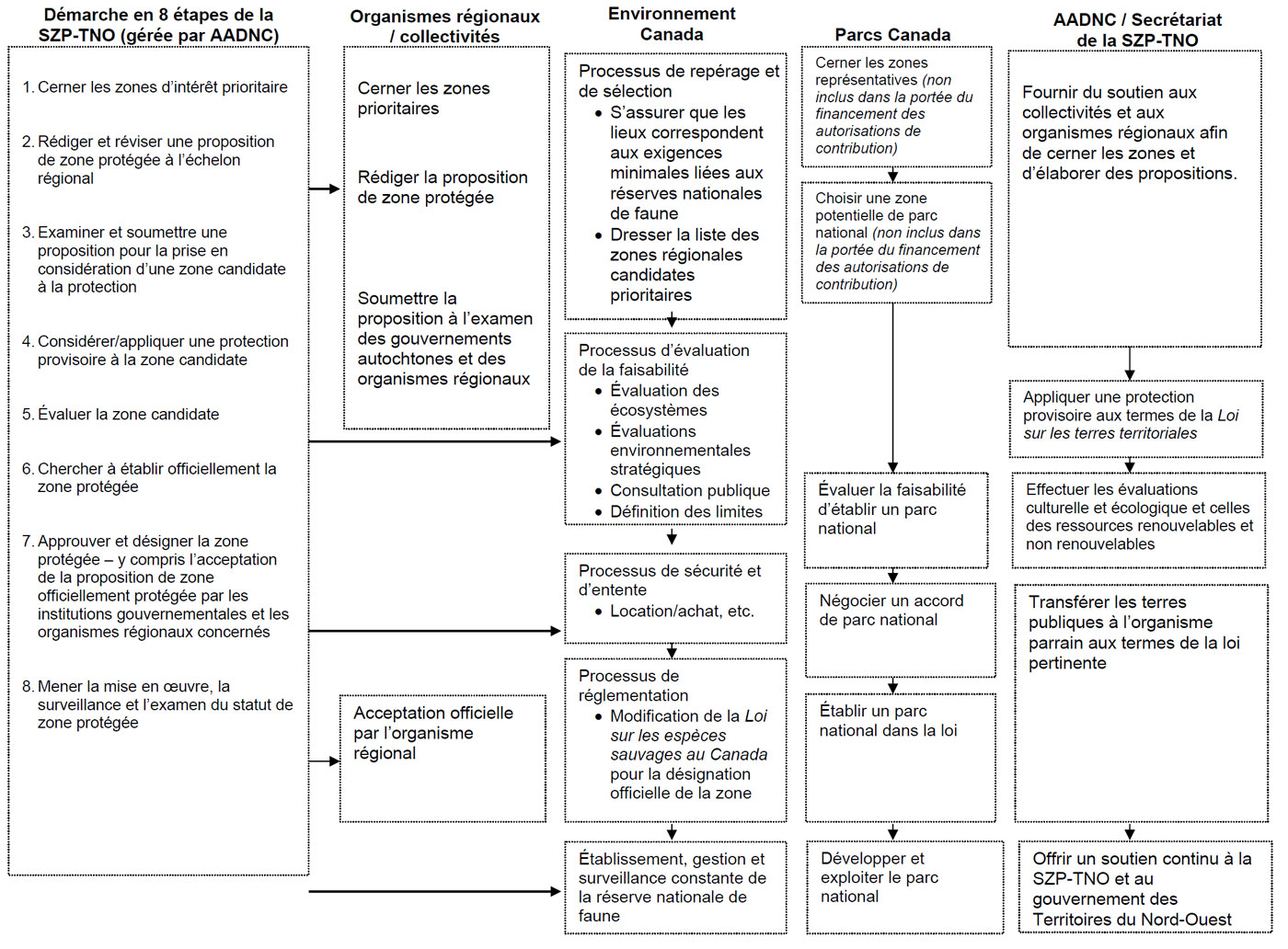
La description textuelle de l'Annexe A : Diagramme du processus lié aux zones protégées
L'annexe A est un diagramme montrant la démarche en huit étapes menée par AADNC à l'égard de la SZP-TNO, et indiquant les rôles joués par Environnement Canada et Parcs Canada.
Voici les huit étapes :
- Cerner les zones d'intérêt prioritaire;
- Rédiger et réviser une proposition de zone protégée à l'échelon régional;
- Examiner et soumettre une proposition pour la prise en considération d'une zone candidate à la protection;
- Considérer/appliquer une protection provisoire à la zone candidate;
- Évaluer la zone candidate;
- Chercher à établir officiellement la zone protégée;
- Approuver et désigner la zone protégée – y compris l'acceptation de la proposition de zone officiellement protégée par les institutions gouvernementales et les organismes régionaux concernés;
- Mise en œuvre, surveillance et examen du statut de zone protégée.
Ces huit étapes sont reliées par des flèches aux encadrés correspondant aux organismes régionaux et aux collectivités (deuxième colonne), dont les rôles sont définis ainsi :
- Cerner les zones prioritaires;
- Rédiger la proposition de zone protégée;
- Soumettre la proposition à l'examen des gouvernements autochtones et des organismes régionaux;
- Acceptation officielle par l'organisme régional.
Ces huit étapes sont reliées par des flèches aux encadrés indiquant les activités d'Environnement Canada (troisième colonne), qui sont définies ainsi : Processus d'identification et de sélection
- S'assurer que les lieux correspondent aux exigences minimales liées aux RNF;
- Dresser la liste des zones régionales candidates.
Ces activités sont reliées par une flèche aux activités suivantes : Processus d'évaluation de la faisabilité
- Évaluation des écosystèmes;
- Évaluations environnementales stratégiques;
- Consultation publique;
- Définition des limites.
Ces activités sont aussi reliées par une flèche à l'activité suivante : Processus de sécurité et d'entente
- Location/achat, etc.
Cette activité est à son tour reliée par une flèche à l'activité suivante : Processus de réglementation
- Modification à la Loi sur les espèces sauvages au Canada pour la désignation officielle de la zone.
Enfin, cette activité est reliée par une flèche à l'activité suivante :
- Établissement, gestion et surveillance constante de la RNF.
Dans la quatrième colonne, on trouve des encadrés qui indiquent le processus suivi par Parcs Canada, défini ainsi :
- Cerner les zones représentatives (non inclus dans la portée du financement des autorisations de contribution).
Cette activité est reliée par une flèche à l'activité suivante :
- Choisir une zone potentielle de parc national (non inclus dans la portée du financement des autorisations de contribution).
Cette activité est aussi reliée par une flèche à l'activité suivante :
- Évaluer la faisabilité d'établir un parc/monument national.
Cette activité est à son tour reliée par une flèche à l'activité suivante :
- Négocier un accord de parc/monument national.
Cette activité est ensuite reliée par une flèche à l'activité suivante :
- Établir un parc/monument national dans la loi.
Enfin, cette activité est reliée par une flèche à l'activité suivante :
- Développer et exploiter le parc/monument national.
De plus, dans la cinquième colonne, des encadrés reliés par des flèches indiquent les activités d'AADNC et du Secrétariat de la SZP-TNO, qui sont définies ainsi :
- Fournir du soutien aux collectivités et aux organismes régionaux afin de cerner les zones et d'élaborer des propositions.
Ces activités sont reliées par une flèche à l'activité suivante :
- Appliquer une protection provisoire aux termes de la Loi sur les terres territoriales.
Cette activité est également reliée par une flèche à l'activité suivante :
- Effectuer les évaluations culturelle et écologique et celles des ressources renouvelables et non renouvelables.
Cette activité est ensuite reliée par une flèche à l'activité suivante :
- Transférer les terres publiques à l'organisme parrain aux termes de la loi pertinente.
Enfin, cette activité est reliée par une flèche à l'activité suivante :
- Offrir un soutien continu à la SZP-TNO et au GTNO.
Annexe B : Grille pour l'évaluation des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord Ouest
| Questions d'évaluation | Indicateurs | Source de données/méthode |
|---|---|---|
| PERTINENCE | ||
| 1. Est-il nécessaire d'instaurer un réseau de zones protégées pour les espèces sauvages et de parcs naturels dans les Territoires du Nord-Ouest? |
|
|
| 2. Cette initiative est-elle en conformité avec les priorités du gouvernement fédéral? |
|
|
| 3. Cette initiative est-elle harmonisée avec les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral? |
|
|
| CONCEPTION ET EXÉCUTION | ||
| 4. Cette initiative est-elle conçue pour répondre aux besoins relatifs à la création de parcs et d'aires pour les espèces sauvages? |
|
|
| 5. Le programme est-il exécuté de manière à atteindre les résultats? |
|
|
| 6. Quelles sont les pratiques exemplaires et les leçons apprises au chapitre de la conception et de l'exécution des programmes? |
|
|
| RENDEMENT : RÉSULTATS | ||
| 7. Dans quelle mesure les activités et les extrants d'AADNC ont-ils contribué aux résultats attendus pour l'initiative de promotion des intérêts en matière de conservation (y compris les résultats immédiats, intermédiaires et à long terme)? | ||
| Résultats immédiats | ||
| a) Habitants des T.N.-O. davantage sensibilisés à la SZP-TNO, et organismes régionaux et collectivités mieux en mesure de prendre part à cette stratégie |
|
|
| b) Soutien constant/accru des intervenants et des collectivités vis-à-vis des zones protégées |
|
|
| c) Protection provisoire établie pour les zones candidates |
|
|
| Résultats intermédiaires | ||
| d) Désignation des lieux d'importance écologique |
|
|
| e) Protection des zones candidates aux termes de la loi |
|
|
| Résultats à long terme | ||
| f) Protection des lieux d'importance culturelle et écologique sans compromettre l'exploitation des ressources |
|
|
| Autres résultats | ||
| g) Résultats imprévus, positifs ou négatifs |
|
|
| RENDEMENT : EFFICIENCE, ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ | ||
| 8. Efficience : Dans quelle mesure le programme a-t-il réussi à optimiser ses processus, ainsi que la quantité et la qualité de ses produits ou services pour parvenir aux résultats attendus? |
|
|
| 9. Économie : Le programme a-t-il utilisé le minimum de ses ressources (financières, humaines et matérielles), tout en optimisant les extrants et les résultats? |
|
|
| 10. L'initiative est-elle rentable? |
Nota : ces indicateurs peuvent être recoupés/combinés avec ceux relatifs à l'économie et à la pertinence. |
|
Annexe C : Modèle logique du Programme
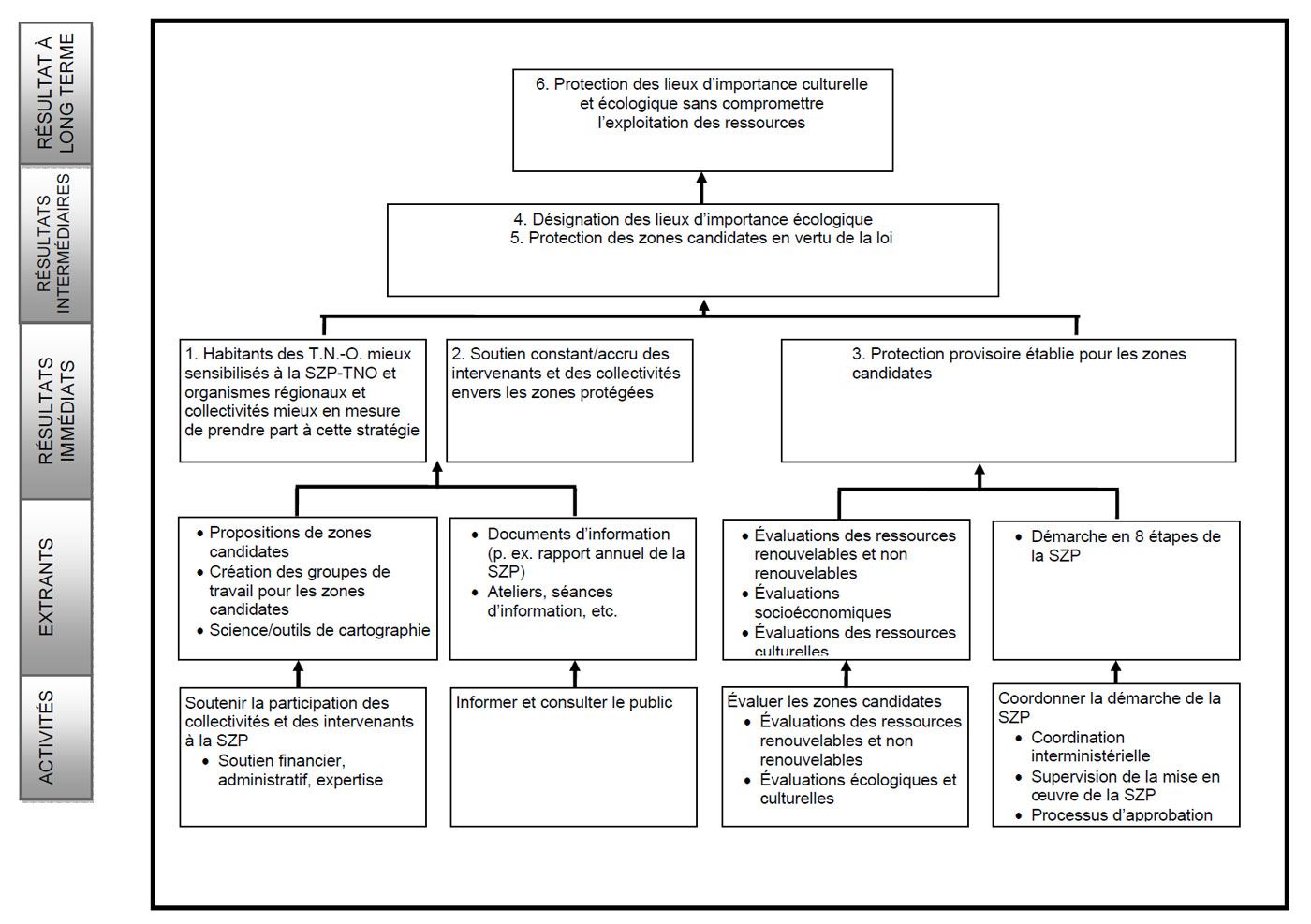
La description textuelle de la Annexe C : Modèle logique du Programme
L'annexe C comprend un modèle logique pour le programme de la SZP-TNO, qui définit d'abord les domaines d'activité de la façon suivante :
- Soutenir la participation des collectivités et des parties intéressées à la SZP : soutien financier, administratif, expertise;
- Informer et consulter le public;
- Évaluer les zones candidates : évaluations des ressources renouvelables et non renouvelables; évaluations écologiques et culturelles;
- Coordonner la démarche de la SZP : coordination interministérielle; supervision de la mise en œuvre de la SZP; processus d'approbation.
Ces activités sont reliées par des flèches aux extrants associés à ces activités, qui sont définis ainsi :
- Propositions de zones candidates; établissement des GT pour les zones candidates; science/outils de cartographie;
- Documents d'information (p. ex. Rapport annuel de la SZP); Ateliers, séances d'information, etc.;
- Évaluations des ressources renouvelables et non renouvelables; Évaluations socioéconomiques; Évaluations des ressources culturelles;
- Démarche en 8 étapes de la SZP.
Chaque extrant est relié par des flèches à ses résultats immédiats (1, 2 et 3), qui sont définis ainsi :
- Habitants des T.N.-O. mieux sensibilisés à la SZP-TNO et organismes régionaux et collectivités mieux en mesure de prendre part à cette stratégie;
- Soutien constant/accru des parties concernées et des collectivités envers les zones protégées;
- Protection provisoire établie pour les zones candidates.
Ces résultats immédiats des extrants sont reliés par une flèche à des résultats intermédiaires (4 et 5), définis ainsi :
- Désignation des lieux d'importance culturelle et écologique;
- Protection des zones candidates en vertu de la loi.
Ces résultats intermédiaires sont reliés par une flèche à un résultat à long terme, défini ainsi :
6. Protection des lieux d'importance culturelle et écologique sans compromettre l'exploitation des ressources.
Annexe D : Carte de la SZP-TNO
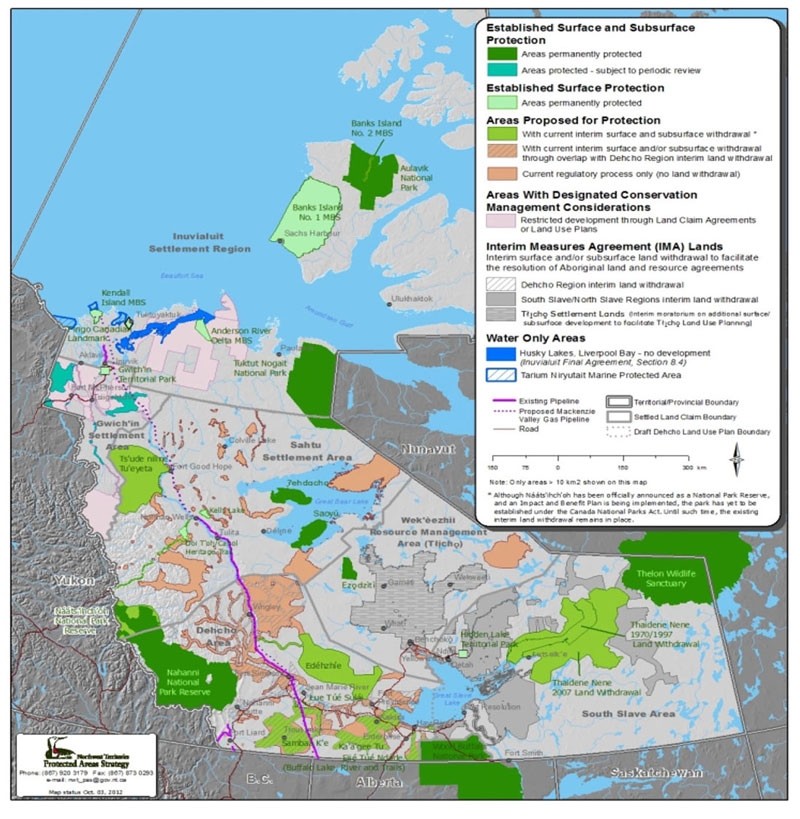
La description textuelle de la Annexe D : Carte de la SZP-TNO
Cette carte indique les six types d'approches globales de conservation et de gestion des terres actuellement adoptées dans les Territoires-du-Nord-Ouest.
La légende apparaissant à la droite de la carte indique les six types distincts de catégories de conservation et de gestion des terres énumérées comme suit :
La première catégorie décrit les zones visées par les mesures établies en matière de protection des terres de surface et du sous-sol. Ces zones sont regroupées en deux sous-catégories comprenant : les zones protégées en permanence et les zones considérées comme étant protégées, mais susceptibles d'être soumises à un examen périodique.
Les zones protégées en permanence sont les suivantes : le refuge faunique Thelon situé dans le quadrant nord-est de la région de South Slave; le parc national Wood Buffalo situé le long de la frontière des Territoires-du-Nord-Ouest et de l'Alberta; la réserve du parc national Nahanni située le long de la frontière du Yukon, qui couvre le territoire compris dans le quadrant nord-ouest de la région de Dehcho jusqu'à la partie la plus méridionale de la région désignée du Sahtu; le parc national Tuktuk Nogait situé à proximité de la pointe nord-ouest du Nunavut; le parc national Aulavik dans la partie la plus septentrionale de Banks Island situé dans la région désignée des Inuvialuit; une petite zone située au sud du Great Bear Lake dans la zone de gestion des ressources du Wek'eezhii (Tlicho); et deux péninsules, Saoyú et ?ehdacho, situées le long de la côte ouest du Great Bear Lake dans la région désignée du Sahtu.
Les zones protégées, mais susceptibles d'être soumises à un examen périodique sont actuellement toutes situées dans la région désignée des Gwich'in située dans le quadrant nord-ouest des Territoires-du-Nord-Ouest.
La deuxième catégorie indiquée décrit les zones visées par les mesures établies en matière de protection des terres de surface, qui sont protégées en permanence. Les zones classées dans cette catégorie sont les suivantes : une zone au nord-est et une autre au sud-ouest de la collectivité de Norman Wells dans la région désignée du Sahtu; le parc territorial Gwich'in situé dans la partie la plus septentrionale de la région désignée des Gwich'in, juste au sud d'Inuvik; le parc territorial Hidden Lake situé au nord du Great Slave Lake dans la région de South Slave; et le refuge d'oiseaux migrateurs (ROM) de Banks Island No 1 entourant Sachs Harbour et le ROM de Kendall Island, le site canadien des Pingos et le ROM du delta de la rivière Anderson le long de la côte nord à proximité de la mer de Beaufort, qui sont toutes situées dans la région désignée des Inuvialuit.
La troisième catégorie mentionnée décrit les zones pour lesquelles des mesures de protection sont proposées. Ces zones, qui sont regroupées en trois sous-catégories, comprennent les zones visées par l'inaliénabilité provisoire actuelle des terres de surface et du sous-sol, celles visées par l'inaliénabilité provisoire actuelle des terres de surface et du sous-sol en raison d'éléments communs avec l'inaliénabilité provisoire des terres de la région de Dehcho; et celles soumises uniquement au processus réglementaire actuel qui ne prévoit aucune inaliénabilité des terres.
Les zones qui entrent dans la sous-catégorie de l'inaliénabilité provisoire actuelle des terres de surface et du sous-sol comprennent : la région de Ts'ude niline Tu'eyeta située à l'ouest de Fort Good Hope; la région d'Edéhzhíe, celle d'Ejié Túé Ndáde à proximité du parc national Wood Buffalo, la région de Sambaa K'e entourant le Trout Lake et la région de Ka'a'gee Tu entourant Kakisa, toutes situées dans la région de Dehcho; et celles visées par l'inaliénabilité provisoire des terres de 1970/1997 et de 2007 appliquée au parc national Thaidene Nene, qui sont situées au nord-est de Great Slave Lake. Le parc national Naats'ihch'oh situé le long de la partie nord de la réserve du parc national Nahanni et à proximité de la frontière du Yukon dans la région désignée du Sahtu est également inclus dans cette sous-catégorie. Cependant, bien qu'il ait été désigné officiellement en tant que réserve de parc national et qu'un plan des répercussions et des avantages ait été mis en œuvre, le parc n'a pas encore été établi aux termes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Dans l'intervalle, l'inaliénabilité provisoire actuelle des terres demeure en vigueur.
Toutes les zones correspondant à la deuxième sous-catégorie comportent souvent des éléments communs avec celles appartenant à la première et à la troisième sous-catégories, qui sont situées seulement dans la région de Dehcho. La troisième sous-catégorie décrit les zones soumises uniquement au processus réglementaire actuel et pour lesquelles aucune inaliénabilité des terres n'est prévue. Les zones de cette sous-catégorie sont éparpillées dans la région désignée du Sahtu, la région de Dehcho Area et deux endroits de la zone de gestion des ressources du Wek'eezhii, soit Yambahti situé dans la partie la plus orientale du quadrant est à proximité du Nunavut et Dinàgà Wek'èhodì situé dans la partie septentrionale du bras nord du Great Slave Lake.
La quatrième catégorie indiquée décrit les zones visées par des considérations définies en matière de gestion de la conservation dont l'aménagement est limité en raison des accords liés aux revendications territoriales et des plans d'aménagement du territoire. Les zones dont l'aménagement est limité en raison des accords liés aux revendications territoriales et des plans d'aménagement du territoire comprennent : une vaste portion du territoire situé entre Inuvik et Tuktoyaktuk dans la région désignée des Inuvialuit; une grande partie de la région entourant Fort McPherson et la partie la plus méridionale de la région désignée des Gwich'in.
La cinquième catégorie mentionnée décrit les terres visées par une entente sur les mesures provisoires. Ces zones sont regroupées en trois sous-catégories qui comprennent : les zones visées par l'inaliénabilité provisoire des terres appliquée à la région de Dehcho; les zones visées par l'inaliénabilité provisoire des terres appliquée aux régions de South Slave et de North Slave; les terres désignées de Tlicho pour lesquelles il existe un moratoire provisoire concernant d'autres travaux de développement des terres et du sous-sol pour faciliter l'aménagement du territoire de Tlicho.
La première sous-catégorie englobe plusieurs petites zones visées par l'inaliénabilité provisoire des terres appliquée à la région de Dehcho, mais qui se trouvent à l'extérieur des zones qui comportent des éléments communs avec celles pour lesquelles des mesures de protection ont été proposées tel qu'il est décrit dans la troisième catégorie ci-dessus. La deuxième sous-catégorie comprend les zones situées le long du Great Slave Lake et entourant les terres appartenant à la catégorie de zones visées par l'inaliénabilité des terres appliquée au parc national Thaidene Nene ainsi que plusieurs autres plus petites portions de terre dans la région de North Slave. La troisième sous-catégorie comprend une large région isolée dans la zone de gestion des ressources du Wek'eezhii et regroupe les quatre collectivités de Tlicho, soit les Gameti, les Wekweètì, les Whatì et les Behchoko.
La sixième et dernière catégorie énumérée décrit les secteurs où l'on retrouve seulement une étendue d'eau. Cette catégorie comporte deux sous-catégories incluant les Husky Lakes; la baie Liverpool – aucune zone de développement tel qu'il est énoncé dans l'article 8.4 de la Convention définitive des Inuvialuit; et la zone marine protégée de Tarium Niryutait. Les zones classées dans ces deux sous-catégories se trouvent uniquement dans la région désignée des Inuvialuit, la première sous-catégorie incluant les Husky Lakes et la région de la baie Liverpool et la deuxième sous-catégorie comprenant les zones situées le long de la côte nord.
Au bas de la légende se trouvent six points de repère différents décrivant les éléments suivants :
- Le pipeline existant qui s'étend sur une courte distance en direction nord à partir d'Inuvik dans la région désignée des Inuvialuit; deux pipelines construits à proximité de Fort Liard dans la région de Dehcho; et un gros pipeline construit à Norman Wells dans la région désignée du Sahtu qui traverse la région de Dehcho en direction sud pour se rendre à la frontière de l'Alberta à proximité de celle de la C.-B.
- Le gazoduc proposé de la vallée du Mackenzie qui s'étend du sud-est du ROM de Kendall Island situé dans la région désignée des Inuvialuit à un endroit au sud-est d'Inuvik dans la région désignée des Gwich'in et qui se raccorde au pipeline de Norman Wells dans la région désignée du Sahtu. Il existe un second embranchement dans la région de Dehcho qui passe du sud de Wrigley à Fort Simpson.
- Bien qu'elles aient été indiquées dans la légende, les routes des Territoires-du-Nord-Ouest ne sont pas visibles sur la carte.
- Les frontières territoriales et provinciales indiquent les limites des Territoires-du-Nord-Ouest avec le Yukon à l'ouest, des provinces de la C.-B., de l'Alberta et de la Saskatchewan au sud et du Nunavut au nord-est et à l'est.
- La limite établie aux termes d'un règlement de revendications territoriales indique les six zones désignées des Territoires-du-Nord-Ouest. Il s'agit de la région désignée des Inuvialuit située le long de la côte nord depuis la frontière du Yukon jusqu'à la frontière du Nunavut, qui comprend les Banks Island dans la mer de Beaufort; de la région désignée des Gwich'in située le long de la frontière ouest à proximité du Yukon et au sud de la région désignée des Inuvialuit; de la région désignée du Sahtu située au sud-est de la région désignée des Gwich'in et qui s'étend de la frontière du Yukon au Nunavut le long de la frontière nord-est, au sud de la région désignée des Inuvialuit; de la région de Dehcho située au sud de la région désignée du Sahtu, à l'ouest/nord-ouest de la frontière du Yukon et au nord de la C.-B. et de l'Alberta; de la zone de gestion des ressources du Wek'eezhii située au nord-est de la région de Dehcho, au sud-est de la région désignée du Sahtu et au sud-ouest du Nunavut; et de la région de South Slave située à l'est de la région de Dehcho, au sud-est de la zone de gestion des ressources du Wek'eezhii, au sud et à l'ouest du Nunavut, au nord de l'Alberta et de la Saskatchewan.
- La frontière établie selon le plan provisoire d'aménagement du territoire de Dehcho figure sur la légende, mais n'est pas visible sur la carte.
(Carte non disponible en français)
Annexe E : Écorégions terrestres des T.N.-O.
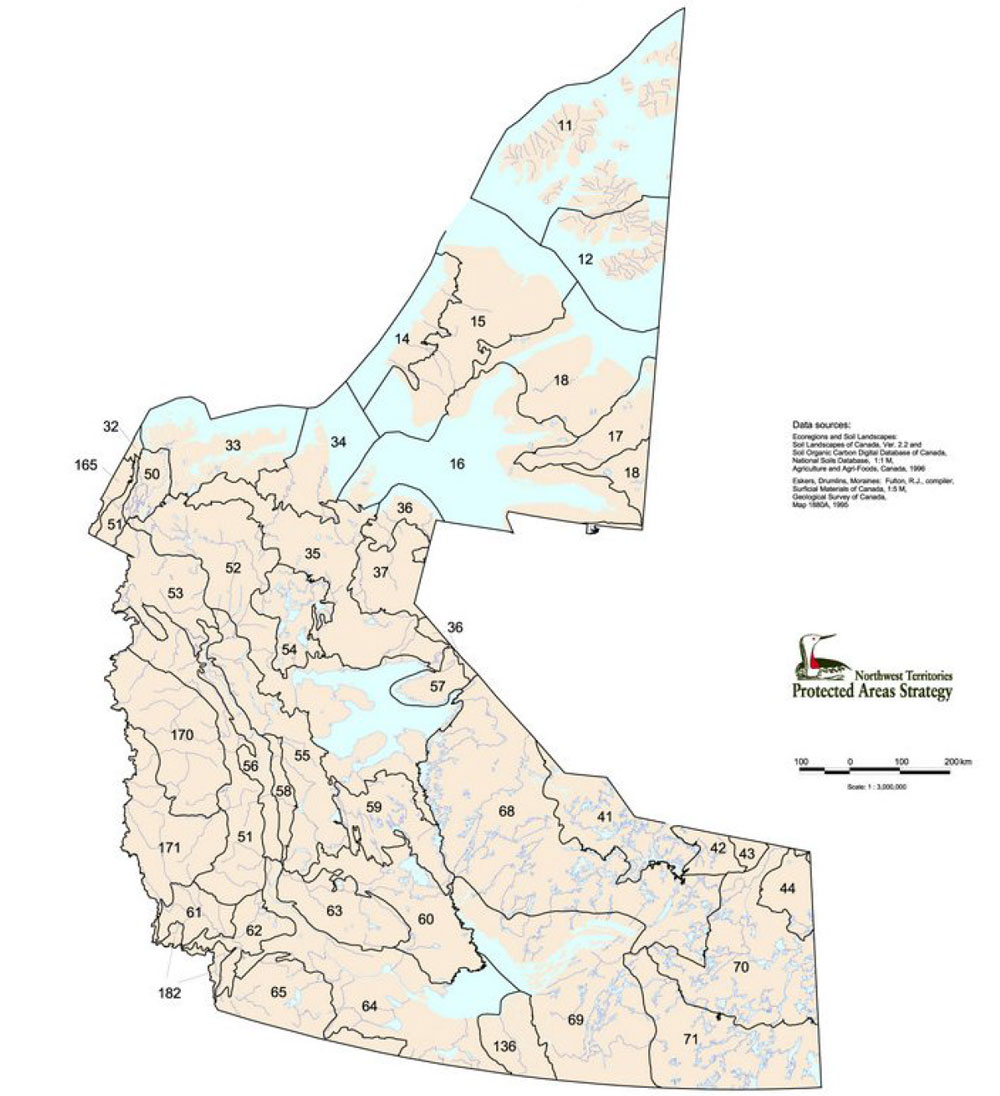
L'annexe E est une carte qui représente les écorégions terrestres des Territoires du Nord-Ouest. Les écorégions sont numérotées de la façon suivante :
11. Basses-terres des îles Sverdrup
12. Plateau des îles Parry
14. Plaine côtière de l'île Banks
15. Basses-terres de l'île Banks
16. Basses-terres du golfe Amundsen
17. Monts Shaler
18. Basses-terres de l'île Victoria
32. Plaine côtière du Yukon
33. Plaine côtière de Tuktoyaktuk
34. Plaine alluviale de la rivière Anderson
35. Plaine de la baie Dease
36. Collines Coronation
37. Plaine du lac Bluenose
41. Hautes-terres du lac Takijua
42. Basses-terres du lac Garry
43. Plaine alluviale de la rivière Back
44. Plaine/hautes-terres du lac Dubwant
50. Delta du MacKenzie
51. Plateau de la rivière Peel
52. Plaine du Grand lac de l'Ours
53. Plaine de Fort McPherson
54. Collines Colville
55. Chaînon Norman
56. Plaine alluviale du fleuve Mackenzie
57. Plaines Grandin
58. Monts Franklin
59. Plaine du lac Keller
60. Plaine du Grand lac des Esclaves
61. Plateau de la Nahanni
62. Plaine du lac Sibbeston
63. Plateau Horn
64. Basses-terres de Hay River
65. Hautes-terres du nord de l'Alberta
68. Hautes-terres de la rivière Coppermine
69. Hautes-terres du lac Tazin
70. Hautes-terres de la rivière Kazan
71. Hautes-terres du lac Selwyn
136. Hautes-terres de la rivière des Esclaves
165. Monts Richardson
170. Monts Mackenzie
171. Monts Selwyn
182. Hautes-terres de Hyland
Annexe F : Bibliographie
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (2012). « T.N.-O. Franc parler – Transfert des responsabilités »).
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada et Commission canadienne des affaires polaires (2010-2011). Rapport ministériel sur le rendement.
Affaires indiennes et du Nord Canada (2004). « T.N.-O. Franc parler ».
Affaires indiennes et du Nord Canada (2011). Deuxième vérification environnementale des Territoires du Nord-Ouest, 2010.
Affaires indiennes et du Nord Canada et Commission canadienne des affaires polaires (2009). Rapport ministériel sur le rendement.
Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (2012). Protected Areas.
Bureau du vérificateur général du Canada (2008). Le Point, Rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable à la Chambre des communes : Ecosystèmes. « Chapitre 4: Les aires protégées fédérales pour les espèces sauvages ».
Bureau du vérificateur général du Canada (2010). Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes – Printemps. « Chapitre 4 : Pour un développement durable dans les Territoires du Nord-Ouest ».
Comité consultatif de la Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (1999). Northwest Territories Protected Areas Strategy: A Balanced Approach to Establishing Protected Ares in the Northwest Territories.
Comité directeur de la Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (2010). Establishment Action Plan 2010-2015: Fulfilling the Promise of the Northwest Territories’ Protected Areas Strategy.
Comité directeur de la Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (2010). Northwest Territories Protected Areas Strategy Annual Report 2009-10. (pas disponible en français)
Commission économique pour l’Afrique (2009). Review of the application of environmental impact assessment in selected African countries.
Commission mondiale des aires protégées (2004). Indigenous and Traditional Peoples and Protected Areas: Principles, Guidelines and Case Studies.
Conseil canadien des aires écologiques (2011). Rapports du Système de rapport et de suivi pour les aires de conservation (SRSAC).
Convention sur la diversité biologique (n.d.). Thematic Report: Overview of Terrestrial and Marine Protected Areas in Canada. (pas disponible en français)
Ehrlick, M. et Tobac, A. (2008). The Co-Management Route to Creating a Protected Area.
Environnement Canada (2010). Planifier un avenir durable : Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada.
Environnement Canada (2010). Rapport ministériel sur le rendement de 2009-2010.
Environnement Canada (2011). Aires protégées au Canada.
Environnement Canada (2011). Aires protégées, comparaison à l’échelle internationale.
Environnement Canada (2011). Budget des dépenses de 2010-2011 : Partie III – Rapport sur les plans et les priorités.
Environnement Canada (2011). Le réseau des aires protégées.
Environnement Canada (2011). Rapport ministériel sur le rendement de 2010-2011.
Environnement Canada (2012). À propos d’Environnement Canada.
Environnement Canada (2012). Aires protégées.
Environnement Canada (2012). Défis et priorités.
Environnement Canada (2012). L’approche d’Environnement Canada.
Environnement Canada (2012). Stratégie ministérielle de développement durable – Volet du site Internet ministériel : Section IV du Rapport sur les plans et les priorités de 2011-2012.
Environnement Canada (2012). Territoires du Nord-Ouest.
Environnement Canada (2012). Vision et principes directeurs.
Environnement et Ressources naturelles (2011). NWT State of the Environment – Highlights 2011. Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife (T.N.-O.) Canada.
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et Équipe Biodiversité TNO (2010). Northwest Territories State of the Environment – 2010 Biodiversity Special Edition. Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife (T.N.-O.) Canada.
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Bureau de la statistique (2011). « Community Population Estimates by Ethnicity, Northwest Territories ». (site Web non disponible en français)
Gouvernement du Canada (2009). Stratégie pour le Nord du Canada : Notre Nord, notre patrimoine, notre avenir.
Gouvernement du Canada (2012). Investir au Canada.
Gouvernement du Canada (2012). Réalisations accomplies dans le cadre de la Stratégie pour le Nord du Canada de 2007 à 2011.
Gouvernement du Canada et gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (2012). Espèces en péril aux Territoires du Nord-Ouest, récupéré le 30 novembre 2012.
Groupe de travail d’Edéhzhíe (2009). Final Recommendations Report, and Northwest Territories Protected Areas Strategy (2010). Edéhzhíe Sitesheet.
Initiative boréale canadienne (2010). La richesse réelle de la région du Mackenzie : évaluation de la valeur du capital naturel d’un écosystème boréal nordique.
Nature Canada (n.d.). Parks and Protected Areas.
Nesbitt, L. (2008). Putting Policy into Practice: The Contribution of the Northwest Territories Protected Areas Strategy to National and International Biodiversity Conservation.
Nuttall, M. (2009). Canada’s and Europe’s Northern Dimensions (publié par A. Dey Nuttall et M. Nuttall), Oulu: Oulu University Press, 110 p.
PACTeam Canada Inc. et Secrétariat de la Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (2009). Legislation, Sponsoring Agencies, and the Protected Areas Strategy.
Parcs Canada (2012). Établissement d’une aire protégée : La promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest.
Plate, E., Foy, M. et Krehbiel, R. (2009). Best practices for First Nation involvement in environmental assessment reviews of development projects in British Columbia. (pas disponible en français)
Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (2009). Northwest Territories Protected Areas Strategy – Lessons Learned. Présentation PowerPoint.
Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (2011). NWT Conservation Statistics: Established Protection.
Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (2011). Shúhtagot’ine Téné.
Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (2012). PAS 8-Step Process.
Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (2012). Carte de Ka’a’gee Tu.
Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (2012). Ts’ude niline Tu’eyeta.
Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (n.d.). Frequently Asked Questions.
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (2003). Préserver le capital naturel du Canada : Une vision pour la conservation de la nature au 21e siècle.
Territoires du Nord-Ouest (2011). Northwest Territories Energy Report. (site Web non disponible en français)
Territoires du Nord-Ouest, Bureau de la statistique. Investment. (site Web non disponible en français)
The Outspan Group Inc. (2006). Socio-Economic Assessment of the Saoyú-?ehdacho Candidate Protected Area: Background Information and Preliminary Assessment.
The Pembina Institute (2009). Counting Canada’s Natural Capital: Assessing the Real Value of Canada’s Boreal Ecosystems. Mise à jour 2009.
Wek’eezhii Land and Water Board (n.d.). Co-management.
Wiersma, Y.F., Beechey, T.J., Oosenbrug, B.M. et Meikle, J.C. (2005). Protected Areas in Northern Canada: Designing for Ecological Integrity Phase 1 Report.